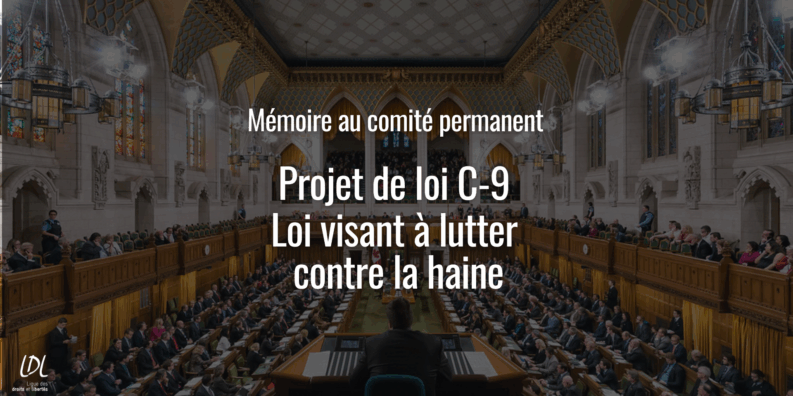Consultations sur le projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)
Mémoire présenté par la
Ligue des droits et libertés
MÉMOIRE – PDF
BRIEF IN ENGLISH – PDF
Devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne
Chambre des communes
6 novembre 2025
La LDL sera entendue par le Comité le jeudi 6 novembre à 15h30.
Table des matières
Présentation de la Ligue des droits et libertés
1) Nouvelle définition de la haine
2) Infraction d’exposition de symboles liés au terrorisme et à la haine
3) Infractions d’intimidation et d’empêcher l’accès à des bâtiments
4) Infraction motivée par la haine
5) Abrogation du consentement préalable du procureur général
Présentation de la Ligue des droits et libertés
La Ligue des droits et libertés (LDL) est une organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, qui vise à défendre et à promouvoir les droits humains en mettant de l’avant leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance. Depuis sa création en 1963, la LDL a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d’instruments et d’institutions voués à la défense et la promotion des droits humains, tels que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).
Elle intervient régulièrement dans l’espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits humains auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. La LDL est également membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). La LDL poursuit, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et contre toute forme d’abus de pouvoir, pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont universels, interdépendants et indissociables.
Nous remercions le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes de son invitation à commenter le projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels).
Introduction
Le projet de loi C-9 déposé le 19 septembre 2025 par le ministre de la Justice est présenté comme un outil pour lutter contre la haine et assurer la sécurité des Canadien-nes. Il s’inscrit dans un contexte d’augmentation des crimes haineux rapportés par la police, notamment envers des communautés juives et musulmanes[1]. La haine et l’intolérance envers des groupes historiquement discriminés au sein de notre société est un problème important et grave auquel il est urgent de répondre.
La Ligue des droits et libertés (LDL) considère que le projet de loi C-9, qui consiste à apporter plusieurs modifications au Code criminel, ne constitue pas un moyen approprié de lutte contre la haine et s’en inquiète. Sans apporter de nouveaux outils juridiques pour lutter efficacement contre la haine, C-9 représente une menace aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, notamment les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. La LDL joint sa voix aux 42 organisations signataires d’une lettre de l’Association canadienne des libertés civiles transmise au ministre le 6 octobre, enjoignant le gouvernement à ne pas adopter C-9 et à privilégier des approches communautaires qui protègent les groupes vulnérables sans compromettre les droits et libertés[2].
Le projet de loi propose :
- d’inscrire au Code criminel une définition de la haine qui se situe en deçà du seuil établi dans la définition adoptée par la Cour suprême, ce qui n’est pas souhaitable ;
- de créer une nouvelle infraction criminelle de fomenter la haine en exposant un symbole associé à une entité inscrite sur la liste canadienne des entités terroristes — liste critiquée de longue date par des organisations de la société civile ;
- de créer une nouvelle infraction criminelle d’intimidation et d’empêcher ou de gêner l’accès à des lieux spécifiques, notamment des lieux de cultes, basée sur des concepts flous et imprécis ;
- de créer une nouvelle infraction liée à la commission d’une infraction lorsque celle-ci est motivée par la haine, déstabilisant la cohérence du Code criminel qui prévoit actuellement que la haine constitue un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine ;
- et d’abroger le consentement préalable du procureur général qui pourrait, ailleurs qu’au Québec, augmenter le risque de poursuites privées abusives et d’accusations mal fondées portées par des policiers.
La LDL s’inquiète des impacts d’un tel projet de loi sur l’exercice des droits et libertés et sur les mouvements sociaux qui sont à risque de faire l’objet de davantage de surveillance et de répression, une tendance déjà observée dans les années récentes, notamment à l’égard des mouvements appelant au respect des droits humains et du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. La LDL rappelle à cet effet que le Canada est appelé à respecter et à s’inspirer des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998, qui garantit le droit de promouvoir la protection et la réalisation des droits humains aux niveaux national et international. La Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme souligne d’ailleurs sa profonde préoccupation par rapport à des États où les défenseurs des droits sont ciblés par « des restrictions de la liberté de mouvement, d’expression, d’association et de réunion ».
La LDL exhorte le législateur à ne pas adopter le projet de loi C-9 et à élargir les consultations et conversations avec les communautés visées par des propos et comportements haineux afin d’identifier des solutions communautaires qui soient efficaces et ne compromettent pas l’exercice des droits et libertés de ces mêmes communautés et de l’ensemble de la population canadienne.
1. Nouvelle définition de la haine
Le projet de loi C-9 propose d’inscrire à l’article 319(7) du Code criminel la définition suivante de la haine, laquelle s’appliquerait aux nouvelles infractions proposées dans C-9 et aux infractions existantes : « sentiment plus fort que le dédain ou l’aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement (hatred) ».
La jurisprudence de la Cour suprême identifie plutôt un seuil plus élevé devant être rencontré pour que des propos soient caractérisés de haineux. La Cour suprême a établi en 1990 dans l’arrêt R. c. Keegstra[3] que la haine « désigne une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation » (version originale anglaise : « ’connotes emotion of an intense and extreme nature that is clearly associated with vilification and detestation »). La Cour poursuit en déclarant que : « La haine suppose la destruction [.] [Elle représente] une émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce groupe. »
Sans référence au caractère extrême de ce sentiment, tel que défini dans la jurisprudence de la Cour suprême, C-9 risque d’abaisser le seuil à partir duquel une personne pourrait être considérée comme ayant tenu des propos criminellement haineux, portant ainsi atteinte de manière injustifiée à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne.
La LDL s’oppose à la proposition de codifier dans le Code criminel une définition de la haine qui se situe en deçà du seuil établi par la Cour suprême.
2. Infraction d’exposition de symboles liés au terrorisme et à la haine
C-9 propose la création d’une nouvelle infraction à l’article 319 (2.2) du Code criminel à l’effet de « fomente[r] volontairement la haine contre un groupe identifiable en exposant dans un endroit public [un symbole] ». Trois types de symboles sont visés, à savoir a) un symbole principalement utilisé par une entité inscrite sur la liste des entités terroristes, ou principalement associé à une telle entité ; b) la croix gammée ou la rune double de la victoire nazie ; c) un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’être confondu avec lui.
Tout d’abord, la création d’infractions criminelles associant des individus ou des gestes à la liste canadienne des entités terroristes est en soi problématique. La LDL, à l’instar d’autres organisations, a exprimé son opposition à une telle liste depuis sa création. Alors qu’elle est présentée comme un outil destiné à protéger la sécurité des personnes au Canada et dans le monde, dans les faits, elle constitue plutôt une liste opaque et arbitraire qui porte atteinte aux libertés d’association et d’expression ainsi qu’à l’application régulière de la loi (due process) devant les tribunaux[4]. Les listes des entités terroristes sont souvent des instruments politiques utilisés de manière discrétionnaire pour servir les intérêts géopolitiques des États et de leurs alliés. L’inscription d’organisations dans la liste canadienne est le fruit d’une décision discrétionnaire du ministre de la Sécurité publique qui ne respecte pas les garanties minimales de l’ONU en la matière[5]. Elle compte actuellement 87 entités et ne cesse de s’allonger.
Dans un rapport publié en juillet 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, met en garde contre de graves violations des droits humains qui peuvent survenir « lorsqu’une définition vague et trop large du terrorisme entraîne une catégorisation tout aussi imprécise des “organisations terroristes”, laquelle engendre à son tour des infractions formulées de manière excessive et générale »[6].
Nous considérons que cela s’applique avec justesse à l’art. 319(2.2). Il s’agit d’une infraction formulée de façon excessive et qui dépend — à son alinéa a) et c) — du processus de désignation d’« entités terroristes ». Soulignons aussi que le Rapporteur spécial, en rappelant que toute infraction en lien avec ce type de listes doit satisfaire au principe de légalité et permettre de savoir ce qui est considéré comme un comportement criminel, énonce que les infractions en lien avec l’exposition de symboles sont précisément exposées au risque du flou juridique[7].
Le nouvel art. 319(2.2) est formulé de sorte que le simple fait d’exposer un des symboles visés pourrait constituer en soi une fomentation de la haine (plus précisément, au niveau de l’élément matériel de l’infraction). Autrement dit, une personne qui affiche un symbole visé pourrait être arrêtée sur cette simple base. Parce que la police agit sur des motifs raisonnables majoritairement tirés de l’élément matériel des infractions, une infraction dont l’élément matériel est l’affichage d’un symbole autorise en pratique l’intervention policière sur cette base.
Si édifier en infraction le simple fait d’afficher un symbole n’est pas l’intention du législateur, quel serait l’objet de l’art. 319(2.2) ? Présentement, une personne qui affiche une croix gammée peut, dépendamment du contexte, être exposée à des accusations en lien avec l’infraction d’incitation à la haine (art. 319(1)), l’infraction de fomenter la haine (art. 319(2)) et l’infraction de fomenter l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste (art. 319(2.1)). Le simple fait de l’afficher n’est pas criminalisé en soi, mais cela peut certainement faire partie des éléments de preuve permettant d’établir l’élément matériel (actus reus) et l’élément mental de l’infraction (mens rea). Ainsi, au mieux, l’art. 319(2.2) serait répétitif et ne serait d’aucune utilité. Au pire, par la criminalisation de l’affichage d’un symbole lui-même, il dépasserait largement ce qui est permis constitutionnellement, représentant une entrave importante à la liberté d’expression.
Son libellé laisse une grande place à l’arbitraire dans l’application, d’autant plus que les termes sont vagues et imprécis, par exemple : « principalement utilisé par une entité inscrite » et « principalement associé à une telle entité » à l’alinéa a). Au vu de ce qui précède, nous considérons que si C-9 est adopté, l’utilisation de symboles associés à des organisations de libération nationale ou d’autodétermination, par exemple, tamil, kurde ou palestinienne, dans le cadre de manifestations pacifiques pourrait exposer les manifestant-es à des accusations criminelles. En ce qui a trait à l’alinéa c) visant « un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’être confondu avec lui », cela étend encore la portée apparente du texte en la rendant tributaire d’un jugement subjectif, permettant une application d’autant plus arbitraire et déraisonnable.
Également, puisque la notion d’« endroit public » inclut Internet et les médias sociaux, une personne qui publierait dans un compte privé — mais accessible à un certain nombre de personnes — une image d’un drapeau d’une « entité inscrite » pourrait faire face à une accusation criminelle.
Nous rappelons que les infractions actuelles à l’art. 319 du Code criminel[8] représentent des atteintes à la liberté d’expression protégée par l’al. 2b) de la Charte canadienne, mais qui sont justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne[9]. Il nous semble établi que le nouvel art. 319 (2.2.) ne pourrait pas être sauvegardé par l’article premier puisqu’il ne nous semble pas exister un lien rationnel entre l’objectif et la disposition telle que formulée et que celle-ci ne représente certainement pas une atteinte minimale à la liberté d’expression.
Cela serait non seulement une violation injustifiée aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, mais pourrait également représenter une atteinte au droit à l’égalité protégé à l’art. 15 de la Charte canadienne sur les motifs de race, d’origine nationale ou ethnique ou encore de religion.
Exemples de dérives à l’international
Le Royaume-Uni offre un exemple saisissant d’une dérive sécuritaire. Les défenseurs des libertés civiles s’inquiètent du fait que la police s’appuie sur de larges pouvoirs d’ordre public pour détenir des personnes qui publient des tweets « offensants », procédant à une trentaine d’arrestations par jour[10]. Les citoyen-nes flottent dans l’incertitude quant à quels propos prononcés, publiés ou « likés » sur les médias sociaux, vont dépêcher la police à leur porte, et les conduire derrière les barreaux.
Par ailleurs, après avoir désigné « entité terroriste » le groupe d’activistes « Palestine Action », qui avait perturbé les installations d’Elbit Systems, fabricant d’armes israéliennes, le Royaume-Uni a procédé à l’arrestation de centaines de citoyen-nes pacifiques, dont des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des vétérans, pour le simple fait d’avoir affiché une bannière ou un vêtement avec la mention « I oppose genocide, I support Palestine Action »[11]. Amnistie Internationale y a vu « une violation des obligations internationales du Royaume-Uni en matière de protection des droits à la liberté d’expression et de réunion[12] », soulignant qu’au « lieu de criminaliser les manifestants pacifiques, le gouvernement devrait se concentrer sur la prise de mesures immédiates et sans équivoque pour mettre fin au génocide d’Israël et mettre fin à tout risque de complicité du Royaume-Uni dans le génocide[13] » (notre traduction). Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a critiqué la position du gouvernement britannique, affirmant que la nouvelle loi « utilise à mauvais escient la gravité et l’impact du terrorisme[14] » (notre traduction).
Aux États-Unis, le président Donald Trump a désigné le 22 septembre 2025 par décret le mouvement « Antifa » comme étant une « organisation terroriste »[15], démontrant le risque que des mouvements sociaux et des groupes de la société civile soient désignés comme des entités « terroristes » à des fins politiques par les gouvernements au pouvoir.
Dans un récent rapport paru en octobre 2025 sur la criminalisation des mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, la Fédération internationale pour les droits humains constate d’ailleurs que dans plusieurs des États analysés, les législations antiterroristes sont utilisées pour réprimer des mouvements de solidarité. Parmi les recommandations phares, la FIDH exhorte les États à « réformer les législations antiterroristes afin d’exclure explicitement toute application aux formes d’expression politique protégées, en précisant dans la loi que la critique d’un État, la participation à des manifestations pacifiques ou l’expression de slogans politiques ne peuvent, en soi, être assimilés à une infraction terroriste[16] ». La FIDH recommande aussi de créer des « organes indépendants et pluralistes de supervision […] chargés d’examiner régulièrement les mesures adoptées au titre de la sécurité nationale[17] ». Ces préoccupations majeures devraient éclairer le Canada quant à la nature et l’usage qui est fait de la liste des entités terroristes.
Moyens de défense statutaires
C-9 prévoit des défenses à cette nouvelle infraction. Bien qu’à première vue, le langage rappelle les défenses prévues pour les infractions de fomenter volontairement la haine ou l’antisémitisme (art. 319(3) et 319(3.1)), nous considérons que les nouvelles défenses sont plus restreintes.
Présentement, les défenses admises prévues à 319(3) et 319(3.1) sont :
- a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies ;
- b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument ;
- c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies ;
- d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Les défenses suivantes sont proposées relativement à la nouvelle infraction à 319(2.2) :
- a) l’exposition du symbole servait un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à la religion, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public ;
- b) l’exposition du symbole était faite de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
L’alinéa b) reprend en substance la défense de signalement de bonne foi pour remédier à une question provoquant des sentiments de haine prévue à l’alinéa d) de 319(3) et 319(3.1). Par contre, la défense de l’alinéa a) nous paraît rétrécir la portée pratique des justifications reconnues.
En effet, sous la défense actuelle à l’alinéa c) de 319(3) et 319(3.1), il suffit que les déclarations se rattachent à une question d’intérêt public, que leur examen soit fait dans l’intérêt du public, et que la personne accusé-e ait cru qu’elles soient vraies. Transposée au symbole, l’équivalent aurait été que l’exposition du symbole ait été faite en lien avec une question d’intérêt public, dans l’intérêt public.
Quant à l’actuelle défense prévue à l’alinéa b) de 319(3) et 319(3.1), il suffit d’avoir exprimé de bonne foi une opinion sur un sujet ou un texte religieux. Transposé au contexte du symbole, l’équivalent aurait été une exposition de bonne foi d’un symbole en lien avec la religion.
Or, le texte proposé fusionne en quelque sorte les deux logiques de b) et c) dans les défenses actuelles, mais exige que l’exposition du symbole, même poursuivant un but « légitime », ne soit pas « contraire à l’intérêt public ». Ainsi, nous passons d’un test positif (rattachement et examen dans l’intérêt public ou bonne foi) à un test à deux étapes dont un filtre négatif : but légitime, mais non contraire à l’intérêt public. Il en résulte une défense plus étroite et moins prévisible pour l’infraction proposée à 319(2.2).
3. Infractions d’intimidation et d’empêcher l’accès à des bâtiments
C-9 propose l’ajout de l’article 423.3 (1) qui criminalise le fait d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez une personne afin de l’empêcher d’accéder à un cimetière ; ou à des bâtiments ou constructions servant principalement à des fins de culte religieux ou utilisés principalement par un groupe identifiable. Le nouvel article 423.3 (2), de son côté, érige en infraction le fait d’empêcher ou de gêner intentionnellement l’accès à ces mêmes lieux.
Ces nouvelles dispositions mettent en cause la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique. Elles compromettent le droit de manifester et de faire du piquetage tel que défini par les tribunaux. Il s’agit pourtant là de formes d’expression reconnues et de droits essentiels dans une société démocratique comme le souligne la Cour suprême : « La démocratie représentative dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le fruit de la liberté d’exprimer des idées divergentes et d’en discuter, dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté. »[18]
La possibilité de faire du piquetage est par ailleurs cruciale en droit du travail : « Dans le contexte du travail, le piquetage constitue une forme d’expression particulièrement vitale et fermement ancrée dans l’histoire.[19] » Les modifications proposées mettent à mal ces formes d’expression.
Des concepts flous
L’intimidation au sens de l’art. 423.3 (1) repose sur l’utilisation d’un concept flou à savoir « l’intention de provoquer la peur » chez une personne en vue d’entraver son accès à un lieu. L’utilisation d’un concept aussi vague et subjectif conduit à l’arbitraire. Il est difficile d’identifier le comportement prohibé.
La jurisprudence n’exclut du champ d’application de la protection offerte par l’al 2. b) de la Charte canadienne que la violence ou la menace de violence portant directement atteinte à l’intégrité et à la liberté physiques d’une autre personne[20]. À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé :
[49] Violence is not the mere absence of civility. The application judge extended the concept of violence to include actions and words associated with a traditional form of political protest, on the basis that some town employees claimed they felt « unsafe ». This goes much too far. A person’s subjective feelings of disquiet, unease, and even fear, are not in themselves capable of ousting expression categorically from the protection of s. 2(b).[21]
Les gestes perturbateurs générant inconforts, embarras et craintes subjectives n’autorisent pas à restreindre ce mode d’expression[22]. Or, « l’intention de provoquer la peur » pourrait facilement être confondue avec des gestes perturbateurs actuellement permis dans le cadre de manifestations ou de piquetages. La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs reconnu en 2019 que la manifestation est une activité expressive intrinsèquement perturbatrice qui dérange et interrompt le quotidien[23]. Il en va de même de l’infraction « empêcher ou gêner » l’accès prévu à l’art. 423.3 (2) qui pourrait ériger en crime plusieurs comportements perturbants ou dérangeants, mais protégés constitutionnellement.
Des lieux innombrables et imprécis
Ces dispositions attachent des conséquences très graves au fait de manifester à certains endroits. La Cour suprême a pourtant rejeté, comme arbitraires, les limites au piquetage fondées sur le lieu d’expression :
Le lieu du piquetage a peu de rapport avec la question de savoir si le piquetage est pacifique et respectueux des droits d’autrui ou si, au contraire, il est violent et irrespectueux de ces droits. En mettant l’accent sur la nature et l’effet de l’expression plutôt que sur l’endroit où elle a lieu, l’approche fondée sur l’acte fautif assujettit la restriction du piquetage à l’application d’un critère rationnel et non arbitraire[24].
En outre, ces lieux — où les manifestant-es encourent des sanctions criminelles importantes — sont innombrables et difficiles à identifier. Il n’est pas toujours aisé d’établir si un bâtiment, une construction ou une partie de ceux-ci sont « utilisés principalement par un groupe identifiable » pour la tenue d’une infinité d’activités. C’est pourtant crucial pour savoir à quoi une personne s’expose au plan pénal.
Étant donné que ces lieux constituent aussi des milieux de travail, les nouvelles infractions risquent de pénaliser démesurément les travailleur-euses qui y œuvrent. Faire du bruit, crier des slogans ou retarder le passage par la distribution de tracts ; tout cela pourrait éventuellement correspondre aux infractions floues de « peur » ou de « gêne ». Ces modifications législatives sont susceptibles de miner le droit au piquetage. Elles pourraient aussi entraîner un effet inhibiteur sur le droit de parole et d’expression de groupes identifiables qu’on prétend vouloir protéger.
Par ailleurs, mentionnons que des manifestations peuvent avoir lieu devant des lieux visés à l’art. 423.3 (1) non pas en raison de la nature du lieu, mais de l’événement qui s’y déroule. C’est le cas notamment d’une manifestation ayant eu lieu en juillet 2025 devant une Église de Montréal où avait lieu un concert d’un chanteur associé au mouvement MAGA (Make America Great Again)[25]. C’est également le cas de manifestations tenues en 2024 dénonçant la tenue de foires immobilières de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, qui ont parfois été organisées dans des lieux de culte tels que des synagogues[26]. De telles manifestations avaient ainsi pour objectif de dénoncer des pratiques illégales en vertu du droit international. Le choix du lieu de la manifestation était donc ainsi intimement lié aux activités illicites qui se déroulaient à l’intérieur. De semblables mobilisations relèvent de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à défendre les droits humains, et bien que se déroulant devant un lieu de culte, ne doivent ni être associées à tort à de l’antisémitisme ni faire l’objet d’accusations criminelles advenant l’adoption de C-9.
Peines et conséquences démesurées
Les peines se rattachant à ces deux infractions (intimidation ou gêne) dont les contours sont vastes et flous sont exorbitantes. Une infraction à l’art. 423.3 (1) ou (2) rend passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. L’infraction d’intimidation ne donne pas ouverture à la défense concernant la communication de renseignements (423.3(4)). À titre d’infraction secondaire, l’intimidation permettrait aussi le prélèvement d’ADN[27].
Double emploi
Ces nouvelles infractions sont également inutiles. Le Code criminel offre déjà suffisamment d’outils à une personne victime d’obstruction ou d’intimidation[28]. Tout indique que les nouvelles dispositions visent en fait la criminalisation d’actes actuellement autorisés dans le cadre de manifestations pacifiques.
Nous considérons que ces nouvelles infractions auraient à tout le moins pour effet de dissuader les personnes de manifester devant certains lieux et s’immiscent dès lors dans le message. Une telle atteinte aux libertés d’expression, de réunion et d’association est injustifiable[29].
4. Infraction motivée par la haine
C-9 prévoit la création d’une nouvelle infraction à l’art. 320.1001(1) lorsque la commission d’une infraction déjà existante (appelée infraction incluse) est motivée par la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression du genre. Cette disposition vise à aggraver les peines prévues lorsque l’infraction est poursuivie par acte criminel.
Dans l’architecture actuelle du Code criminel, l’art.718.20(a) prévoit les principes de détermination de la peine et nomme, comme principe, à l’alinéa a) que la peine doit être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes. Le fait qu’une infraction ait été motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur les facteurs ci-haut énumérés y est prévue à l’art. 718.2(a)(i) comme circonstance aggravante. On y prévoit aussi, par exemple, qu’est une circonstance aggravante le fait que l’infraction soit un mauvais traitement envers un partenaire intime ou un mauvais traitement envers une personne mineure.
La nouvelle infraction vient déstabiliser cette cohérence du Code criminel, d’autant plus que l’article y est ajouté sans modifier 718.2(a)(i). La motivation d’un crime par la haine est maintenant non seulement une circonstance aggravante devant être analysée conjointement avec d’autres circonstances aggravantes et atténuantes dans le cadre de la détermination de la peine, mais constituerait désormais une infraction en soi si C-9 était adopté. Les peines maximales sont augmentées de façon excessive, notamment, une infraction passible d’un maximum de 2 ans passerait à 5 ans, et une infraction passible de 14 ans passerait à la perpétuité. Pour des faits matériellement identiques, le facteur de la motivation par la haine fait sauter le plafond applicable d’une catégorie à l’autre, là où le régime actuel permet d’ajuster la sévérité au cas par cas. Ainsi, 320.1001(1) pourrait permettre l’application de peines disproportionnées, rompant avec le principe d’harmonisation des peines.
5. Abrogation du consentement préalable du procureur général
Le projet de loi C-9 propose d’éliminer le consentement du procureur général (PG) pour porter des accusations de propagande haineuse, présentement prévu à l’art. 319(6) du Code criminel. Cette exigence sert de filtre préalable dans plusieurs provinces. Au Québec, ce mécanisme de filtrage est plutôt théorique, car en vertu de l’art. 2 du Code criminel et de la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales[30], tous-tes les procureur-es du DPCP agissent comme substituts du PG et peuvent donner le consentement sans forme particulière[31], et les accusations criminelles sont portées par eux et elles. En conséquence, la suppression proposée ne changerait pas la pratique au Québec. Cependant, nous considérons qu’elle réduirait le filtrage réel ailleurs au pays, augmentant le risque de poursuites privées abusives et les accusations mal fondées portées par des policiers.
Conclusion
En formulant des projets de loi, le Canada aurait avantage à s’inscrire à l’encontre des tournants répressifs, enclins à criminaliser l’expression de diverses opinions et à réprimer la défense des droits et à réaffirmer haut et fort le respect de ses obligations en matière de droits humains. Avec ses dispositions redondantes, ses nouvelles infractions au langage vaste et flou, son retrait de sauvegardes et son ajout de nouvelles peines extrêmement lourdes, le projet de loi C-9, non seulement ne fournira pas de nouveaux outils appropriés pour lutter efficacement contre la haine, mais va plutôt provoquer la peur du délit d’opinion et l’autocensure à outrance.
[1] Ministère de la Justice Canada, « Le Canada dépose un projet de loi visant à lutter contre les crimes haineux, l’intimidation et les entraves », Communiqué, 19 septembre 2025.
[2] Association canadienne des libertés civiles, « Des groupes de la société civile demandent au gouvernement fédéral de revoir le projet de loi C-9 », Lettre signée par 42 organisations et communiqué de presse, 6 octobre 2025.
[3] R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697.
[4] Voir à ce sujet Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC), « Une Coalition canadienne des libertés civiles dénonce et appelle à la fin de la liste des entités terroristes qui est arbitraire, secrète et attentatoire aux droits humains », Communiqué presse, 17 octobre 2024. La LDL est membre de la CSILC.
[5] Nations Unies, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, « Pratiques optimales visant à protéger les droits humains lors de l’application des mesures administratives de prévention du terrorisme (mesures restrictives, inscription sur listes de terroristes, détention de sécurité et dispositifs obligatoires) », Rapport, A/80/284, 31 juillet 2025, par. 19 à 38 ; Nations Unies, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, « Dix pratiques optimales en matière de lutte antiterroriste », Rapport, 22 décembre 2010, A/HRC/16/51, par. 35.
[6] Nations Unies, op.cit., A/80/284, par. 33.
[7] Nations Unies, op.cit., A/80/284, par. 35.
[8] Art. 319 (1) Incitation publique à la haine ; 319 (2) Fomenter volontairement la haine ; 319 (2.1) Fomenter volontairement l’antisémitisme.
[9] R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697.
[10] Gabriella Swerling, « The victims of Britain’s free speech crackdown », The Telegraph, 3 septembre 2025.
[11] Sylvia Hui et Jill Lawless,« Police arrest almost 900 at London protest supporting banned group Palestine Action », Toronto Star, 15 septembre 2025.
[12] Amnesty International UK, « Open Letter to Sir Mark Rowley, Chief Commissioner of the Metropolitan Police », August 6th, 2025.
[13] Amnesty International UK, « UK : Arrests of Palestine Action protesters ‘deeply concerning’ », Press Release, August 8, 2025.
[14] Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, « UK : Palestine Action ban ‘disturbing’ misuse of UK counter-terrorism legislation, Türk warns », Communiqué de presse, 25 juillet 2025.
[15] The White House, « Designating Antifa as a Domestic Terrorist Organization », Décret présidentiel, 22 septembre 2025.
[16] FIDH, « Criminalisation et contrôle du récit : la solidarité avec la Palestine en ligne de mire », Rapport, No 846f, octobre 2025, p. 53.
[17] Idem.
[18] SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 RCS 573, par.12.
[19] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, [2013] 3 RCS 733. par 35.
[20] Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) Code Criminel (Man.), [1990] 1 RCS 1123.
[21] Bracken v. Fort Erie (Town), 2017 ONCA 668 (CanLII) par. 49.
[22] Voir par exemple Medvedovsky c. Solidarity for Palestinian Human Rights McGill (SPHR McGill), 2024 QCCS 1518 (CanLII) par.42 ; Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, par. 163
[23] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, par. 163.
[24] S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8 (CanLII), [2002] 1 RCS 156 par. 76
[25] Fannie Arcand, « Manifestation devant un concert du chanteur MAGA Sean Feucht », La Presse, 25 juillet 2025.
[26] Voir notamment Oona Barrett, « Infiltration dans une foire immobilière qui vend des terres palestiniennes à Montréal », Pivot, 8 mars 2024.
[27] Article 8 de C-9.
[28] Troubler des offices religieux art. 176(2) ; Méfaits : biens religieux art. 430(4.1) ; Harcèlement criminel art. 264 ; Proférer des menaces art. 264.1 ; Intimidation art. 423.
[29] Voir Verdun (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 302, 2000 CanLII 11385 (QCCA) : « […] lorsqu’on indique à une personne comment et où elle doit exercer sa liberté d’expression, c’est déjà une limite à la liberté d’expression, limite qui doit être justifiée. »
[30] RLRQ c D-9.1.1.
[31] Drummond, 2023 QCCA 1387.