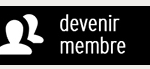Retour à la table des matières
Massimiliano Mulone, professeur agrégé, École de criminologie, Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée
La déviance policière, soit lorsqu’un-e agent-e de police en fonction commet un acte qui s’écarte des normes établies (légales, réglementaires, déontologiques, éthiques), demeure un sujet complexe et sensible, en partie parce que les agent-e-s de police possèdent des pouvoirs coercitifs exclusifs, mais aussi parce que ce sont elles et eux qui sont généralement appelés à intervenir lorsqu’une infraction est commise, rendant de facto problématique la réaction aux abus commis par des membres des forces de l’ordre. Pour ces raisons, les policières et policiers sont généralement soumis à un appareillage de contrôle spécifique. Or, ce système de contrôle des déviances policières est très régulièrement l’objet de virulentes critiques, lesquelles sont à la source de réformes censées accroître l’imputabilité policière.
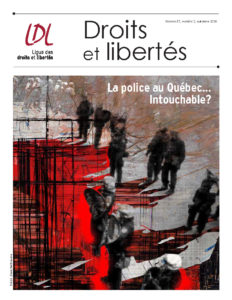
Pourtant, peu d’études ont véritablement cherché à comprendre l’efficacité de ces divers appareils de contrôle. Par efficacité, je n’entends pas tant la mesure de la performance des organismes en charge de réagir aux écarts policiers, que les effets durables que ceux-ci produisent sur la profession policière et la société en général. En effet, c’est en participant à renforcer les normes professionnelles et les bonnes pratiques des policières et policiers, ainsi qu’en accroissant de manière plus générale leur légitimité aux yeux de toutes et tous, tant plaignant-e-s qu’agent-e-s de police, que ces organismes de contrôle atteindront leur objectif principal : protéger le public.
Avec mon collègue Rémi Boivin et trois auxiliaires de recherche, Gabrielle Delmail, Maude Pérusse-Roy et Clémentine Simon, nous nous sommes entretenus avec soixante-douze agent-e-s de police québécois ayant reçu au moins une plainte (en déontologie ou au criminel) dans les cinq dernières années. Les entrevues avaient pour principal objectif de comprendre les impacts professionnels et personnels que la plainte et les procédures subséquentes avaient eu sur elles et eux. Nous nous sommes notamment intéressés aux perceptions qu’elles et ils avaient des plaignant-e-s, des divers systèmes de gestion des plaintes, de leur employeur, de leur métier et de leurs pair-e-s. Deux résultats m’apparaissent particulièrement intéressants, soit : 1) les possibles raisons derrière la polarisation des perceptions entre plaignant-e-s et agent-e-s de police; 2) la capacité des divers systèmes à produire une réforme positive des comportements policiers.
Impunité ou hypersurveillance?
Tout le monde s’entend sur l’existence d’un traitement différencié de l’agent-e- de police face à la justice. C’est plutôt sur la nature de cette différence que des divergences de taille se font entendre. Certain-e-s soutiennent que l’agent-e bénéficie d’une relative impunité et qu’elle ou il n’est que trop rarement puni en cas de faute. D’autres affirment au contraire que la police est soumise à une surveillance et un contrôle qu’aucune autre profession ne subit et qu’elle est trop souvent accusée à tort des déviances qu’on lui attribue.
J’aimerais présenter les possibles raisons qui permettent à chacun-e de rester campé sur ses positions. Les données recueillies nous permettent en effet d’expliquer en partie le bien-fondé des deux points de vue. Tout d’abord, si l’on regarde les statistiques compilées en déontologie, force est de constater qu’il est très rare qu’un-e agent-e de la paix soit puni. Si l’on prend l’année 2016-2017, on trouve ainsi 1 781 plaintes qui donnent lieu à 146 enquêtes qui débouchent sur 30 citations dont 20 sont jugées dérogatoires. C’est donc un peu plus d’une plainte sur 100 qui se conclut par une sanction[1]. Ces chiffres semblent donc donner raison aux plaignant-e-s qui considèrent que les agent-e-s de police ne sont pratiquement jamais punis. Bien entendu, pour les policières et policiers, ce chiffre serait plutôt une preuve de la frivolité de la plupart des plaintes à leur égard, frivolité qui découlerait soit de la malveillance, soit de la méconnaissance des citoyen-ne-s.
Effets des plaintes sur les policières et policiers
Si les agent-e-s de la paix sont si peu sanctionnés, pourquoi se sentent-elles et ils victimes d’acharnement de la part de la population et de la justice? Tout d’abord, parce que, contrairement à la sanction, l’expérience de la plainte est fréquente. Si l’on prend à nouveau l’année 2016-2017, un-e agent-e sur 12 à la Sûreté du Québec (SQ) (8,2 %) aurait reçu une plainte en déontologie. En ce qui concerne le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ce chiffre monterait à 15,4 %, soit plus d’un-e agent-e sur sept. Ensuite, parce que les impacts des plaintes sur les policières et policiers sont réels, même s’ils prennent rarement la forme d’une sanction formelle. En effet, un tiers des agent-e-s que nous avons interviewés témoignent de répercussions importantes de la plainte et des procédures subséquentes : dépression majeure, anxiété, éclatement familial et social, remise en cause de la carrière. Un autre tiers affirme n’avoir eu aucun impact, alors que le tiers restant a vécu de manière intermittente et moins aiguë ce que le premier groupe a vécu. Pour une part importante des policières et policiers (plus importante que le tiers invoqué, car il faut prendre en compte les histoires qu’elles et ils se racontent entre eux), la plainte est donc loin d’être sans conséquences, et ce, quelle qu’en soit l’issue. Et ces conséquences sont souvent invisibles pour la plaignante ou le plaignant.
À la lumière de ce qui vient d’être présenté, il est possible de comprendre pourquoi les deux parties, plaignant-e-s et agent-e-s de police, ont non pas raison, mais ont leurs raisons de croire ce qu’elles et ils croient. Deux avenues pourraient être envisagées ici. D’une part, il faudrait essayer de mieux comprendre pourquoi aussi peu de plaintes débouchent sur une sanction pour permettre de rendre le système plus efficace aux yeux des plaignant-e-s. D’autre part, l’on pourrait chercher à atténuer les effets négatifs de la plainte sur les policières et policiers, tout en conservant l’intégrité des systèmes de gestion des déviances policières. De cette manière, il serait possible de réduire l’écart de perceptions entre plaignant-e-s et agent-e-s de polices.
L’impossible réforme?
Le second constat important concerne l’absence d’impact de la plainte sur le renforcement des normes professionnelles. Non seulement la majorité des policières et policiers disent ne rien avoir changé à leurs pratiques, mais celles et ceux qui font état d’une modification adoptent invariablement le discours de l’underpolicing. En effet, les agent-e-s accusés disent éviter dorénavant d’agir dans des situations où le professionnalisme commanderait une action, et ce, dans le but de se préserver d’une autre plainte. En d’autres termes, la plainte aurait fait d’elles et eux de moins bons agent-e-s.
Cette perspective s’explique facilement : la vaste majorité (96 %) des participant-e-s considère que l’intervention ayant mené à la plainte n’était pas fautive. Seuls trois personnes interviewées nous ont dit mériter leur plainte et une seule d’entre elles a reçu une sanction. Si presque toutes les personnes rencontrées sont d’accord avec le principe d’un Commissaire à la déontologie policière, pratiquement aucune ne pense que cela aurait dû s’appliquer à son cas. On comprend immédiatement les limites d’un système de justice qui ferait presque toujours face à des personnes convaincues de leur innocence et, donc, persuadées d’être victime d’une injustice. En termes de légitimité, cela pose un problème fondamental.
Ce qui est peut-être encore plus frappant, c’est de voir comment l’expérience de la plainte et des procédures subséquentes s’inscrit aisément dans leur préconception du monde : si on reçoit une plainte, c’est parce que la population ne nous aime pas; si l’on me sanctionne, c’est parce que les personnes qui n’exercent pas ce métier ne le comprennent pas (et que de facto elles ne sont pas aptes à juger); si l’employeur ne me soutient pas, c’est parce qu’il n’est là que pour les bons coups et se détourne dès qu’une accusation est portée; etc. Cette réinterprétation est poussée à son paroxysme lorsqu’un policier affirme que « [c]e sont les policiers qui travaillent le plus qui ont des plaintes », soulignant paradoxalement que la plainte serait un signe de professionnalisme chez l’agent-e.
Dans notre étude, l’habitus policier semble donc être renforcé par l’expérience de la plainte, ce qui témoigne du chemin qu’il reste à parcourir. Et c’est probablement là que se situe la plus grande limite des systèmes actuels de gestion des plaintes envers les agent-e-s de la paix au Québec : une incapacité à produire du changement. Il faudrait dorénavant s’occuper de ce vaste chantier.
[1] Les données proviennent du site web du Commissaire à la déontologie policière. Elles ne tiennent pas compte des possibilités de renverser une décision de culpabilité devant la Cour d’appel du Québec. Il y a donc tout lieu de croire que ce ratio de 1/100, aussi petit soit-il, surévalue en fait le nombre de policières et policiers sanctionnés.
La revue est gratuite pour
|