Retour vers la table des matières
Robyn Maynard, auteure et militante afro-féministe
Déni de justice : de la rue à la prison[1]
Je suis le crime incarné. Je le sais depuis le jour où mon chemin a croisé celui de la police […] et comment voulez- vous que je pense autrement quand les policiers se lancent à mes trousses dès que je passe dans leur champ de vision, quand ce sont eux qui décident de quoi je suis coupable après m’avoir interpellé – comment voulez- vous que je ne pense pas qu’ils sont là, à l’affût, sûrs et certains qu’il va se passer quelque chose, un problème qui leur confirmera ce qu’ils savent déjà, et que ce problème-là […] c’est tout simplement que j’existe[2].
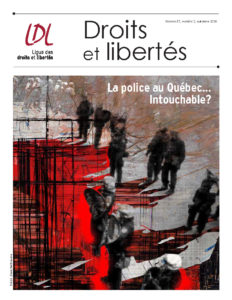
Les Noir.e.s sont soumis à une surveillance policière si étroite qu’ils peinent à exister dans l’espace public. Non seulement ils sont plus fréquemment interpellés et questionnés par la police, mais ils sont aussi plus souvent accusés, soumis à de lourdes sentences et incarcérés, et la libération conditionnelle leur est plus rarement accordée. La précarité économique et la relégation des communautés noires à la périphérie de la société se sont accompagnées d’un resserrement de la surveillance et de la répression racialisées à tous les échelons du système pénal.
La diabolisation des collectivités noires se fonde en grande partie sur une figure de rhétorique très ancienne associant Noir.e.s et criminalité.
La racialisation du crime
Les partisans du statu quo affirment que les Noir.e.s ne sont pas injustement visés par le profilage, la surveillance policière et l’incarcération en raison de leur race : ils doivent ces désagréments au simple fait qu’ils enfreignent la loi plus souvent que les Blanc.he.s. Au Canada, cette interprétation, en apparence très logique et sensée, de la surreprésentation des Noir.e.s dans les prisons est à l’oeuvre depuis quatre siècles. Les racines du contrôle, de la répression et de la détention des Noir.e.s remontent en réalité à l’esclavage et à la colonisation. L’amalgame Noir.e.s/crime date des avis du 17e siècle dénonçant les esclaves fugitifs et présentant sous les traits de voleurs et de criminels ceux qui s’étaient libérés de leur joug. Libres ou asservis, tous les hommes, femmes et enfants noirs étaient alors très étroitement surveillés par les forces de l’ordre et la société blanche dans son ensemble.
Par euphémisme, la peur des Noir.e.s se camoufle maintenant sous la peur du crime, et l’État les assimile d’ailleurs l’une à l’autre. En 2014, un blogueur du Journal de Montréal révélait que les documents pédagogiques de la première année d’études en Techniques policières d’un établissement collégial du Québec enseignaient que les Noir.e.s commettent plus de crimes que les Blanc.he.s, surtout des crimes violents, des vols et des agressions sexuelles. En ce qui concerne l’opinion publique, la population canadienne continue d’associer la race, et plus particulièrement les Noir.e.s, à la criminalité.
Pourtant, les pratiques du contrôle et de la répression sont considérées comme neutres du point de vue de la race. La plupart des hauts gradés de la police persistent à nier avec force les allégations de profilage racial ou de racisme systémique.
Surveillance extrême
Les forces de l’ordre bénéficient d’une latitude discrétionnaire considérable pour choisir leurs zones de patrouille et identifier les suspects en apparence, c’est-à-dire les personnes qui leur semblent suspectes. Défini comme l’ensemble des interactions avec les instances de surveillance ou la police qui ont lieu en raison de stéréotypes raciaux, ethniques ou religieux, le profilage occupe une place centrale dans le déploiement de l’activité policière. La prémisse selon laquelle les Noir.e.s seraient plus susceptibles de commettre des crimes induit une surveillance plus étroite de cette population, et donc des taux d’interpellations, de mises en accusation et d’incarcérations plus élevés. En un mot, ce sont les stratégies policières visant les Noir.e.s qui en font des criminels. Une étude réalisée à Montréal confirme que c’est bien la surveillance extrême dont les Noir.e.s font l’objet, et non leur propension au crime, qui constitue le principal facteur de leur taux disproportionné d’arrestations.
Le profilage racial débouche aussi sur la criminalisation de l’immigration. À Montréal et à Toronto, la police et les chroniqueurs présentent régulièrement les Noir.e.s comme des migrants[3]. Une étude sur les pratiques policières constate que les gangs de rue sont très souvent désignés comme un problème d’immigration. Contredisant l’amalgame immigration / criminalité, des statistiques rendues publiques par Sécurité publique Canada révèlent au contraire que les jeunes nés à l’étranger ont moins de comportements délinquants que ceux qui sont nés au Canada.
Entraves à la libre circulation : profilage et obstacles à la mobilité des Noir.e.s
Dans une étude de 2011 de la Commission des droits de le personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sur le profilage racial des jeunes, la plupart des personnes noires ou racisées interrogées affirment ne pas pouvoir circuler ni se rassembler en public sans que la police les observe, ou même qu’elle les prenne en photo sans un mot d’explication. Les adolescents noirs du Québec signalent que la police les harcèle dans les stations de métro et leur demande régulièrement de se disperser dès qu’ils sont plus de deux. Les Canadien.ne.s blancs considèrent généralement qu’il va de soi qu’ils peuvent se déplacer librement dans l’espace public; mais pour les personnes d’ascendance africaine, ce n’est pas le cas.
Les ressources consacrées à la surveillance et à la répression des jeunes noirs ou racisés dans l’espace public sont sans commune mesure avec une réelle dangerosité. En 2010, Le Devoir indiquait que, selon les chiffres du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) lui-même, les gangs de rue ne représentaient que 1,6 % des crimes rapportés à la police en 2009. Le SPVM expliquait qu’il continuait de consacrer autant de ressources à ce problème somme toute relativement mineur parce que la population avait l’impression que les gangs étaient très actifs à Montréal – même si le Service de police savait cette impression complètement fausse[4].
Dans ce contexte, les interpellations aléatoires ont particulièrement militarisé les quartiers noirs. Les contrôles policiers de routine visaient déjà les Noir.e.s de manière disproportionnée en 2001; mais en 2006-2007, près de la moitié (40 %) des jeunes hommes noirs ont été interpellés pour vérification d’identité dans certains quartiers, contre seulement un peu plus de 5 % chez les Blanc.he.s. L’auteur de cette enquête souligne que la plupart de ces vérifications n’étaient probablement pas justifiées, puisqu’elles n’ont pas mené à des arrestations[5].
Le profilage reste destructeur en soi
En 2008, après que la police eut fait feu sur trois adolescents, tuant l’un d’eux (Fredy Villanueva, un jeune latino non armé) et blessant les deux autres, un mouvement de protestation a agité le quartier. Des jeunes racisés ont accusé la police de harcèlement et de profilage, soulignant que ces pratiques étaient si excessives qu’elles en venaient à perturber leurs activités quotidiennes. Par la suite, une étude interne du SPVM fuitée dans La Presse a révélé que les perceptions de ces jeunes racisés étaient justes. Les forces de l’ordre contrôlent aussi les mouvements et déplacements des Noir.e.s de diverses autres façons. En 2004, la police a créé plus de 20 nouvelles catégories d’actes réputés troubler l’ordre public, par exemple offrir des services sexuels contre rémunération), cracher par terre, flâner ou faire du bruit. Des recherches montrent que cette répression des incivilités a ciblé de manière disproportionnée les jeunes noirs, latinos et sud- asiatiques[6]. L’observation permanente des moindres faits et gestes des Noir.e.s par les forces de l’ordre et leur catalogage dans de gigantesques bases de données policières ont des impacts majeurs sur le bien-être psychologique de leurs collectivités. Même quand il ne débouche pas sur une arrestation ou des actes de violence, le profilage reste destructeur en soi : l’American Psychological Association constate qu’il peut provoquer des troubles anxieux, par exemple le trouble de stress post- traumatique, ainsi qu’un sentiment d’aliénation. Cette surveillance extrême condamne les Noir.e.s à n’exister qu’en tant que suspects. Or, cette réalité reste complètement inconcevable et inimaginable pour les citoyens blancs, qui ne sont pas exposés au sentiment de terreur provoqué par le profilage.
La destruction des Noir.e.s : violence et impunité policières
Cependant, les Noir.e.s ne craignent pas seulement d’être interpellés et harcelés par la police; ils vivent dans l’angoisse d’être physiquement malmenés, blessés ou tués au nom de l’ordre public. Une réelle peur des forces de l’ordre imprègne la plupart des collectivités noires. Les recherches de Frances Henry établissent que la plupart des jeunes hommes noirs, quelle que soit leur classe sociale, montrent leurs mains vides à l’approche de policiers, de crainte qu’ils ne leur tirent dessus. Alors que la plupart des Canadien.ne.s blancs considèrent que les policiers les protègent, les Noir.e.s craignent pour leur sécurité en leur présence.
En dépit de ces taux effarants de brutalité et des preuves accablantes établissant le ciblage des Noir.e.s dans les interventions des forces de l’ordre, la violence policière continue de bénéficier d’une certaine indulgence, même quand elle s’avère mortelle.
Une peur très profonde
La peur très profonde que les Noir.e.s éprouvent à l’égard des forces de l’ordre est une réaction rationnelle à une réalité brutale : celle du nombre effroyable des Noir.e.s que les policiers tuent, le plus souvent sans aucune conséquence pour eux. En un mot, la police peut les abattre en toute impunité.
En 1987, Anthony Griffin, un adolescent, a été abattu à Montréal d’une balle dans la tête. On a ensuite appris que la police municipale montréalaise plaçait des photos de personnes noires sur ses cibles d’entraînement au tir. La disculpation des policiers impliqués dans la mort par balles de jeunes hommes noirs est systématique ou presque à Montréal. Et ces morts ne sont pas rares…
- Leslie Presley, un Jamaïcain noir de 26 ans, a été tué par la police montréalaise en 1990 dans un bar du centre-ville.
- Fritzgerald Forbes, un Noir d’ascendance jamaïcaine, est mort en 1991 à l’âge de 22 ans d’un arrêt cardio- respiratoire peu après avoir été interpellé dans le quartier Parc-Extension.
- Marcellus François, un Haïtien de 24 ans, a été abattu au fusil d’assaut M16 alors qu’il n’était pas armé; ce n’était même pas lui que la police recherchait.
- Trevor Kelly, un Jamaïcain de 43 ans, abattu par la police d’une balle dans le dos en 1993. Aucune de ces morts n’a débouché sur des accusations à l’égard des policiers impliqués.
Une étude constate que, dans les cas d’infraction mineure, les policiers dégainent leur arme quatre fois plus souvent face à des Noir.e.s que face à n’importe quel autre groupe démographique[7]. Des jeunes et des adultes noirs, hommes et femmes, continuent d’être abattus par la police dans des situations qui auraient très bien pu se régler d’une autre façon, et très souvent lors d’interventions policières qui n’auraient même pas eu lieu si les personnes concernées avaient été blanches.
Conclusion
Plus la peur des Noir.e.s se confond avec la peur du crime dans l’opinion publique, plus les capacités d’action de l’État en matière de criminalisation des Noir.e.s augmentent, et plus les technologies violentes de surveillance et de punition resserrent leur étau sur eux.
Si la répression et le châtiment racialisés ont été pensés à bien des égards pour maintenir la subordination des Noir.e.s, ceux-ci continuent de riposter par la subversion, la résilience et le refus. Néanmoins, aussi inspirantes et décisives leurs victoires soient- elles, le racisme anti-Noir.e.s qui imprègne la société canadienne et les institutions de l’État reste intact ou presque.
| La vérité a souvent un goût amer. Nous ne savons comment accepter nos histoires. Faut-il s’en tenir aux faits et dire la vérité? Cet ouvrage monumental si richement documenté est précieux, il nous tire de l’oubli et du silence. Que savons-nous de l’esclavage au Canada? Que savons-nous de la répression exercée sur les femmes et les hommes noirs? Que savons-nous du racisme systémique? Que savons-nous de la détresse des Autochtones, des sans-papiers, des personnes réfugiées? Enfin fort peu… Parce que l’État construit et déconstruit les récits à travers les institutions. Les citoyen.ne.s sont ainsi condamné.e.s à reproduire une histoire qui nous échappe. | Procurez-vous un exemplaire! |
[1] Cet article est constitué d’extraits des chapitres 1 et 3 du livre NoirEs sous surveillance: esclavage, répression et violence d’État au Canada, de Robyn Maynard, traduit de l’anglais Policing Black Lives par Catherine Égo. La LDL tient à remercier Mémoire d’encrier de nous avoir autorisés à reproduire ces extraits.
[2] Lewis R. Gordon, Her Majesty’s Other Children : Sketches of Racism from a Neocolonial Age, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 1997, p. 21.
[3] Clayton James Mosher, Discrimination and Denial : Systemic Racism in Ontario’s Legal and Criminal Justice Systems, 1892-1961, Toronto, University of Toronto Press, 1998, p. 7-10.
[4] Le Devoir, 2010, dans Léonel Bernard et Christopher McAll, Jeunes Noirs et système de justice : La mauvaise conseillère, Revue du CREMIS, vol. 3, no 1, hiver, 2010, p. 13.
[5] Mathieu Charest, Mécontentement populaire et pratiques d’interpellation du SPVM depuis 2005 : doit- on garder le cap après la tempête?, Montréal, SPVM, 2010.
[6] David M. Tanovich, The Colour of Justice : Policing Race in Canada, Toronto, Irwin Law, 2006, p. 84.
[7] Stenning, 1994, dans Frances Henry et Carol Tator, Racial Profiling in Canada : Challenging the Myth of ‘a Few Bad Apples’, Toronto, University of Toronto Press, 2006, p. 74.
