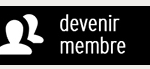Retour à la table des matières
Geneviève Breault, étudiante à la maîtrise en droit à l’UQAM et stagiaire à la Ligue des droits et libertés
On évalue qu’environ 5 % des victimes d’ agression sexuelle porteraient plainte au Canada. En 2014, 2,9 % des accusations ont mené à la condamnation de l’agresseur[1]. Un très petit nombre de cas donnent lieu au dépôt d’une plainte, et un faible pourcentage de celles-ci sont traduites devant notre système de justice et mènent à un verdict de culpabilité. Quel rôle jouent les services de police dans le processus de plainte des survivantes d’agression sexuelle au Québec? Cet article démontre que l’attitude, les propos et les gestes que posent ou ne posent pas les agent-e-s de police sont déterminants pour les victimes dans toutes les étapes de dénonciation de leur(s) agression(s).
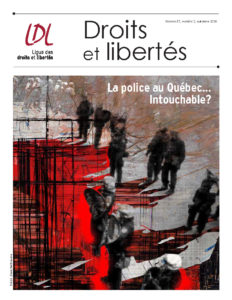
Pour Marlihan Lopez du Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), le principal enjeu dans le traitement des plaintes réside dans la persistance des mythes, préjugés et biais qu’entretiennent les policier-ère-s à l’égard des victimes. Les études[2] démontrent que le premier contact avec les services policiers est déterminant pour les survivantes d’agression sexuelle dans leur perception de la capacité du système judiciaire à se positionner comme l’avenue adéquate dans le traitement du crime dont elles ont été victime. Une attitude culpabilisante, des questions insistantes ou encore des propos désobligeants peuvent avoir pour effet de générer une victimisation secondaire. À l’opposé, une attitude respectueuse et compatissante permet aux victimes d’être crues et de se sentir soutenues dans leur dénonciation, ce qui les encourage à continuer leurs démarches.
Préjugés et stigmatisation ; des freins à une démarche de plainte
Or, des préjugés et une stigmatisation à l’égard du contexte de vulnérabilité socioéconomique ont pour effet de dissuader les victimes d’agression sexuelle de poursuivre le processus ou encore de les amener à remettre en cause que cette démarche auprès des services policiers est la bonne. L’entretien de préjugés à l’égard des communautés dans un contexte de marginalisation a le même effet. Des hommes homosexuels sont accueillis par des policier-ères qui rient et refusent de croire à des actes de violence entre hommes. Des femmes autochtones en milieu urbain se sont fait répondre par des policier-ère-s qu’elles étaient intoxiquées et que, par conséquent, il n’y avait pas vraiment eu d’agression. Des femmes dans l’industrie du sexe n’envisagent même pas la possibilité de dénoncer leur agresseur, car elles savent qu’elles ne seront pas prises au sérieux. Des femmes trans portent plainte et elles sont questionnées sur leur identité de genre. Bien que les policier-ère-s reçoivent de la formation pour déconstruire les mythes généraux qui entourent les agressions sexuelles (ex : les agresseur-euse-s ne sont pas tous des inconnu-e-s cachés dans des fonds de ruelle), il apparait urgent de les former sur leurs biais systémiques et sur les conséquences de ces derniers pour les victimes.
Plusieurs survivantes d’agression sexuelle hésitent également à s’adresser à la police en raison de l’historique de leurs relations avec elle. C’est notamment le cas de femmes de la communauté noire qui vivent du profilage racial ou encore de femmes autochtones qui associent la police aux interventions commandées par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de retrait d’enfants des familles de leur communauté d’origine.
Approches innovantes
Pour pallier ces situations, certains corps policiers, dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), disposent d’équipes spécialisées en agressions sexuelles et ont des approches innovantes. À titre d’exemple, Trêve pour Elles, un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) situé dans l’est de Montréal, accueille dans ses bureaux une agente sociocommunautaire pour recevoir des plaintes. Ces initiatives ont toutefois des limites et la banalisation de la violence vécue reste chose commune.
Le parcours d’une plainte pour agression sexuelleLe dépôt d’une plainte se fait généralement auprès des services policiers qui desservent le territoire où a eu lieu l’agression. La plainte sera ensuite transmise à la Division des crimes majeurs, ou à son équivalent, où une policière ou un policier se verra confier l’enquête. Celle-ci implique notamment une entrevue avec la victime, la rencontre de témoins, l’identification et l’interrogation de la suspecte ou du suspect. Une fois l’enquête terminée, un rapport est transmis à la procureure ou au procureur aux poursuites criminelles et pénales dont le mandat est d’étudier la preuve et d’autoriser ou non le dépôt d’une dénonciation. C’est à elle ou lui, et non à la victime, que revient donc le rôle de porter des accusations contre la personne qui a commis l’agression devant la Cour criminelle. La victime peut toutefois également effectuer un recours en instance civile ou encore devant la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC). Bref, toutes les décisions sont prises soit par la police, soit par la Couronne qui représente les intérêts de la société dès que la victime dépose sa plainte. |
Quelles solutions?
Le manque d’empathie et de formation des policier-ère-s, le faible taux de rétention des plaintes, la longueur des délais, la re-victimisation des victimes lors du contre-interrogatoire, et la légèreté des sentences s’inscrivent parmi les facteurs extrinsèques qui expliquent pourquoi les victimes ne portent pas plainte contre la personne qui les a agresser.
Une meilleure formation et des délais plus courts
Pour les CALACS, l’amélioration du processus d’enquête policière implique nécessairement une meilleure formation sur une base continue offerte à tous les policier-ère-s, qu’elle et ils travaillent ou non au sein d’équipes spécialisées, dont les patrouilleur-euse-s qui représentent souvent le premier contact pour la victime avec le système judiciaire, et parfois, malheureusement, le seul. Il apparait également impératif d’écourter les délais de traitement des plaintes et de mettre en place des processus de suivi pour éviter que les victimes portent le poids d’avoir à relancer les services de police afin que leur dossier reste actif ou encore qu’elles vivent de l’anxiété pendant les mois, voire les années que dure le processus judiciaire.
Peu de plaintes retenues
Lorsque traduites dans le cadre d’une poursuite criminelle, les accusations d’agression sexuelle doivent permettre à la ou au juge d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé-e a commis un crime. Sans témoin dans de nombreux cas, c’est la parole de la victime contre celle de la personne ayant commis l’agression. C’est pourquoi les enquêteuses et enquêteurs, dans leurs efforts pour monter le dossier et pour de ne pas être déboutés par la procureure ou le procureur de la Couronne, exercent une sélection des plaintes retenues. Or, en février 2017, une enquête journalistique a révélé que 19 % des plaintes d’agression sexuelle déposées au Canada entre 2009 et 2014 avaient été rejetées. Au Québec, le pourcentage est de 17 %. Ce phénomène des plaintes classées « sans fondement », et conséquemment fermées, est excessivement préoccupant. Il témoigne, selon plusieurs, d’une culture « paternaliste et conservatrice » des corps policiers et dans laquelle le rôle de la procureure ou du procureur aux poursuites criminelles et pénales n’est jamais remis en cause.
Révision des plaintes d’agressions sexuelles
Cité en exemple partout au monde comme la solution à ce phénomène, le modèle de Philadelphie semble toutefois encore rebuter les corps policiers québécois, à l’exception de la Sureté du Québec (SQ) et du Service de police de Gatineau[3] qui ont mis sur pied un projet-pilote en janvier 2018[4]. En octobre dernier, le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) annonçait également son souhait de se doter d’un comité de révision des plaintes impliquant plusieurs partenaires externes, dont les groupes de défense des victimes d’agression sexuelle[5]. À Philadelphie, la mise en place d’un tel audit en collaboration avec des représentantes de groupe de défense des droits des femmes et des avocates féministes, permet de réviser annuellement des centaines de plaintes pour crime sexuels considérés comme non-fondés ainsi qu’un échantillon de dossiers ouverts. Cette pratique permet d’évaluer la rigueur du processus de réception des plaintes et d’enquête, d’exiger des vérifications additionnelles et même de rouvrir des dossiers. Elle permet également aux corps policiers qui se prêtent à l’exercice de questionner leurs pratiques et de les améliorer, mais également de mieux outiller les intervenantes de groupes de défense de droits en regard du travail des policier-ère-s auprès des victimes qu’elles accompagnent. À Philadelphie, le taux de plaintes rejetées a diminué de 300 % entre 1998 et 2016 et le nombre de plaintes aurait bondi de 50 %[6]. Reste à voir ci ces initiatives inspirées du modèle de Philadelphie seront à la hauteur de ce dernier.
[1] Statistiques Canada, Juristat, 2015. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2015001/article/14241/tbl/tbl01-fra.htm
[2] Collectif, Femmes victimes de violence et système de justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution, 2018. https://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_femmes_violence_justice.pdf
[3] Isabelle Ducas, Agressions sexuelles: Gatineau révisera les plaintes rejetées, La Presse, 27 nov. 2017.
[4] Sureté du Québec, Le gouvernement s’inspire du modèle de Philadelphie dans le cadre d’un projet pilote de la Sûreté du Québec, 1e déc. 2017. https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/comite_revision/
[5] Marc Allard, Crimes sexuels: fini la révision à «l’interne », paru dans Le Soleil, 17 oct. 2018.
[6] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027497/agression-sexuelle-modele-philadephie-police-enquete
[7] Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, Les agressions à caractère sexuel. http://www.agressionsexuellemontreal.ca/lois-et-procedures/processus-judiciaire
La revue est gratuite pour
|