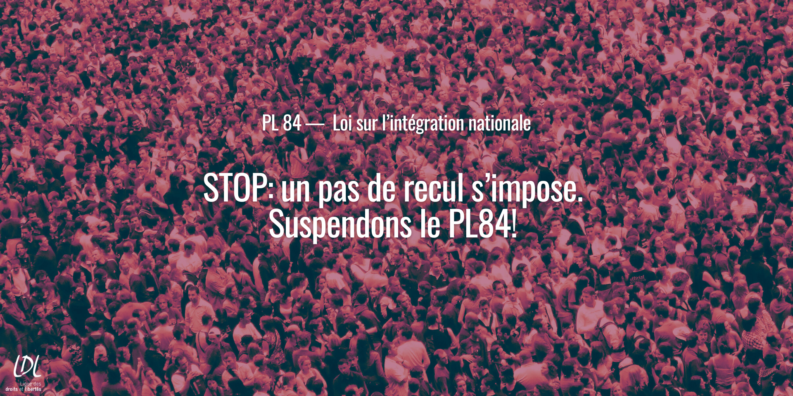Lettre ouverte publiée dans Le Devoir, le 8 avril 2025.
Un pas de recul s’impose avec le projet de loi 84
Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés
Stephan Reichhold, directeur général de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.
Ils cosignent cette lettre avec une centaine d’organismes de même qu’une trentaine de personnalités publiques et du monde intellectuel.*
Une centaine d’organismes — communautaires, de défense des droits humains, syndicales, etc. — ainsi que 32 personnalités publiques et du monde intellectuel demandent au gouvernement québécois de mettre sur pause le projet de loi 84, la Loi sur l’intégration nationale, dont l’étude détaillée a débuté le 3 avril dernier.
Cette proposition législative soulève d’importantes questions de société, qui ne sauraient faire l’économie d’un consensus rassemblant le plus grand nombre. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, et voici les raisons pour lesquelles nous demandons des consultations publiques, larges et inclusives.
Recul de l’interculturalisme et des droits au profit des valeurs
Le projet de loi 84 s’écarte du modèle de l’interculturalisme et opère un glissement dangereux vers un modèle d’intégration de type assimilationniste. Rappelons que le modèle assimilationniste, qui a longtemps prévalu au Québec et au Canada, s’appuie sur une rhétorique anti-immigration, un rejet du pluralisme et une volonté d’imposer les valeurs et la culture de la majorité.
En cherchant à imposer une culture commune et les prétendues valeurs québécoises aux personnes issues de l’immigration et aux membres des groupes ethniques et racisés, le projet de loi 84 s’écarte de manière radicale des principes de réciprocité, de dialogue et de respect du pluralisme qui sont les fondements du véritable interculturalisme.
Présenté comme un geste d’affirmation nationale, le projet de loi s’inscrit dans le prolongement de discours et de mesures qui ont fragilisé le vivre-ensemble au Québec ces dernières années. Ces discours, qui blâment de façon réductrice et mensongère les personnes immigrantes pour une panoplie de problèmes sociaux, servent à justifier des restrictions aux programmes d’immigration et d’intégration, tout en n’offrant aucune solution réelle pour résoudre ces problèmes.
Réaffirmer l’importance de la protection du français ainsi que de la culture et des valeurs québécoises sous le couvert de l’intégration stigmatise encore davantage les personnes immigrantes et certains groupes de population. Nous notons aussi que le projet de loi 84 ne contient aucune disposition se rattachant à la lutte contre la discrimination et le racisme systémique, une lutte pourtant essentielle pour faciliter et favoriser l’intégration.
Affaiblissement des droits et de la Charte québécoise
Le projet de loi 84 propose d’apporter d’importantes modifications à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui auraient pour effet de limiter la portée des droits qu’elle garantit. Selon les termes de ce texte législatif, l’exercice des droits humains devrait se faire dans le respect du modèle québécois d’intégration nationale, qui y est défini de façon très générale et dont les modalités restent à préciser par une politique qui sera adoptée ultérieurement par le gouvernement.
Il nous apparaît hautement problématique que la portée d’une loi quasi constitutionnelle puisse être restreinte par une politique gouvernementale, susceptible d’être modifiée au gré des humeurs politiques du moment, sans consultations auprès de la société civile ni débats à l’Assemblée nationale.
Entre autres choses, la possibilité pour le gouvernement de statuer sur les valeurs québécoises comporte des risques importants d’atteintes au droit à l’égalité et aux libertés de conscience et de religion.
Graves inquiétudes pour l’autonomie du communautaire
Les dispositions du projet de loi 84 pourraient grandement affecter l’autonomie des organismes communautaires recevant du financement gouvernemental, en les obligeant à se conformer à la future Politique sur l’intégration. De plus, le projet de loi permettrait au gouvernement de désigner quelles formes d’aide financière devraient dorénavant se conformer au modèle d’intégration nationale et à ses fondements, ce qui pourrait entraîner de nouvelles contraintes pour les organismes communautaires — notamment dans le domaine de l’immigration, mais pas exclusivement.
Cela constituerait une entorse supplémentaire à l’autonomie des organismes, alors que le gouvernement peine déjà à respecter pleinement ses propres politiques en matière d’action communautaire autonome.
Dans le domaine de l’immigration, les organismes ont développé des pratiques éprouvées pour l’accompagnement des personnes nouvellement arrivées, adoptant notamment l’approche interculturelle. Le gouvernement doit laisser les organismes déployer leur expertise sans contraintes additionnelles, imposées sans que les personnes concernées aient été dûment consultées.
Stop !
Le projet de loi 84 entend nous imposer collectivement — et de façon précipitée — ce que le ministre a qualifié de contrat social. Un modèle d’intégration qui affaiblit les droits au profit des valeurs, et qui tend vers l’assimilationnisme. Un modèle d’intégration qui, plutôt que de respecter les droits et libertés protégés par la Charte québécoise, entend modifier ladite Charte pour qu’elle se plie à l’idée que se fait le gouvernement actuel de l’intégration. Un modèle d’intégration qui met en péril l’autonomie des organismes communautaires si essentiels à notre société.
Pas question d’aller de l’avant sans des consultations publiques, larges et inclusives !
Liste des signataires personnalités publiques/académiques
- Rachad Antonius, Professeur associé, UQAM
- Céline Bellot, Professeure école de travail social, directrice Observatoire des profilages
- Chedly Belkhodja, Professeur, Université Concordia
- Farrah Bérubé, Professeure, UQTR
- Pierre Bosset, Professeur de droit, UQAM
- Gérard Bouchard, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi
- David Carpentier, Doctorant, École d’études politiques, Université d’Ottawa
- Ryoa Chung, Professeure, département de philosophie, Université de Montréal
- Ramatoulaye Diallo, Trésorière du CCMM-CSN
- Catherine Dorion, Artiste
- Paul Eid, Professeur, département de sociologie, UQAM
- Bernard Gagnon, Professeur titulaire, UQAR
- Lara Gautier, Professeure adjointe, Université de Montréal
- Audrey Gonin, Professeure, Université du Québec à Montréal
- Jorge Frozzini, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
- Sophie Hamisultane, Professeure, École de travail social, Université de Montréal
- Jill Hanley, Professeure, École de travail social, Université McGill
- Diane Lamoureux, Professeure émérite, Université Laval
- Louis-Philippe Lampron, Professeur, faculté de droit, Université Laval
- Chiara Letizia, Professeure, département de sciences des religions
- Dominique Leydet, Professeure, dépt de philosophie, Université du Québec à Montréal
- Christian Nadeau, Professeur, département de philosophie, Université de Montréal
- Alexandra Pierre, Militante féministe et anti-raciste
- Will Prosper, Documentariste
- Maryse Potvin, Professeure, UQAM
- Lilyane Rachédi, Professeure, école d etravail social, UQAM
- Geneviève Rail, Professeure émérite distinguée, Université Concordia
- François Rocher, Professeur émérite, École d’études politiques, Université d’Ottawa
- François Saillant, Auteur et militant pour les droits humains
- Bouchra Taïbi, Professeure, département de psychoéducation et travail social, UQTR
- Charles Taylor, Professeur émérite, Université McGill
- Michèle Vatz Laaroussi, Professeure émérite École de travail social Université de Sherbrooke
Liste des signataires organisations
- À deux mains/Head and Hands
- Accueil et intégration BSL
- Action Autonomie le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal
- Action cancer du sein du Québec
- Action Environnement Basses-Laurentides
- Action Femmes et handicap
- Action Réfugiés Montréal
- AGIR Montréal : Action LGBTQ+ avec les immigrantEs et les réfugiéEs
- Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
- Alter Justice
- Amnistie internationale Canada francophone
- Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales de l’Outaouais
- Association canadienne des libertés civiles
- Association des juristes progressistes
- Au bas de l’échelle
- Auto-Psy (région de Québec)
- Bureau de consultation jeunesse
- CALACS du Saguenay
- Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante
- Carrefour d’Action Interculturelle
- Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
- Carrefour d’Intercultures de Laval
- Carrefour de ressources en interculturel
- Carrefour le Moutier
- Centrale des syndicats démocratiques
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
- Centre de femmes l’Érige
- Centre de Femmes Mieux-Être de Jonquière
- Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
- Centre des femmes de Longueuil
- Centre des Femmes du Ô Pays
- Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
- Centre Entre-Femmes
- Centre international de solidarité ouvrière
- CLEF Mitis-Neigette (Rimouski)
- Clef pour l’intégration au travail des immigrants
- Clinique pour la justice migrante
- Collectif de la Revue À bâbord !
- Collectif de lutte et d’action contre le racisme
- Comité logement Bas-Saint-Laurent
- Comité pour la scolarisation
- Comité pour les droits humains en Amérique Latine
- Confédération des syndicats nationaux
- Conseil central du Bas-St-Laurent
- Co-Savoir
- Ex aequo
- Fédération des femmes du Québec
- Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
- Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec
- Fédération québécoise pour le planning des naissances
- Fondation Béati
- Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes
- Foyer du Monde
- FRAPRU
- Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec
- Inclusion
- Justice Pro Bono
- L’Hirondelle, accueil et intégration des immigrants
- L’Observatoire pour la justice migrante
- L’R des centres de femmes du Québec
- La Maison d’Aurore
- Le Centre de réfugiés —The Refugee Centre
- Le Collectif Bienvenue
- Ligue des droits et libertés — Section de Québec
- Ligue des droits et libertés
- Maison d’Haïti
- Maison des femmes des Bois-Francs
- Mission communautaire de Montréal
- Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec
- Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement
- Multi-Femmes
- Organisation populaire des Droits Sociaux
- RÉCIF 02
- Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec (ROSE du Nord)
- Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale
- Regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes
- Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
- Regroupement Naissances Respectées
- Regroupement québécois des CALACS
- Relais-Femmes
- Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
- Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches
- Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
- Réseau québécois de l’action communautaire autonome
- RIVO —Réseau d’intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée
- Service d’Entraide Passerelle
- Service jésuite des réfugiés — Canada
- SIARI
- Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
- Table de concertation de Laval en condition féminine
- Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
- Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
- Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
- Table de concertation féministe · Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Table des groupes de femmes de Montréal
- Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
- Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal
- Table ronde des organismes volontaires en éducation populaires de l’Outaouais
- Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique
- Vision Inter-Cultures