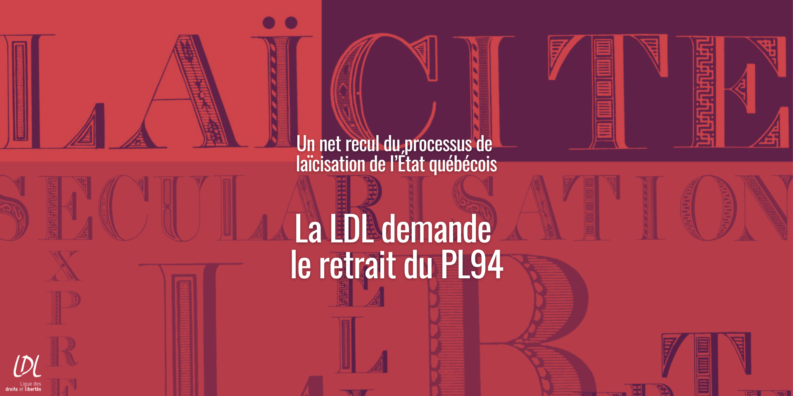Consultations particulières et auditions publiques au sujet du projet de loi 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives
Mémoire présenté par la
Ligue des droits et libertés
Pour une laïcité respectueuse des droits humains
LIRE EN PDF
Devant la Commission de la culture et de l’éducation
Assemblée nationale du Québec
22 avril 2025
Table des matières
Présentation de la Ligue des droits et libertés
La Ligue des droits et libertés, un acteur clé de la laïcisation de l’État québécois
1) Les obligations nationales et internationales de l’État québécois en matière de droits humains
2) La laïcité de l’État, essentielle au respect des droits et libertés
Le danger de dissocier laïcité et droits humains
Pour une laïcité respectueuse du pluralisme
Droit à l’égalité et accommodements raisonnables
Prosélytisme et signes religieux : un faux amalgame
3) Le PL94 et les violations de droits humains
Sabrer dans les droits en l’absence d’un problème avéré
Des violations en chaîne des droits humains
Quand l’État impose des valeurs, des conduites et des attitudes
De la discrimination à l’exclusion des femmes musulmanes portant le voile du système d’éducation
Un projet de loi qui alimente la xénophobie et le racisme systémique
Clauses dérogatoires : un aveu de violation des droits humains
Sommaire des recommandations
Recommandation 1 : Que le gouvernement retire le PL94 parce qu’il est contraire à une laïcité ouverte et inclusive et qu’il est attentatoire aux Chartes et aux normes du droit international des droits humains.
Dans l’éventualité où le gouvernement va de l’avant avec le PL94, nous recommandons :
Recommandation 2 : Que le PL94 soit amendé de telle sorte qu’il respecte les droits énoncés dans la Charte québécoise, en particulier ceux relatifs aux libertés et droits fondamentaux (chapitre I) et au droit à l’égalité (article 10), ainsi que les obligations du Québec en vertu du droit international des droits humains.
Recommandation 3 : Que le PL94 souligne le caractère pluraliste de la société québécoise et le rôle du système d’éducation comme instrument de socialisation, d’intégration et de construction d’un vivre-ensemble respectueux de la diversité.
Recommandation 4 : Que les articles 16, 40, 44 et 45 relatifs aux accommodements, dérogations ou adaptations pour un motif religieux soient retirés du PL94.
Recommandation 5 : Que le gouvernement du Québec commande une étude pour documenter les impacts de la Loi sur la laïcité de l’État de 2019 sur les violations de droits humains, afin d’anticiper les effets éventuels du PL94.
Recommandation 6 : Que les articles 11, 13, 20, 23, 26-29, 32, 35, 42 et 46 visant à imposer des attitudes, comportements, conduites, propos ou décisions à différents acteurs du réseau de l’éducation publique soient retirés du PL94.
Recommandation 7 : Que l’article 32 concernant l’extension de l’interdiction du port de signes religieux soit retiré du PL94 et que le gouvernement s’engage à retirer toute barrière discriminatoire à l’emploi au sein du réseau de l’éducation public québécois.
Recommandation 8 : Que le PL94 mentionne l’existence du racisme systémique et qu’il prévoit des dispositions pour lutter contre le racisme et les discriminations directes, indirectes, institutionnelles et systémiques au sein du réseau d’éducation québécois.
Recommandation 9 : Que le gouvernement québécois mette en place ou renforce les programmes visant à favoriser la tolérance, l’ouverture à l’Autre, le dialogue interculturel et l’éducation aux droits humains dans les écoles du Québec.
Recommandation 10 : Que l’article 36 sur l’usage exclusif du français dans le réseau d’éducation public francophone soit retiré du PL94.
Recommandation 11 : Que les articles 40 et 45 qui touchent l’utilisation préemptive des clauses dérogatoires prévues aux chartes canadienne et québécoise soient retirés du PL94.
Recommandation 12 : Considérant les transformations majeures qu’il apporte à la Loi sur l’instruction publique, que le PL94 fasse l’objet de consultations publiques larges, ouvertes et inclusives, et ce, avant son adoption.
Présentation de la Ligue des droits et libertés
Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme. La LDL est affiliée à la Fédération internationale des droits humains (FIDH).
La LDL a contribué depuis la Révolution tranquille à l’avancement des droits humains au Québec et elle poursuit, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et toutes formes d’abus de pouvoir, et pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans une perspective centrée sur l’interdépendance des droits. Son action a influencé plusieurs lois et politiques publiques, et contribué à la création d’institutions essentielles pour la défense et la promotion des droits humains, dont la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Depuis, elle veille non seulement à protéger les droits énoncés dans la Charte, mais aussi ceux qui n’y sont pas expressément mentionnés et qui sont inscrits dans le droit international des droits humains. Elle exerce une vigile sur les lois, règlements, pratiques et politiques publiques afin de s’assurer que les différents paliers de gouvernement respectent leurs obligations en matière de droits humains.
Nous tenons à remercier la Commission de la culture et de l’éducation de l’invitation à participer aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 94 (PL94), Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, déposé le 20 mars 2025.
La Ligue des droits et libertés, un acteur clé de la laïcisation de l’État québécois
Il convient d’abord de souligner que la Ligue des droits et libertés (LDL) a participé activement à promouvoir la laïcité de l’État au Québec, dans une optique centrée sur la défense et la promotion des droits humains. Dès sa fondation, en 1963, elle a combattu la censure exercée par l’Église catholique et lutté contre les forces religieuses conservatrices s’opposant notamment à la liberté de parole, à l’immigration, au pluralisme religieux et à la reconnaissance des droits des femmes et des personnes LGBTQ2+. La LDL a milité contre la mainmise religieuse sur l’éducation, en revendiquant un système d’éducation laïc et respectueux de l’ensemble des droits humains. Elle a notamment pris position contre le financement public des écoles confessionnelles, pour la déconfessionnalisation des commissions scolaires et le retrait de l’enseignement religieux des écoles publiques. En 1993, elle s’est jointe à la Coalition pour la déconfessionnalisation du système scolaire, qui a joué un rôle important dans la mise en place des commissions scolaires linguistiques au Québec.
La LDL a participé activement aux débats qui ont cours au Québec depuis le début des années 2000 sur les accommodements raisonnables et les divers lois et projets de loi portant sur la laïcité de l’État. Dans ses interventions, elle a rappelé que toute politique visant à encadrer la laïcité de l’État doit avoir pour objectifs premiers d’approfondir la séparation du religieux et du politique, de renforcer la protection du droit à l’égalité et d’assurer le respect et la mise en œuvre des libertés de conscience, de religion et d’expression, du droit à l’éducation, et de l’ensemble des autres droits humains, dans une perspective centrée sur l’interdépendance de tous les droits.
Plan du mémoire
Dans ce mémoire, nous montrerons que le PL94 constitue un recul face au processus historique de laïcisation de l’État québécois en proposant un modèle de laïcité incompatible avec la défense des droits humains. Après avoir rappelé les obligations de l’État québécois en vertu du droit national et international des droits humains, nous exposerons la manière dont le PL94 s’écarte de l’objectif premier de la laïcité qui est justement de respecter, protéger et mettre en œuvre ces droits. Nous dressons par la suite une liste des principales entorses directes aux droits humains, en montrant que celui-ci sabre dans les droits en l’absence d’un problème avéré et en insistant sur la manière dont il menace les libertés de conscience, de religion et d’expression, le droit à l’égalité, et le droit à l’éducation. Nous terminons en rappelant les dangers de l’utilisation répétée, par le gouvernement actuel, des clauses dérogatoires prévues aux Chartes québécoises et canadiennes pour les droits de l’ensemble de la population québécoise.
1. Les obligations nationales et internationales de l’État québécois en matière de droits humains
La LDL tient d’abord à rappeler que le gouvernement du Québec, à l’instar du gouvernement du Canada, est responsable du respect, de la protection et de la mise en œuvre des droits et libertés de toutes les personnes qui habitent son territoire. Ses responsabilités sont sans équivoque à l’égard des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans la perspective où – comme l’a consacré la Déclaration de Vienne de 1993 – l’ensemble de ces droits sont universels, inaliénables, indivisibles, indissociables et interdépendants.
Le Québec est également lié par plusieurs instruments internationaux de protection des droits humains. Dans le cadre de ces consultations, nous insistons en particulier sur les obligations du gouvernement à l’égard de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (1966), de la Convention relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1979), et de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). L’État québécois est également lié par deux lois quasi-constitutionnelle et constitutionnelle qui s’inspirent du droit international des droits humains, soit la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982).
C’est à la lumière des engagements du Québec en vertu de ces instruments de protection des droits humains que nous proposons une analyse critique du PL94, de ses fondements, de son contenu et de ses effets.
2. La laïcité de l’État, essentielle au respect des droits et libertés
Contrairement aux prétentions du gouvernement actuel, la Loi sur la laïcité de l’État et le PL94 destiné à la renforcer s’inscrivent en faux par rapport à deux principes de base de la laïcité, soit la neutralité de l’État à l’égard des religions et la séparation des institutions religieuses et politiques. Ces principes visent à garantir la liberté de conscience, de religion, d’expression et d’association, le droit à l’égalité, la protection tant des personnes croyantes que non croyantes et le principe d’universalité qui est au fondement des droits humains. Comme le rappelle la LDL :
En affranchissant l’État de tout lien avec une religion, [la laïcité] garantit que les citoyen-ne-s seront traités en toute égalité, indépendamment de leurs croyances ou de leur non-croyance. Cette neutralité de l’État face aux religions est une condition nécessaire au respect des libertés de conscience, d’expression et d’association, qui sont essentielles à la démocratie[1].
La laïcité implique à la fois l’indépendance de l’État face aux organisations religieuses et une protection complète de la liberté de culte et de religion. Comme le rappelle la sociologue spécialiste de la laïcité, Micheline Milot : « l’État neutre ne peut aider ni gêner aucune religion. [2]» En interdisant le port de signes au personnel des centres de services scolaires (CSS), aux personnes qui se trouvent sur les lieux mis à la disposition par les CSS ou qui fournissent des services aux élèves, et en imposant une série de restrictions arbitraires à l’expression des croyances et convictions religieuses, le PL94 s’attaque directement à ce principe fondateur et propose une conception trompeuse de la laïcité.
La laïcité repose également sur le principe selon lequel l’État ne peut restreindre ou imposer l’expression ou la non-expression des croyances religieuses aux individus, tant dans l’espace privé que dans les institutions et l’espace publics. Cela implique que l’État s’abstienne d’adopter des lois, politiques ou règlements qui favorisent ou défavorisent certaines personnes en fonction de leurs (non)croyances religieuses ou l’expression de celles-ci. Le PL94, comme la Loi sur la laïcité de l’État, est en contravention avec ce principe puisque l’État institue une discrimination directe fondée sur l’expression des croyances religieuses.
Dans leur rapport sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, publié en 2008, les commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor rappelaient que la neutralité et la séparation de l’Église et de l’État ont pour objectif prioritaire de protéger le droit à l’égalité et les libertés individuelles. « La neutralité et la séparation de l’État et de l’Église (sont) des moyens permettant d’atteindre le double objectif, fondamental, de respect de l’égalité morale et de la liberté de conscience. » Ils soulignaient également que « l’égalité des personnes et leur liberté de conscience et de religion (constituent) les deux finalités premières de la laïcité. [3]»
La LDL soutient qu’en instituant une exclusion du système public d’éducation sur la base de l’expression des croyances religieuses, le PL94 s’attaque aux libertés de conscience et de religion, tout en établissant une forme de ségrégation et d’exclusion qui porte atteinte aux principes d’égalité et d’universalité qui sont aux fondements des droits humains.
Notons enfin que, contrairement à ce qu’affirme le PL94 (et le projet de loi 84, Loi sur l’intégration nationale, avant lui), la laïcité de l’État ne constitue pas une « valeur québécoise » ni un droit fondamental, mais un modèle d’organisation de la société, de séparation des pouvoirs et de gestion du pluralisme religieux.
Recommandation 1 : Que le gouvernement retire le PL94 parce qu’il est contraire à une laïcité ouverte et inclusive et qu’il est attentatoire aux Chartes et aux normes du droit international des droits humains.
Le danger de dissocier laïcité et droits humains
Le PL94 marque un recul majeur par rapport au double mouvement historique d’affirmation de la laïcité et de promotion des droits humains au Québec. Depuis les années 1960, la laïcisation de l’État est allée de pair avec le renforcement des instruments juridiques et des politiques destinés à reconnaître, protéger et mettre en œuvre les droits humains au Québec. L’adoption de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne de 1975 constitue à cet égard un jalon majeur du processus de laïcisation de l’État. En effet, cette loi quasi-constitutionnelle garantit la liberté de conscience, d’expression, de culte et de religion (art. 3), le droit l’égalité de toutes et tous sans discrimination (art. 10), de même qu’un vaste ensemble de droits civils, politiques, économiques et sociaux inspirés des normes du droit international des droits humains.
Dès son adoption, la mainmise de l’Église sur le système d’éducation et le caractère confessionnel de ce dernier sont apparus rapidement comme des entorses à de nombreux droits inscrits dans la Charte québécoise, en particulier aux libertés et droits fondamentaux (chapitre I) et au droit à l’égalité énoncé à son article 10.
Ce lien a été mis en lumière dans le rapport Bouchard et Taylor, qui souligne : « L’un des éléments les plus déterminants de l’approfondissement de la laïcité québécoise se trouve dans la culture des droits de la personne, qui s’est graduellement affirmée au Québec et au Canada dans la deuxième moitié du XXe siècle […] ». Les commissaires ajoutent : « La laïcité de l’État québécois et de ses institutions se trouve ainsi approfondie et consolidée sous l’influence de l’institutionnalisation de cette culture des droits et libertés. [4]» Pour la LDL, qui a été au cœur des luttes pour la laïcité et les droits humains depuis plus de six décennies, il est indéniable que la Loi sur la laïcité de l’État et le PL94 s’inscrivent en faux face à cette évolution, en s’attaquant directement à la Charte québécoise et à plusieurs des droits qu’elle énonce.
Recommandation 2 : Que le PL94 soit amendé de telle sorte qu’il respecte les droits énoncés dans la Charte québécoise, en particulier les libertés et droits fondamentaux (chapitre I) et le droit à l’égalité (article 10), ainsi que les obligations du Québec en vertu du droit international des droits humains.
Pour une laïcité respectueuse du pluralisme
Notre intervention dans le cadre des consultations sur le PL94 s’inscrit dans une volonté de défendre un modèle de laïcité de l’État et d’aménagement du pluralisme religieux qui soit respectueux des droits de toutes et tous. Ainsi, nous souhaitons rappeler que la LDL défend la laïcité de l’État, sur la base des principes énoncés précédemment, mais qu’elle dénonce le PL94 parce qu’il est attentatoire aux droits humains. Tout comme la Loi sur la laïcité de l’État avant lui, ce projet de loi promeut un modèle de laïcité fermée et réfractaire aux droits humains qui nous paraît fort mal adaptée au caractère pluraliste du Québec contemporain.
En effet, plutôt que de refuser l’expression des appartenances religieuses dans les institutions publiques, nous soutenons que la laïcité de l’État doit reconnaître l’importance, pour plusieurs de nos concitoyens-nes, de la dimension religieuse et spirituelle de leurs expériences et de leurs identités individuelles et collectives. En imposant une sécularisation forcée aux individus et en excluant des personnes du système d’éducation publique en raison de l’expression de leur appartenance culturelle et religieuse, le PL94 propose un modèle de gestion du pluralisme de type assimilationniste et profondément attentatoire aux droits humains.
Recommandation 3 : Que le PL94 souligne le caractère pluraliste de la société québécoise et le rôle du système d’éducation comme instrument de socialisation, d’intégration et de construction d’un vivre-ensemble respectueux de la diversité.
Droit à l’égalité et accommodements raisonnables
La laïcité de l’État vise à garantir l’égalité réelle entre les personnes. Pour ce faire, il peut être nécessaire de prendre des mesures de redressement et d’accommodement permettant de combattre certaines formes de discriminations, qu’elles soient directes, indirectes, institutionnelles ou systémiques. Or, le PL94 fait exactement le contraire en institutionnalisant, par une action délibérée de l’État, ce type de discriminations.
La LDL tient à rappeler qu’il est essentiel, pour les institutions, d’adopter des mesures d’accommodements raisonnables lorsque cela ne leur impose pas de contraintes excessives et permet de tendre vers une protection accrue du droit à l’égalité réelle.
Plusieurs décisions judiciaires en matière d’accommodements raisonnables ont contribué à une compréhension plus large et plus libérale, au sens philosophique du terme, du droit à l’égalité protégé par les Chartes[5]. Comme le rappelle Micheline Milot : « Cette tradition d’accommodement vise non seulement le respect concret des droits de la personne, mais veut également favoriser l’intégration de tous les citoyens aux institutions publiques, sans imposer des contraintes indues à la liberté de conscience et de religion qui risqueraient de les en éloigner. [6]» En interdisant toute forme d’accommodement de nature religieuse en milieu scolaire, le PL94 s’attaque à ces libertés et prive les institutions scolaires d’un outil important pour favoriser l’intégration et la mise en œuvre du droit à l’égalité réelle.
Recommandation 4 : Que les articles 16, 40, 44 et 45 relatifs aux accommodements, dérogations ou adaptations pour motifs religieux soient retirés du PL94.
Prosélytisme et signes religieux : un faux amalgame
Il nous semble également impératif de rappeler que la neutralité religieuse de l’État ne se vérifie pas par l’apparence des personnes en situation d’autorité, contrairement à ce qui est suggéré dans le PL94 ainsi que dans la Loi sur la laïcité de l’État en vigueur depuis 2019. Ce projet de loi se fonde sur un présupposé erroné selon lequel une personne en situation d’autorité portant un signe religieux n’exercerait pas ses fonctions en toute impartialité et tenterait de recruter, convertir ou influencer à la faveur de sa croyance religieuse les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité. Selon la LDL, la volonté du gouvernement d’élargir l’interdiction du port de signes religieux alimente cet amalgame courant et pernicieux entre prosélytisme et port de signes religieux.
Certains exemples récents de discrimination et de prosélytisme religieux de la part de personnes en position d’autorité, qui pourtant ne portaient pas de signes religieux, devraient convaincre le gouvernement du mal-fondé son projet de loi. Les cas de l’école Bedford et des 17 écoles qui ont fait l’objet d’une enquête montrent que l’absence du port de signes religieux n’est aucunement garante de la neutralité des personnes en position d’autorité au sein du réseau d’éducation.
Le PL94 présume aussi, à tort, qu’il est simple de distinguer ce qui constitue un signe ou un symbole religieux. Un tel flou contribue à renforcer l’expression des préjugés dans les milieux de travail et à créer un climat de suspicion susceptible d’alimenter la méfiance, les délations et les tensions sociales. Le PL94 ouvre également la porte à un pouvoir arbitraire de la part de celles et ceux qui seront chargés de faire respecter la loi, et notamment du ministre chargé de recevoir les dénonciations, de juger de leur recevabilité et de faire des recommandations (art. 46 à 49). Dans l’ensemble du réseau, ceci pourrait mener à certaines dérives, alors que chaque personne se croira autorisée à interpréter à son tour ce qu’est un signe religieux ou ce que sont des conduites, des attitudes, des propos, des comportements ou des décisions non conformes à la laïcité et aux « valeurs québécoises ».
3. Le PL94 et les violations de droits humains
Sabrer dans les droits en l’absence d’un problème avéré
Le PL94 fait suite à une vérification réalisée par la Direction des enquêtes (DE) du ministère de l’Éducation afin de s’assurer du respect des obligations relatives à la Loi sur la laïcité́ de l’État dans 17 établissements d’enseignement appartenant à̀ neuf centres de services scolaires (CSS). Nous sommes loin d’une enquête exhaustive puisque le Québec compte 2 670 établissements publics d’enseignement primaire et secondaire. Le rapport fait état de « différents enjeux concernant les services à visage découvert, l’interdiction de porter des signes religieux et l’affirmation de la laïcité de l’État » (p. 4).
En ce qui concerne les services à visage découvert, les cas mentionnés ne concernent pas les membres du personnel administratif ou enseignant (groupes visés dans la Loi sur la laïcité de l’État) mais plutôt des élèves qui fréquentent ces établissements. Les faits rapportés sont plutôt anecdotiques : une seule élève d’une école secondaire et la rumeur de tois ou quatre autres cas dans le même établissement, mais qui demeurent hypothétiques. Est-ce là un motif suffisant pour réformer en profondeur la Loi sur l’instruction publique ?
En ce qui concerne l’interdiction du port de signes religieux, la vérification a permis de trouver seulement une enseignante suppléante du CSS de Montréal qui portait un hijab. Sans aucune évidence factuelle probante, le rapport de vérification s’est pourtant orienté vers l’élargissement de l’interdiction du port de signes religieux à d’autres catégories de personnel.
La vérification fait également état de rumeurs ou d’informations non-vérifiées sur une école où des élèves s’adonnaient à la prière à l’extérieur des locaux scolaires mais sur le terrain de l’établissement; d’écoles qui louent leurs locaux à des organisations religieuses en dehors des heures d’enseignement; de deux membres du personnel enseignant qui sont des ministres du culte en dehors de leurs heures de travail; de contraventions au code vestimentaire en ce qui concerne les cours d’éducation physique; de membres du personnel enseignant se parlant ou communiquant avec des élèves dans une langue autre que le français; et de certaines incivilités de la part d’élèves lors de présentation de contenus du cours de Culture et citoyenneté québécoise (CCQ).
Pour la LDL, il est hautement problématique que le législateur se saisisse de ces quelques cas pour proposer un projet de loi aux conséquences aussi larges et profondément attentatoire aux droits de l’ensemble de la population québécoise. S’il est vrai que certains de ces cas ont marqué les esprits ou ne se conforment pas aux dispositions du droit en vigueur, il demeure qu’il n’existe pas de problème avéré de manquement à la laïcité au sein du réseau scolaire public au Québec.
Des violations en chaîne des droits humains
Le PL94, tout comme la Loi sur la laïcité de l’État adoptée sous bâillon en 2019, porte atteinte à de nombreux droits humains. En vertu du principe d’interdépendance des droits, chacune de ces violations entraîne des conséquences sur l’ensemble des autres droits. Par souci de concision, nous soulignons ici les entorses les plus explicites à certains droits. Mais il est impératif de conserver à l’esprit que chacune de ces violations a des répercussions sur de nombreux autres droits, qu’il est difficile à ce stade de mesurer pleinement.
En cherchant à imposer des valeurs, des conduites et des attitudes aux différents acteurs du système scolaire québécois, le PL94 s’attaque d’abord, de manière directe et délibérée, aux libertés de conscience, de religion et d’expression. L’interdiction des signes religieux pour le personnel des CSS, les personnes qui se trouvent sur les lieux mis à la disposition par les CSS ou qui fournissent des services aux élèves menace également ces libertés fondamentales, tout en renforçant la discrimination, l’exclusion et la stigmatisation de certains groupes en fonction de leur appartenance culturelle ou religieuse.
Le PL94 institue, dans la loi, une discrimination ouverte et déclarée qui viole le droit à l’égalité et les principes d’universalité et de non-discrimination qui sont au fondement des droits humains. L’exclusion de nombreuses travailleuses et travailleurs du réseau d’éducation public québécois est une attaque frontale au droit au travail qui a des conséquences délétères sur de nombreux autres droits, dont les droits à un revenu suffisant, au logement, à la santé, à l’accès à la culture, à liberté de circulation, et plusieurs autres. En fragilisant le système d’éducation public par l’imposition de contraintes excessives, en établissant une discrimination systémique à l’embauche, en interdisant diverses formes d’accommodements raisonnables et en privant les élèves d’un climat éducatif propice aux échanges interculturels, le PL94 menace à la fois la pérennité de notre système d’éducation public et le droit universel des enfants québécois à l’éducation.
Recommandation 5 : Que le gouvernement du Québec commande une étude pour documenter les impacts de la Loi sur la laïcité de l’État de 2019 sur les violations de droits humains, afin d’anticiper les effets éventuels du PL94.
Quand l’État impose des valeurs, des conduites et des attitudes
Le PL94 vise d’abord à imposer aux acteurs du réseau de l’éducation ce qu’il définit de manière arbitraire et discrétionnaire comme étant les « valeurs québécoises » (terme que l’on retrouve dans 12 articles du projet de loi). Comme la LDL l’a rappelé lors des consultations entourant le projet de loi 84, Loi sur l’intégration nationale : « Nous insistons sur le danger qu’un gouvernement majoritaire, quel qu’il soit, s’arroge le pouvoir arbitraire et discrétionnaire d’édicter un socle de valeurs qui seraient partagées par l’ensemble de la population. Il s’agit-là d’une atteinte grave au droit à l’égalité et aux libertés de conscience et d’expression protégés par les Chartes. » C’est pourquoi nous soutenons que toute politique destinée à renforcer la laïcité de l’État doit viser le respect du droit à l’égalité et des droits de toutes et tous.
Le PL94 contient plusieurs dispositions visant à réguler les propos, les comportements, les attitudes, les conduites et les décisions des gestionnaires et du personnel du réseau de l’éducation et des établissements scolaires afin qu’ils soient conformes aux « valeurs québécoises » et à la « laïcité de l’État ». Ce faisant, le gouvernement s’arroge un pouvoir arbitraire et discrétionnaire qui constitue une entorse inacceptable – et à bien des égards sans précédent – à de nombreux droits énoncés dans la Charte québécoise, notamment à son chapitre premier sur les libertés et droits fondamentaux.
Le PL94 s’attaque aussi à ces droits fondamentaux en fixant des critères arbitraires pour juger des attitudes et comportements des élèves (art. 3, 13, 42). Plutôt que d’imposer des comportements, le projet de loi devrait s’assurer que les élèves reçoivent une formation axée sur la tolérance, le dialogue interculturel et le respect de l’Autre et des droits de toutes et tous.
Recommandation 6 : Que les articles 11, 13, 20, 23, 26-29, 32, 35, 42 et 46 visant à imposer des attitudes, comportements, conduites, propos ou décisions à différents acteurs du réseau de l’éducation publique soient retirés du PL94.
De la discrimination à l’exclusion des femmes musulmanes portant le voile du système d’éducation
Le PL94 renforce également la discrimination fondée sur le sexe et l’identité de genre, car ses dispositions ont des effets principalement sur les femmes portant le hijab. La Loi sur la laïcité de l’État avait institué une ségrégation ouverte en milieu scolaire, en excluant les femmes de confession musulmane portant le voile des corps enseignants. Elle avait également eu pour effet de limiter la mobilité professionnelle des enseignantes musulmanes déjà en poste, ou de forcer leur exode vers les établissements scolaires privés. Le PL94 va plus loin en promouvant l’exclusion de ces femmes des postes en service de garde et soutien en classe. Voilà une forme de discrimination étatique, directe et déclarée, qui nous apparaît hautement attentatoire aux droits. Sous prétexte de s’appliquer à « toutes les religions », le PL94 vise ouvertement ces femmes qui, pourtant, apportent une contribution essentielle à notre réseau d’éducation publique déjà fragilisé.
Le PL94 énonce en plusieurs endroits que « l’égalité entre les femmes et les hommes » fait partie des « valeurs québécoises ». Si tel est le cas, nous rappelons au gouvernement que s’il souhaite réellement favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, il ne devrait pas s’attaquer aux droits et libertés des femmes musulmanes portant le hijab, mais mettre en place des mesures visant à assurer l’autonomie économique des femmes et à lutter contre les diverses formes de discriminations et de violences qui persistent dans nos institutions scolaires[7]. Il devrait également mettre en place des moyens pour favoriser l’insertion en emploi des femmes de toutes les origines et confessions, plutôt que de multiplier les barrières discriminatoires.
Recommandation 7 : Que l’article 32 concernant l’extension de l’interdiction du port de signes religieux soient retirés du PL94 et que le gouvernement s’engage à retirer toute barrière discriminatoire à l’emploi au sein du réseau de l’éducation public québécois.
Un projet de loi qui alimente la xénophobie et le racisme systémique
La LDL ne peut passer sous silence le fait que ce projet de loi est une manifestation de ce qu’on appelle le racisme systémique. En effet, le racisme systémique repose entre autres sur un ensemble de règles ou de pratiques, formelles ou informelles, qui peuvent être neutres en apparence et sans intention raciste, mais qui désavantagent dans les faits de façon disproportionnée des personnes racisées. Dans le cas de la Loi sur la laïcité de l’État et du PL94, nous pouvons parler de racisme institutionnel et de discrimination directe. En effet, loin d’être neutres et d’avoir des effets discriminatoires indirects dans leur application, ces lois ont ciblent de manière délibérée et disproportionnée un groupe social (en particulier les femmes musulmanes portant le voile), ont des effets discriminatoires directs et documentés sur les membres de ces groupes, en plus de contribuer à alimenter les préjugés, la peur de l’Autre (xénophobie), l’islamophobie et le racisme (voir Annexes I et II). Cela nous paraît d’autant plus dangereux que l’application du PL94 pourrait contribuer à instaurer dans les écoles et les milieux de travail un climat de méfiance, de dénonciation et de délation.
Bien qu’elle vise l’ensemble du personnel des CSS, des personnes qui se trouvent sur les lieux mis à la disposition par les CSS et qui sont susceptibles d’être en contact avec des élèves, l’interdiction du port de signes religieux aura un effet beaucoup plus grand sur certains groupes racisés dont la religion peut impliquer des pratiques visibles; des groupes qui sont d’ailleurs souvent déjà affectés par d’autres formes de discrimination et d’exclusion en matière d’emploi, de santé, d’éducation et de représentation. En avalisant des préjugés envers ces minorités, en instituant des règles qui les désavantageant et en engendrant un climat social qui leur est défavorable, le PL94 entérine, perpétue et renforce l’existence du racisme systémique au Québec.
Recommandation 8 : Que le PL94 mentionne l’existence du racisme systémique et qu’il prévoit des dispositions pour lutter contre le racisme et les discriminations directes, indirectes, institutionnelles et systémiques au sein du réseau d’éducation québécois.
Le droit à l’éducation
L’interdiction de porter des signes religieux au travail entraînera l’exclusion ou la réorientation professionnelle de nombreuses personnes, particulièrement des femmes musulmanes portant le hijab, vers d’autres secteurs d’activité ou vers les écoles privées. En plus de porter atteinte à leur droit au travail, au droit à des conditions de travail équitable et à la progression dans leur carrière, aux droits à l’égalité et à la liberté de conscience et de religion, cet exode accentuera la pénurie de personnel qualifié déjà criante dans le réseau public d’éducation. Il soumet également l’ensemble des gestionnaires et du personnel enseignant du réseau d’éducation à un contrôle tatillon pour assurer qu’il se conforme au programme scolaire, ce qui relève de la centralisation administrative ou de la microgestion.
Alors que les ratios dans les classes et les services de garde atteignent des niveaux critiques, écarter des éducatrices ou des aides à la classe en raison de leurs convictions religieuses revient à priver de nombreux enfants d’un encadrement éducatif de qualité, personnalisé et respectueux de leurs besoins. Cela entraînerait des conséquences désastreuses sur la qualité de l’éducation, en contribuant au passage d’un service de garde éducatif à un simple service de surveillance des enfants. Tout cela sans parler des enjeux de sécurité et des risques éventuels de bris de service. Dans ce contexte, il aurait été plus pertinent de miser sur l’inclusion des personnes de toutes croyances, cultures et origines dans le réseau d’éducation, plutôt que de multiplier les barrières discriminatoires à leur intégration.
L’obligation pour les élèves et même pour les parents de recevoir les services à visage découvert (art. 2, 4, 13 , 27-29, 32-34, 41-44) soulève des préoccupations importantes. La LDL n’exprime pas d’opinion sur un vêtement ou un autre, car ce n’est pas son rôle. Par contre, elle s’inquiète que, dans les faits, cette disposition cible spécifiquement un groupe précis, à savoir des élèves musulmanes portant un type de voile qui couvre le visage. Comme il a été nommé précédemment, les élèves fréquentant l’école à visage couvert se comptent sur les doigts d’une main au Québec et il n’existe pas de problème en la matière justifiant de mettre en place une nouvelle législation discriminatoire.
De plus, il est de la responsabilité du législateur d’évaluer les impacts potentiels d’une telle disposition en matière de droits humains : si le résultat s’avère être l’exclusion de ces quelques élèves du système scolaire public, ce serait un échec quant au droit à l’égalité et au droit à l’éducation. Il en va de même pour l’impossibilité qu’un local puisse être utilisé « à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires » (articles 10 et 18) : il convient de s’interroger sur les conséquences d’une interdiction aussi rigide sur l’inclusion de tous les élèves dans le réseau scolaire.
Il convient alors de continuer d’avoir la possibilité d’évaluer si un accommodement est possible et raisonnable, au cas par cas, plutôt que de risquer de déscolariser certains élèves ou d’exclure certains parents, particulièrement des mères, des relations de collaboration avec le personnel scolaire. Il faut avoir l’ouverture de considérer les impacts d’un accommodement comme d’un non-accommodement, et s’intéresser avec acuité à l’exercice du droit à l’éducation des élèves croyants comme de celui des élèves non-croyants. Plutôt que de favoriser l’inclusion sociale de ces personnes, ces dispositions du PL94 auraient pour effet de les exclure davantage de la vie sociale. Il faut chercher à préserver l’inclusion scolaire de l’enfant plutôt que son exclusion.
Le PL94 menace également le droit des enfants à évoluer dans un environnement éducatif tolérant et exempt de discrimination. Plutôt que d’imposer des normes arbitraires pour encadrer les comportements, attitudes, propos ou les valeurs des acteurs du réseau de l’éducation, le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour favoriser la tolérance, l’ouverture à l’Autre, le dialogue interculturel et l’éducation aux droits humains dans nos écoles. La Cour suprême du Canada rappelle d’ailleurs que la tolérance est une condition essentielle à l’intégration scolaire : « Lieu d’échange d’idées, l’école doit reposer sur des principes de tolérance et d’impartialité de sorte que toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de participer. [8]» Dans un autre jugement, elle précise que l’expérience du pluralisme et l’exposition à la diversité à l’école sont fondamentales dans la socialisation des enfants : « C’est à la faveur de telles expériences que les enfants se rendent compte que tous ne partagent pas les mêmes valeurs. On peut soutenir que l’exposition à certaines dissonances cognitives est nécessaire pour que les enfants apprennent ce qu’est la tolérance. [9]»
De plus, l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Québec est lié, stipule que « l’éducation de l’enfant doit viser à [lui inculquer] le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ». Ainsi, nous croyons qu’il est essentiel d’exposer les élèves aux multiples formes de diversités qui existent dans nos sociétés, y compris les diversités culturelles et religieuses.
L’UNESCO, une institution spécialisée de l’ONU qui travaille notamment à la promotion du droit à l’éducation, rappelle régulièrement le fait que l’éducation à la tolérance, au pluralisme et aux droits humains fait partie intégrante du droit à l’éducation. Dans plusieurs conventions et déclarations, elle souligne que l’éducation interculturelle, l’expérience du pluralisme, l’ouverture à l’Autre et le respect du principe de non-discrimination sont aux fondements du droit à l’éducation et de la mission de socialisation de l’école. Ce principe a notamment été entériné lors de la Conférence générale de l’UNESCO de 1995 : « L’éducation doit développer la capacité de reconnaître et d’accepter les valeurs qui existent dans la diversité des individus, des sexes, des peuples, des cultures, et de développer la capacité de communiquer, partager et coopérer avec « l’autre ». [10]»
L’interdiction du port de signes religieux constitue un obstacle à la création d’un système d’éducation pluriel et fondé sur la tolérance et la promotion du vivre-ensemble. En cherchant à imposer des valeurs aux différents acteurs du réseau de l’éducation, le PL94 s’inscrit en faux par rapport à ces principes fondamentaux du droit à l’éducation.
De même, l’imposition de l’usage unique du français « pour les membres du personnel d’un centre de services scolaire francophone et pour les personnes appelées à œuvrer auprès d’élèves » (art. 36) constitue un obstacle supplémentaire à l’universalisation du droit à l’éducation. Plusieurs études démontrent en effet que l’usage des langues maternelles par et pour les élèves, à des fins pédagogiques, constitue un outil précieux pour favoriser leur apprentissage du français, leur socialisation, leur adaptation et leur intégration au milieu scolaire. Interdire de manière unilatérale et tous azimuts l’usage d’une autre langue que le français dans le réseau scolaire francophone constitue une entrave au droit à une éducation accessible, inclusive et adaptée.
Plus largement, nous déplorons que le PL94 adopte une logique coercitive et punitive plutôt que de proposer des politiques favorisant les relations interculturelles et l’éducation à la tolérance et aux droits humains. En instituant diverses formes de discriminations fondées sur les croyances religieuses et en s’attaquant aux libertés de conscience, de croyance et d’expression, il crée un climat défavorable à un vivre-ensemble harmonieux. Il risque par ailleurs d’installer une ambiance délétère de méfiance, de surveillance et de dénonciation susceptible d’alimenter les tensions sociales.
Recommandation 9 : Que le gouvernement québécois mette en place ou renforce les programmes visant à favoriser la tolérance, l’ouverture à l’Autre, le dialogue interculturel et l’éducation aux droits humains dans les écoles du Québec.
Recommandation 10 : Que l’article 36 sur l’usage exclusif du français dans le réseau d’éducation public francophone soit retiré du PL94.
Clauses dérogatoires : un aveu de violation des droits humains
En dernier lieu, nous dénonçons la façon cavalière dont le gouvernement actuel utilise, de manière abusive et répétée, les clauses dérogatoires prévues aux Chartes canadienne et québécoise. Nous voyons dans cet usage préemptif et tous azimuts un aveu, de la part du gouvernement, que ses lois en matière de laïcité sont attentatoires aux droits humains, contreviennent aux Chartes et ne passeraient pas le test des tribunaux. Cela nous paraît d’autant plus problématique que la Loi sur la laïcité de l’État et l’usage préemptif des clauses dérogatoires font actuellement l’objet d’une contestation judiciaire devant la Cour suprême.
Le recours de plus en plus systématique aux clauses dérogatoires contrevient aux obligations de l’État québécois en vertu du droit international des droits humains. En effet, le droit international est très exigeant quant aux critères qui peuvent justifier de déroger aux droits et libertés, et extrêmement clair à l’effet que de telles pratiques doivent demeurer temporaires et exceptionnelles. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Canada et le Québec sont liés depuis 1976, énonce parmi les conditions à respecter : qu’un « danger public menaçant la vie de la nation » doit exister pour envisager une dérogation aux droits ; que toute mesure dérogatoire doit demeurer proportionnelle à ce que la situation exige et être temporaire ; que toute dérogation doit respecter le principe de non-discrimination. Certains droits sont intangibles, c’est-à-dire qu’on ne peut en aucun cas y déroger, et c’est le cas notamment de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégées par l’article 3 de la Charte québécoise. Les récents recours aux clauses dérogatoires, par le gouvernement de la CAQ, contreviennent à toutes ces conditions d’exceptionnalité.
La LDL rappelle enfin que l’utilisation des clauses dérogatoires n’est pas seulement dangereuse pour certains groupes, mais qu’elle menace les droits de l’ensemble de la population québécoise. C’est pourquoi elle réclame le retrait pur et simple des mentions relatives aux clauses dérogatoires dans le projet de loi 94, tout en insistant sur la nécessité de s’assurer que ce dernier puisse être soumis à l’examen critique des tribunaux. Cela est d’autant plus crucial que la laïcité de l’État doit servir à garantir les droits inscrits dans nos chartes, et non de prétexte pour violer ces droits.
Recommandation 11 : Que les articles 40 et 45 qui touchent l’utilisation préemptive des clauses dérogatoires prévues aux chartes canadienne et québécoise soient retirés du PL94.
Conclusion
Soulignons enfin que, devant l’ampleur de la portée du projet de loi 94 et des modifications qu’il compte apporter à la Loi sur l’instruction publique, il est impératif que le gouvernement fasse une véritable étude des enjeux et retombées possibles de ce projet de loi et qu’il tienne des consultations publiques, générales et inclusives avant son adoption. Il est également crucial que, dans le cadre de l’étude détaillée, le PL94 soit analysé à l’aune des obligations du gouvernement québécois en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et des normes du droit international des droits humains.
Recommandation 12 : Considérant les transformations majeures qu’il apporte à la Loi sur l’instruction publique, que le PL94 fasse l’objet de consultations publiques larges, ouvertes et inclusives, et ce, avant son adoption.
ANNEXE
Témoignages de personnes ayant subi les conséquences de la Loi sur la laïcité de l’État, recueillis entre le 4 et le 7 avril 2024
*Tous les noms employés sont des noms fictifs
J’étais enseignante dans mon pays depuis 2010.
Venue au Québec je voulais continuer parce que c’est ma vocation.
C’est un travail que j’adore.
J’ai fait mes quatre ans de bac à l’UQAM pour pouvoir enseigner ici.
Pendant mon bac, j’ai bien réussi, j’ai eu trois fois la bourse d’excellence du ministère, j’ai reçu en tout 22 500 dollars en bourses.
J’étais pleine d’espoir.
Mais au milieu de mes études, la Loi 21 est votée. Ça a été dévastateur.
Avec mes amies on formait un grand groupe: Maghrébines, Libanaises, et tout.
On a commencé ensemble à l’Université.
Après la Loi 21, une à une, mes amies voilées lâchent le bac.
À la fin on est deux.
Pour la dernière étape du baccalauréat, on doit faire un stage dans une classe.
L’école où j’ai fait mon stage était très bien, et comme pendant le stage je pouvais garder mon voile, tout s’est bien passé.
Le directeur voulait m’embaucher en me donnant la classe de mon enseignante- associée et la libérer pour qu’elle devienne une enseignante ressource.
Pour ce travail je devais enlever le voile.
C’était vraiment un dilemme.
Comme j’étais très familière avec le milieu je me suis dit:
« Je ne vois le directeur que 5 minutes par semaine. Avec les enfants, il n’y a pas de problème. Je vais prendre le risque, je pourrai mettre mon chapeau dehors, je vais faire ça ».
Pendant deux mois j’ai essayé de me plier à la Loi 21.
Je venais à l’école à six heures et demie le matin pour que personne ne me voie enlever mon voile avant de rentrer.
Devoir enlever mon voile c’est la chose la plus humiliante que j’ai vécue dans ma vie.
(Nadia pleure)
C’était tellement dur même si personne ne me voyait, c’était humiliant
Moi devant la porte de l’école…
Enlever mon voile pour franchir la porte…
Les autres femmes entrent et ne doivent pas enlever un vêtement.
Moi j’enlève un vêtement que je porte depuis l’âge de14 ans par choix.
Quand j’ai décidé de porter le voile, mon papa n’était pas content de moi, il ne m’a pas parlé pendant deux semaines. Personne ne m’a jamais obligée de le porter. C’est moi qui voulais le faire.
Je me suis dit: je n’ai pas fait mon deuxième bac pour rien, je dois essayer d’enseigner sans voile dans cette classe.
Tous les jours, j’enlevais mon voile. Tous les jours.
J’ai fait un grand projet avec mes élèves. Nous avons invité les parents en classe pour qu’ils voient le grand travail qu’on a fait.
On a eu une rencontre. C’est là que j’ai vu que je n’étais pas prête à être avec les parents sans mon voile.
Je suis encore marquée par cette rencontre-là.
Alors qu’on devait célébrer nos efforts avec mes élèves, j’étais vraiment sombre. Ça a été un jour très sombre dans ma vie.
Après j’ai consulté parce que j’étais en dépression. J’ai pris des antidépresseurs. L’expérience avait été trop dure et humiliante.
Maintenant je travaille. Pendant l’été j’ai trouvé un poste dans une école privée.
C’est un endroit exceptionnel.
Je suis bien entourée, je suis heureuse dans mon travail.
Sauf que c’est mon seul choix. Alors qu’il y a beaucoup de postes ouverts pour des enseignantes.
J’aurais pu travailler à deux pas de chez nous, dans n’importe quelle école de mon choix, je suis encore sur les listes d’employés du Centre de services scolaires de mon coin. Il y avait une école tout près…mais ils ne m’auraient pas prise avec mon voile.
Tout le monde a le choix de son école. Mais pas moi.
Pourquoi on restreint mes choix, juste à cause d’un vêtement?
Avec les élèves, mon enseignement est neutre. Je ne suis pas là pour les convertir.
Mon poste n’est pas permanent parce que je remplace une prof qui prend un long congé. Si elle revient? Elle a l’ancienneté, je pourrais perdre mon travail l’année prochaine.
Je ne vis pas à Montréal. Je ne peux pas me déplacer tellement loin pour trouver une autre école privée.
Souvent je pense: l’an prochain, est-ce que je vais continuer à avoir mon poste?
Tout le plaisir que j’ai avec mes élèves quand j’enseigne… c’est menacé. L’enseignante que je remplace pourrait revenir.
Je ne sais pas si l’année prochaine j’aurai un contrat permanent. Je n’ai pas d’ancienneté.
Hier j’ai eu une supervision avec ma directrice. Elle est venue dans ma classe comme elle le fait deux fois par année dans toutes les classes.
Elle est venue m’observer
Hier elle m’a dit: “Vous avez les meilleurs ateliers de l’école.
Je suis dans l’enseignement depuis 20 ans.
Jamais je n’ai vu une enseignante pousser à ce point le niveau des ateliers en classe de deuxième année.”
J’étais fière, mais en même temps: si je suis si bonne pourquoi je ne suis pas acceptée dans le système public?
L’année prochaine je devrai peut-être travailler à Tim Horton ou je ne sais pas où… Si je perds le poste que j’ai, je ne pourrai pas en trouver un autre.
Il y a toujours ce fond sombre dans le futur.
Si je n’ai pas quelque chose de permanent et s’il arrive quelque chose à cette école et je dois changer…
Tout le monde a le choix: on peut changer d’école, on peut changer de centre de services scolaires.
Moi je n’ai pas le choix, les portes sont fermées.
J’adore mon travail, j’aimerais continuer.
Pendant mes deux ans d’enseignement j’ai donné le cours français ECR (Éthique et culture religieuse), personne ne s’est plaint de mon manque de neutralité ou je ne sais quoi…
J’ai une clientèle qui n’est pas très diversifiée, mes classes sont moins diversifiées qu’à Montréal, pourtant personne ne s’est plaint de mes compétences, de ma neutralité.
Donc pourquoi on fait de mon foulard, de mon vêtement, une espèce d’ogre ou de monstre dangereux pour mes élèves?
Je ne suis pas dangereuse pour les élèves, Monsieur Legault.
À chaque fois je pense à ça quand j’enseigne ECR. Vraiment.
Je suis arrivée au Canada en juin 2022, bien motivée par la facilité de trouver un emploi en formation professionnelle pour les adultes. Mes 12 ans d’expérience devaient être suffisants pour justifier ma compétence. La décision d’immigrer au Canada ou de retourner en France, où je suis née, a bien sûr été influencée par le choix du pays qui valorise la diversité et le respect des droits de l’homme. Cependant, mon expérience ici a été assombrie par la discrimination que j’ai rencontrée en raison de ma foi.
En participant à une formation en intégration professionnelle, j’ai été choquée d’entendre un formateur suggérer que je devrais envisager d’enlever mon hijab pour améliorer mes perspectives d’emploi. Pour moi, le hijab va bien au-delà d’un simple signe religieux ; c’est une expression de ma liberté personnelle et de mes convictions les plus profondes. J’ai refusé de compromettre ma dignité et ma foi pour trouver du travail.
Malgré ma compétence et ma motivation, j’ai été confrontée à de multiples refus d’emploi en raison de ma décision de porter le hijab. La loi 21 a rendu encore plus difficile pour moi de trouver un emploi dans mon domaine, même si j’ai les qualifications nécessaires et une passion pour l’enseignement.
En octobre 2023, mon enseignant en formation professionnelle a relevé ma compétence et mon talent pour l’enseignement et m’a référé. Lors d’un entretien de confirmation pour un emploi de formatrice, on m’a expliqué que je suis excellente, mais que je dois enlever mon hijab pendant les cours aux adultes !!! Ironiquement, mon frère, avec ses 3 ans d’expérience dans l’enseignement, a été admis et travaille depuis décembre avec beaucoup de plaisir. Pour la première fois de ma vie (42 ans), je vis une discrimination homme-femme aussi flagrante qui me touche directement, et au Canada, le pays des libertés et égalités!!
Mon expérience n’est malheureusement pas isolée. J’ai rencontré N, une femme courageuse qui a dû quitter sa ville natale bien-aimée en raison de son choix de porter le hijab, ce qui lui a coûté plusieurs opportunités de carrière. Son histoire est un rappel poignant des défis auxquels sont confrontées les femmes qui choisissent de vivre leur foi de manière visible dans une société qui prône l’inclusion et la diversité.
De même, j’ai rencontré J, une Québécoise convertie, qui a été contrainte de déménager à Ottawa avec sa famille après avoir été confrontée à des obstacles insurmontables en raison de sa décision de porter le hijab. Le désir de sa fille de devenir enseignante a été compromis par les préjugés discriminatoires contre le voile, illustrant ainsi l’impact dévastateur de la loi 21 sur les aspirations professionnelles des individus.
S, mon amie sénégalaise enseignante avant la loi 21, ne peut pas évoluer dans sa carrière en raison d’un sentiment de racisme envers une femme de couleur qui se rajoute au fait qu’elle porte le hijab. Mère de deux filles et un garçon, elle pense aussi devoir quitter le Québec dans les prochaines années, elle préfère garder l’anonymat de peur de représailles, dans un pays de droit !!
F, une Marocaine, s’est vu offrir des heures comme éducatrice dans une école primaire. Cependant, on lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas effectuer de suppléances (ce qui lui offre un travail plus valorisant et mieux rémunéré) car elle porte le hijab. Cette restriction est d’autant plus difficile à comprendre lorsque l’on considère que ce sont les mêmes enfants qu’elle côtoie, que ce soit en classe ou dans la cour d’école, elle pense aux perspectives de carrière de sa fille de 15 ans avec crainte.
Y, une jeune étudiante très contente de la possibilité de faire des suppléances comme ses amies pour avoir un peu d’argent, mais encore une fois son hijab lui interdit d’être comme toutes les jeunes filles et limite ses choix.
NB : Que les écoles souffrent d’une grande pénurie d’enseignantes et enseignants.
Avec la loi 21, beaucoup de femmes m’ont exprimé qu’elles sentent de plus en plus l’islamophobie, comme si la loi avait éveillé une méfiance qui n’existait pas ou pas autant qu’aujourd’hui.
D, Algérienne nous venons de finir une formation, son stage refusé après un échange de courriel exprimant sa compétence et l’accord de stage possible après une entrevue, mais lorsqu’elle s’est présentée avec son hijab, le langage a changé et le stage annulé sans trop d’explication.
En tant que mère, l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir au Canada était de donner à mes enfants la possibilité de grandir dans un environnement diversifié, où ils seraient exposés à toutes les cultures et religions. La loi 21 va à l’encontre de cet idéal, en privant nos enfants de la richesse de la diversité et de la possibilité de développer une ouverture d’esprit et une compréhension interculturelle essentielles pour vivre harmonieusement dans une société pluraliste.
La loi 21 est en désaccord flagrant avec les principes de liberté individuelle et d’égalité des droits. Elle prive les individus de leur droit fondamental à pratiquer leur religion et à exprimer leur identité culturelle sans crainte de discrimination ou de représailles. En imposant des restrictions sur les signes religieux, cette loi perpétue une forme insidieuse de préjudice qui marginalise les minorités religieuses et nie leur droit à la pleine participation à la société.
Les lois sont essentielles pour organiser une société et permettre aux gens de vivre en harmonie et dans le respect mutuel. Cependant, il est crucial de reconnaître que les lois d’un pays ne peuvent pas rester figées dans le temps. Chaque société évolue, et les lois doivent évoluer en conséquence pour refléter les valeurs et les aspirations changeantes de ses citoyens. Le Canada, en tant que pays d’immigration, est une terre de diversité et de multiculturalisme, où la richesse culturelle est célébrée et valorisée.
Dans cette optique, le principe du vivre ensemble ne peut être pleinement réalisé si des lois discriminatoires, telles que la loi 21, persistent et limitent la liberté des individus en raison de leur religion ou de leurs convictions personnelles. Une loi peut être appliquée, mais cela exige également du courage et de l’ouverture d’esprit pour la remettre en question si elle cause des dommages ou engendre des victimes. Chaque être humain a le droit d’être entendu et respecté, et il est de notre devoir de défendre les droits fondamentaux de tous les membres de notre société, sans exception.
Nour, Gatineau le 7 avril 2024
« Témoignage d’une femme libre »
Immigrée ici depuis 12 ans, je suis venue au Canada avec mon mari par envie de vivre dans un pays libre, et où les choix de chacun sont respectés. Nous avons choisi le Québec, foyer de notre langue maternelle, pour pouvoir s’intégrer rapidement.
J’ai toujours aimé l’enseignement, j’ai décidé donc de changer de carrière, à 31 ans, pour pouvoir m’épanouir encore plus. Après 4 ans à l’université, j’intègre enfin le marché du travail. Mais quelques semaines à peine après, la sentence tombe. Je dois choisir entre ma propre liberté ou le choix que l’on m’oblige à faire. Je dois choisir entre mes convictions les plus profondes ou le métier que j’ai toujours rêvé de faire. Je dois choisir entre me sentir moi-même ou faire semblant d’être une autre. Je dois choisir entre mon bonheur ou satisfaire la curiosité des autres.
De grandes questions se répètent jour après jour dans ma tête. Est-ce le pays « libre » que j’ai choisi ? Est-ce la liberté de « tous » qui compte, ou seulement celle des autres ? Pourquoi pensent-ils que je ne suis plus assez compétente dès que je porte un voile sur ma tête ? N’est-ce pas ce qu’il y a dans la tête et non sur la tête qui compte ? Je vois toutes les libertés que l’on offre, que l’on défend et que l’on donne aux autres. La mienne n’a-t-elle aucune valeur à leurs yeux ? Ils disent qu’avec mon voile et mon travail, je risque d’exercer un certain pouvoir sur les autres. Ne sont-ils pas en train d’exercer leur pouvoir et leur dictature sur moi ainsi ?
Mon choix était fixé. Je ne donne ma propre liberté à personne. J’ai quitté pays, famille, amis, enfance, souvenirs dans l’espoir de vivre librement. Je choisis donc le bon sens, la logique et la justice, et je laisse derrière moi l’ignorance, les faux préjugés et l’injustice. Je me choisis moi, ma liberté, mes convictions et ma santé mentale. C’était loin d’être un choix facile : 4 années d’université perdues, des années de travail et d’acharnement, en essayant de concilier famille, enfants et études, une dette d’études de plus de 30 000 $, et l’espoir d’exercer une profession que j’affectionne tellement et où j’aurais pu tellement donner à la société. Mais malheureusement, je ne pouvais abandonner ce qui faisait de moi « moi ».
Mon expérience n’est certainement pas la seule qui existe. D’autres personnes ont subi assurément le même sort que moi. Nous n’avons qu’un seul espoir, que l’on comprenne que « toutes » les libertés comptent, et que c’est uniquement l’incompréhension et la non-connaissance de l’autre qui génèrent une telle crainte. Je garde espoir que les générations futures n’auront pas à faire de tels choix, et que le Canada restera le pays libre que tout le monde connaît et envie.
M.R.
Quand t’es née et que t’as grandi toute ta vie au Québec, où on t’a appris à l’école que c’est nos différences qui font notre richesse avec « Vers le Pacifique » ou le cours d’Éthique et culture religieuse, quand on te répète depuis toujours que le Québec est une terre d’accueil, qu’on a besoin de personnes comme toi pour le rendre encore plus beau et inclusif, qu’on est chanceux de t’avoir…
Tu crois à l’égalité des chances, tu vois le monde en couleurs, tu es fière d’être Québécoise, tu te dis que tout est possible ici! Et là, après avoir enfin fini tes études en enseignement, toute motivée, toute passionnée… PAF! On te sort cette loi 21 dégueulasse, on ne te questionne pas sur tes compétences ou tes études dans les entrevues non… mais plutôt si tu peux enlever ton voile avant d’entrer à l’école? Tout bêtement comme ça. Comme si t’enlevais un simple collier ou une casquette bidon…
Tu sens que tu dois t’effacer dans ton identité pour être acceptée, et même avec la clause grand-père tu te sens comme un fardeau qu’on doit tolérer, et ta sécurité d’emploi n’est pas garantie, tu ne peux pas te développer dans le domaine ! Bon ben tant pis, their loss! Le système d’éducation manque cruellement de profs tellement elles démissionnent en quantité alarmante… et c’est les élèves les plus grands perdants malheureusement.
Ce Québec et son islamophobie me révoltent.
Le Québec n’a plus aucune leçon sur la diversité et l’inclusion à me donner.
[1] Ligue des droits et libertés, Comprendre la laïcité, juin 2019, p. 2.
[2] Milot, Micheline, « La laïcité : une façon de vivre ensemble », Théologiques, vol. 6, no 1, 1998, p. 13.
[3] Bouchard, Gérard et Charles Taylor, Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation – Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Gouvernement du Québec, 2008, p. 141.
[4] Bouchard, Gérard et Charles Taylor, op. cit., p. 140.
[5] Bosset, Pierre, L’accommodement raisonnable du bon et du mauvais usage des mots. La culture publique commune: du contrat moral à l’accommodement raisonnable, CDPDJ, 2007.
[6] Milot, Micheline, « École et religion au Québec : une laïcité en tension », Spirale. Revue de recherches en éducation, n°39, 2007, p. 174.
[7] Girouard, Catherin, « L’école, un lieu sécuritaire pour les filles? », La Gazette des femmes, 24 mai 2024.
[8] Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, 1996, 1 R.C.S. 825, par. 42.
[9] Chamberlain c. Surrey School District 36, 2002 CSC 86 aux paragraphes 65 et 66.
[10] Cadre d’action intégré concernant l’éducation pour la paix, les droits de l’homme et la démocratie, entériné par la Conférence générale de I’UNESCO à sa 28e session, Paris, 1995.