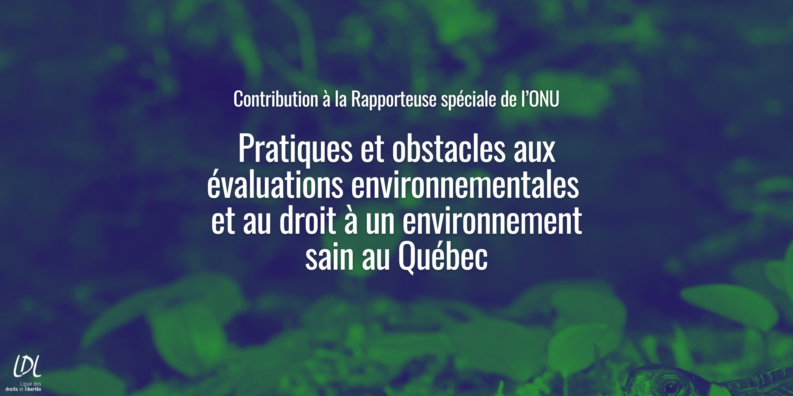Contribution dans le cadre des
Évaluations des incidences sur l’environnement, évaluations stratégiques des incidences sur l’environnement et droit à un environnement propre, sain et durable
Par la Ligue des droits et libertés
Pratiques et obstacles aux évaluations environnementales et au droit à un environnement sain au Québec
LIRE EN PDF
Présentée à la
Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’environnement
15 avril 2025
Table des matières
Participation du public aux processus décisionnels
Pratiques menant à l’évitement des audiences du BAPE
Introduction
Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est une organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, qui vise à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits humains. La LDL aborde depuis les années 1970 les relations étroites existant entre les droits humains et l’environnement. Plus récemment, elle concentre ses efforts pour faire connaître les piliers démocratiques du droit à un environnement sain dans les contextes québécois et canadien.
La transition menace d’être mise en place sans tenir compte de ces dimensions démocratiques, ni des droits humains. Les récentes années au Québec ont plutôt montré une tendance qu’ont les gouvernements et les élites économiques à passer outre les processus démocratiques, y compris les études et évaluations d’impacts environnementaux, afin d’accélérer la mise en place de projets dommageables pour l’environnement et le climat, souvent en prétextant la « transition ».
Dans cette brève contribution destinée à la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’environnement des Nations Unies, Astrid Puentes Riaño, nous proposons un survol des enjeux concernant les processus d’évaluation environnementale des projets, les obstacles aux piliers démocratiques du droit à un environnement sain et quelques exemples québécois récents qui illustrent ces enjeux.
Étant donné l’ampleur des compétences relevant du provincial en matière environnementale, notre propos se concentre sur les enjeux dans la province du Québec, bien que d’importants enjeux existent également sur le plan fédéral (Canada). Notons que ni le Québec[1] ni le Canada n’ont ratifié la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus). La LDL, à l’instar de certains rapporteurs spéciaux, considère que le partage des compétences propre au contexte fédératif canadien n’a pas à occulter les obligations qui incombent à tous les paliers de gouvernement en matière de droits humains.
Participation du public aux processus décisionnels
Créé dans les années 1970, le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) est un élément incontournable du régime québécois de protection de l’environnement et constitue un forum très important pour la participation du public aux processus décisionnels. Le BAPE examine la faisabilité, les risques et les impacts environnementaux des projets, entend les citoyen-ne-s et communautés concernées, exige le dépôt de certains documents par les promoteurs de projet, etc.
Il constitue par le fait même un forum très important permettant souvent aux citoyen-ne-s d’obtenir de précieuses informations sur un projet et d’exprimer publiquement leurs préoccupations, en plus d’attirer l’attention des médias. Le BAPE permet souvent d’accéder à des informations d’une grande importance, concernant l’environnement ou la santé publique, contribuant à l’exercice du droit à l’information des citoyen-ne-s.
L’asymétrie de ressources entre les parties qui se présentent devant le BAPE se répercute durant les audiences. Les promoteurs de projets, par exemple une société minière, sont souvent dotés de vastes moyens financiers, d’avocat-e-s, de lobbyistes et de spécialistes en communications. Les citoyen-ne-s et petites organisations communautaires, pour leur part, doivent mettre des dizaines ou centaines d’heures bénévoles pour préparer adéquatement leur participation au BAPE dans des délais extrêmement serrés, ce qui soulève un certain enjeu d’iniquité dans la participation aux processus.
Après les audiences, le BAPE rend ses conclusions publiques et formule ses recommandations au gouvernement. Cependant, il appartient au ministère de l’Environnement de décider d’en tenir compte ou non, et d’octroyer les permis nécessaires pour la réalisation du projet concerné. Autrement dit, au Québec, le BAPE est un mécanisme d’exercice démocratique important, le principal forum permettant la participation du public aux processus décisionnels, mais n’a pas de caractère contraignant. Si les conclusions de ce forum sont susceptibles d’être catégoriquement et entièrement ignorées par le gouvernement au pouvoir, ce caractère non contraignant est donc un enjeu majeur.
Pratiques menant à l’évitement des audiences du BAPE
Il existe aussi des pratiques permettant que le BAPE soit évité ou contourné de sorte qu’un projet n’y soit pas assujetti. La Loi sur la qualité de l’environnement établit certains seuils au-delà desquels un projet doit automatiquement faire l’objet d’un BAPE.
Le morcellement des projets consiste à diviser un projet d’envergure en plusieurs sous-projets ou phases, chacun considéré de manière indépendante. Cette approche permet à une entreprise de rester en dessous des seuils réglementaires qui rendraient le projet assujetti à une évaluation complète par le BAPE. Résultat : des projets potentiellement lourds de conséquences environnementales échappent à une analyse globale, privant ainsi les citoyen-ne-s et les expert-e-s d’une vision d’ensemble et d’anticiper les effets à long terme sur les milieux naturels, la biodiversité, et les communautés locales.
Le morcellement d’un projet de gazoduc à Saguenay, au Québec, a ainsi suscité de vives inquiétudes, car il empêchait le BAPE d’examiner l’impact réel du projet. Des promoteurs projetaient de construire un gazoduc voué à alimenter en gaz naturel une zone industrialo-portuaire comprenant une nouvelle usine de transformation de minerais. Le fait de tenir une procédure d’évaluation environnementale distincte pour chaque infrastructure directement liée au projet était non seulement incohérent vu l’interdépendance de ces diverses infrastructures, mais ne permettait pas d’appréhender globalement les impacts sur l’environnement et d’en informer la population.
À d’autres occasions, ce sont ces seuils eux-mêmes qui sont modifiés par voie réglementaire, permettant ainsi au projet d’éviter le BAPE. Ce fut le cas quand le gouvernement autorisa le projet Northvolt, qui devait implanter un vaste projet d’usines de batteries électriques dans la région de la Montérégie au Québec. Ce projet devait s’étendre sur un vaste terrain comprenant plusieurs composantes majeures : la fabrication de cellules de batteries, le recyclage de matériaux, les infrastructures de transport, le traitement des eaux, etc. Le site ciblé comprend notamment 52 hectares de milieux humides d’intérêt, 70 hectares de terres agricoles, ainsi que des espèces menacées.
En 2023, le gouvernement du Québec donna le feu vert et investit abondamment dans le projet de Northvolt, arguant que le développement de la « filière batterie » au Québec doit être au cœur de la transition énergétique. Northvolt a procédé à une division du projet en phases distinctes, traitées séparément au niveau réglementaire. Au lendemain de son dépôt, le ministère de l’Environnement a décidé d’étudier et d’approuver le projet morceau par morceau, échappant à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement dans son ensemble.
En 2023, le premier ministre François Legault statua que l’examen du projet par le BAPE ne s’appliquait pas. Il se trouve qu’une modification à la réglementation du BAPE avait été adoptée discrètement huit mois auparavant, permettant à Northvolt de se soustraire à l’exercice des audiences publiques. Le seuil de production de cathodes requis pour un examen du BAPE avait alors été rehaussé de 50 000 tonnes à 60 000 tonnes, alors que la future usine prévoit en produire 56 000 tonnes. Le gouvernement soulignait également que de tenir des audiences du BAPE prendrait trop de temps et ferait perdre des opportunités économiques.
L’accès à l’information
Au Québec, l’accès à l’information environnementale est prévu par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès) et la Loi sur la qualité de l’environnement.
L’accès à des informations détenues par des organismes publics peut être demandé par exemple concernant les contaminants rejetés dans l’environnement, ou encore les renseignements et évaluations soumises par des promoteurs pour obtenir une autorisation ministérielle. Mais cet accès est souvent limité ou refusé en vertu de divers motifs de refus prévus par la loi. Par exemple quand les informations demandées concernent un « tiers », y compris une entité industrielle ou commerciale, sont réputées violer le secret industriel, nuire à la compétitivité, entraver la négociation d’un contrat ou encore, de causer une perte financière. On comprend rapidement que l’ampleur des motifs de refus constitue un obstacle majeur au droit à l’information, et qu’il conviendrait de réviser ce qui doit être considéré comme étant d’intérêt public, en matière environnementale.
L’autre obstacle majeur est le temps que requiert le processus. À Rouyn-Noranda, au Québec, la Fonderie Horne de métaux lourds de l’entreprise Glencore est en activité depuis des décennies, et l’opacité règne quant aux impacts environnementaux et sur la santé des populations environnantes. Étant donné les taux anormalement élevés de cancer chez les gens, les organismes locaux se mobilisent depuis plusieurs années. Alors que Glencore jouit de seuils plus élevés que dans le reste de la province du Québec, des acteurs locaux et nationaux exigent que les seuils maximaux d’émissions de contaminants exigibles à la Fonderie Horne soient les mêmes que dans le reste de la province.
En 2019, alors que la Fonderie Horne et le gouvernement étaient en train de renégocier les taux de contaminants permis, une annexe fut retirée d’un rapport de la santé publique, car elle contenait des informations graves sur les cancers du poumon touchant les habitant-e-s de Rouyn-Noranda. Glencore ne rend pas publiques les informations essentielles et refuse de les communiquer lorsqu’elles lui ont été exigées.
En 2020, un citoyen demandait l’accès aux données sur les différentes émissions atmosphériques provenant de la Fonderie Horne pour l’année précédente. Glencore s’opposa. L’information fut finalement rendue accessible au citoyen, trois ans après sa demande d’accès, à la suite d’une décision judiciaire.
Au Québec, force est de constater qu’en matière environnementale, l’opacité constitue la règle plutôt que l’exception. Pour exercer leur droit à l’information, les citoyen-ne-s et organismes de la société civile doivent déployer des efforts parfois considérables, alors que le gouvernement devrait tendre à adopter des modes de divulgation proactive des informations, d’autant plus que les technologies actuelles facilitent de telles techniques.
D’ailleurs, une modification de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit depuis 2017 la mise en place d’un registre public d’informations environnementales, qui permettrait d’accéder aux autorisations ministérielles octroyées pour des projets, et aux conditions qui y sont rattachées. Mars 2025 a marqué la 7e année d’inaction du gouvernement pour la mise en place du registre, malgré qu’il soit prévu par l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et exigé haut et fort par de nombreux groupes environnementaux. L’organisme Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) a d’ailleurs intenté une poursuite contre le gouvernement du Québec en décembre 2024 en raison de la non-création de ce registre. Le CQDE soulignait alors que « cet outil permettrait aux citoyen-ne-s, aux communautés, aux organismes, aux médias et aux municipalités notamment de mieux comprendre et surveiller les enjeux environnementaux » et que l’absence du registre constitue un échec démocratique[2].
Dans ce contexte où le registre public n’existe toujours pas et où l’accès à l’information environnementale rencontre de nombreux obstacles, les audiences du BAPE permettent de faire ressortir au grand jour des informations précieuses sur les projets envisagés et dont les impacts environnementaux doivent être étudiés rigoureusement. Ainsi, malgré le caractère non contraignant des recommandations émises par le BAPE et les autres limites soulignées précédemment, une absence de BAPE pour certains projets représente un recul encore plus marqué du droit à l’information et de la possibilité pour le public de participer aux processus décisionnels.
Accès à la justice
Au Québec, le droit à « vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité » est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec depuis 2006, « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi ». Concrètement, cette limitation en fait un droit qui n’est pas justiciable. Il s’agit d’un important obstacle pour l’accès à la justice, puisque les citoyen-ne-s ne peuvent pas saisir les tribunaux en vertu de la Charte québécoise lorsque leur droit à un environnement sain est bafoué.
D’autres recours judiciaires existent, et des améliorations ont été apportées dans les dernières années, permettant d’élargir l’accès aux tribunaux pour les individus et les organisations en matière environnementale. Des recours en injonction existent également, bien que les critères pour s’en saisir soient très exigeants.
Cependant, même lorsqu’un enjeu environnemental parvient à être porté devant les tribunaux, l’obstacle des ressources financières se présente avec acuité. Les coûts sont importants, particulièrement lorsqu’une expertise technique ou scientifique est requise ou que les démarches judiciaires durent parfois très longtemps. La disparité des moyens entre les défenseur-e-s de l’environnement, et l’entreprise promotrice d’un projet susceptibles de porter atteinte à l’environnement est importante. Depuis les années 1990, des groupes demandent la création au Québec d’une structure permettant de rendre des dossiers en environnement admissibles à une forme d’aide juridique afin d’améliorer l’accès à la justice en matière environnementale.
Finalement, il arrive que le gouvernement en place légifère dans le sens de limiter l’accès à la justice pour un projet spécifique, comme ce fut le cas tout récemment.
À Blainville, au Québec, l’entreprise Stablex projetait récemment d’ajouter une sixième cellule d’enfouissement à son site d’enfouissement de déchets dangereux. Cet agrandissement génère d’importantes contestations sociales depuis quelques années, car il se trouve à proximité des habitations et soulève des enjeux environnementaux majeurs pour Blainville et pour le bassin versant dont fait partie cette municipalité. En 2023, le BAPE tenait des audiences sur ce projet d’agrandissement du site et recommandait au gouvernement de ne pas octroyer les autorisations pour un tel projet.
En 2025, le gouvernement du Québec prétendait que le site ne revêtait pas d’intérêt sur le plan écologique. Le jour même, un média dévoilait des données obtenues par une demande d’accès à l’information, à savoir que le site compte 74 milieux humides très riches en biodiversité.
En mars 2025, le projet de loi no 93 Loi concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville, est adopté, malgré une opposition citoyenne et municipale majeure. Ce projet de loi force la Ville de Blainville, malgré sa décision contraire, à vendre le terrain de sorte que le site d’enfouissement de Stablex puisse être agrandi. L’article 12 du projet de loi empêche certains recours judiciaires le temps que la forêt soit rasée.
Conclusion
Force est de constater que des transformations profondes s’imposent au Québec pour permettre l’exercice du droit à un environnement sain. Le principal outil d’évaluation d’impacts environnementaux, rigoureux, public et transparent dont dispose le Québec est entravé par des obstacles importants ; l’opacité est la règle plutôt que l’exception et l’accès à la justice est difficile, parfois refusé.
Nous souhaitons également porter à l’attention de la Rapporteuse spéciale l’existence du racisme environnemental au Québec, lequel se manifeste de trois façons principales : 1) par des inégalités face aux risques environnementaux, où les communautés autochtones ou racisées sont souvent situées à proximité de sites industriels, d’incinérateurs ou d’autoroutes ; 2) par un accès inégal aux ressources naturelles telles que les espaces verts ou l’eau potable ; et 3) par une exclusion persistante des processus décisionnels, dans lesquels les communautés concernées sont rarement consultées, et leurs besoins peu pris en compte dans les politiques publiques.
Au Québec, le racisme environnemental demeure peu documenté et largement absent des débats politiques. Le manque de données, de reconnaissance institutionnelle et de représentation empêche toute réponse systémique à ces injustices. Le BAPE reconnaissait lui-même en 2024 que très peu de personnes issues des communautés racisées participent à ses audiences.
Cette réalité systémique doit être prise en compte si l’État entend s’approcher de pratiques d’évaluations d’impacts environnementaux respectant le droit à un environnement sain et permettant de cerner la globalité des impacts environnementaux et sociaux des projets envisagés.
[1] Bien qu’il ne soit pas un État, le Québec s’est déclaré par décret lié à une dizaine de conventions et pactes internationaux de droits de la personne, mais la Convention d’Aarhus n’en fait pas partie.
[2] En ligne : https://cqde.org/fr/nouvelles/registre-public-dinformation-environnementale-cqde-poursuit-quebec/