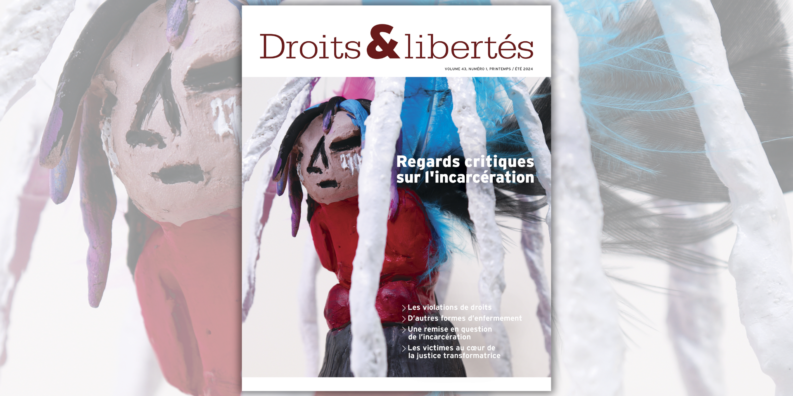Retour à la table des matières
Droits et libertés, printemps / été 2024
Dérouler le fil des logiques carcérales
Delphine Gauthier-Boiteau et Aurélie Lanctôt, doctorantes en droit, membre du comité de rédaction et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés
À l’automne 2022 se tenait le colloque De l’Office des droits des détenu-e-s (1972- 1990) à aujourd’hui : perspectives critiques sur l’incarcération au Québec, organisé par la Ligue des droits et libertés et son comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention. Cet évènement a donné lieu à des discussions autour d’enjeux passés et présents en lien avec l’incarcération et les luttes anticarcérales au Québec. L’évènement, marquant à plu- sieurs égards, embrassait une définition large des systèmes et institutions que les luttes anticarcérales prennent pour objet. Il s’agissait alors de stimuler une réflexion vaste sur les transformations sociales visant à dépasser et à défaire les logiques qui produisent et reproduisent l’enfermement au sein de notre société. Ce dossier s’inscrit dans le sillon des réflexions qui ont émergé lors de cette journée.

Ce dossier se veut une invitation. D’abord, une invitation à reconnaître les violences inhérentes à la prison et aux institutions carcérales ainsi que ce que leur existence empêche, c’est-à-dire une prise en charge des problèmes sociaux à leur racine. La proposition qui en découle est de réfléchir à partir de l’idée que la prison, tout comme le système de justice pénale, ne peuvent constituer une réponse appropriée aux problèmes sociaux parce que ces institutions sont, avant toute chose et de manière inévitable, un lieu de reproduction des systèmes qui en sont l’assise. Du point de vue des personnes victimisées, cette réponse n’est pas, non plus, appropriée, car elle individualise les torts causés, la transgression sociale ainsi que la violence, et n’a pas pour fonction d’apporter une réparation.
Ensuite, ce dossier est une invitation à poser un regard critique sur les logiques carcérales à l’œuvre au sein des institutions qui assurent une prise en charge de différents problèmes sociaux par l’État et dont le champ d’intervention repose sur des cadres juridiques distincts. Il s’agira donc de se pencher, certes, sur la prison, mais aussi les institutions psychiatriques, les systèmes d’immigration, de protection de la jeunesse ou encore d’éducation. Plutôt que de penser ces institutions en vase clos, il convient de dévoiler le fil de la carcéralité qui les traverse. Cela permet d’élargir notre compréhension des phénomènes de détention, de contrôle des corps et de surveillance des individus, au-delà des murs de la prison et de sa matérialité immédiate. Autrement dit, l’enfermement n’a pas lieu uniquement dans les prisons et les pénitenciers.
Les contributions mises de l’avant dans ce dossier tentent d’esquisser une compréhension transversale des systèmes qui produisent l’enfermement, la déshumanisation et la mise à l’écart sous des prétextes multiples, mais dont le sous-texte commun est l’idée que la vie de tous et toutes n’aurait pas la même valeur. Par exemple, il sera question de la manière dont le statut d’immigration que l’État accorde à une personne lui permet d’infliger une double peine, c’est-à-dire de procéder à l’expulsion territoriale de personnes auxquelles on a déjà infligé une peine en vertu du système de justice pénale. Plus généralement, il s’agira de mettre en évidence la notion, souvent occultée, de gestion différentielle des illégalismes en fonction de la place qu’occupe un individu dans l’espace social, et de dévoiler ainsi la teneur politique des infractions prévues au Code criminel. Il s’agira de rendre visible, par la négative, les effets de courtoisie organisés par l’État à l’égard de certains groupes ; ou ce que le juriste Dean Spade appelle la distribution inégale des chances de vivre1. Cette notion renvoie notamment aux tensions entre, d’une part, le défaut de mise en œuvre des droits économiques et sociaux par l’État et, d’autre part, les interventions étatiques découlant de logiques carcérales : cela alimente la détérioration des conditions de vie des personnes, intensifie la surveillance et les profilages (racial, social et politique) puis, en dernière instance, la criminalisation ainsi que l’incarcération disproportionnées de certains groupes.
L’expansion des logiques carcérales doit bien sûr être mise en lien avec des décennies de gouvernance néolibérale ayant laissé les services publics et communautaires dans un état de délabrement alarmant. En revanche, le présent dossier invite à ne pas voir les
[à] reconnaître les violences inhérentes à la prison et aux institutions carcérales ainsi que ce que leur existence empêche, c’est-à-dire une prise en charge des problèmes sociaux à leur racine.
atteintes graves aux droits humains relatées comme les effets délétères d’un système brisé. Les contributions démontrent plutôt que ces atteintes font partie intégrante de ce système ; en d’autres mots que la prison est un lieu de violations de droits et que l’on peut et doit juger ce système avant tout à partir de ses effets. Plutôt que comme des exceptions, nous devons les concevoir comme le résultat du croisement des systèmes d’oppression sur lesquels les logiques carcérales s’érigent.
Enfin, ce dossier se veut une invitation à imaginer ce que pourrait être un autre monde, un ailleurs politique qui dépasse l’horizon de la carcéralité. Il s’agit en quelque sorte d’un exercice de répétitions pour vivre2.
Le dossier adopte deux temporalités : l’ici et maintenant — pour réagir aux violences infligées au présent par les logiques carcérales — et l’avenir souhaité — pour repenser notre rapport à la carcéralité et à tout ce qui la permet.
Dérouler le fil
Afin de refléter une pluralité de réflexions au sujet des tensions qui traversent la critique radicale du recours à l’enferme- ment et des logiques qui rendent cette pratique possible, nous mettons de l’avant les voix et les savoirs des personnes touchées directement par les phénomènes carcéraux, leurs proches et les personnes œuvrant à leurs côtés pour la défense des droits humains.
Le premier volet a pour objectif de dévoiler les violences dont la prison est le nom, en mettant en lumière le caractère mortifère de cette institution ainsi que l’indifférence des autorités à l’égard des dénonciations pourtant continuelles des atteintes aux droits et des violences qui surviennent derrière les murs. Il sera question du caractère cyclique et de la nature carcérale de la prise en charge des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale ou avec une condition de déficience intellectuelle, ainsi que des enjeux soulevés par le paradigme de l’isolement en milieu carcéral. Il sera aussi question des conditions d’incarcération des femmes dans les prisons provinciales, des expériences des proches de personnes incarcérées ainsi que des limites de l’action du Protecteur du citoyen pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées et intervenir sur le plan systémique au Québec.
Le second volet pose un regard critique sur d’autres réalités d’enfermement : de la détention administrative des personnes migrantes au système dit de protection de la jeunesse, en passant par les formes de détention en lien avec la psychiatrie. Celui-ci montre bien comment la position de certaines personnes dans l’espace social favorise, à leur encontre, l’exercice de formes de contrôle qui découlent de plusieurs systèmes, parfois de façon simultanée.
Le troisième volet tente finalement d’articuler une critique plus fondamentale du recours à l’incarcération et à l’enfermement, en explorant notamment l’apport des théories et pratiques abolitionnistes carcérales et pénales. Il sera question, notamment, du rôle du capitalisme racial et de l’organisation patriarcale et coloniale de la société dans la production du caractère jetable (disposable) de certaines personnes. Le dossier se conclut par des contributions sur le thème de la justice transformatrice, pour penser une saisie non pénale et non carcérale des violences patriarcales.
Ces contributions, s’appuyant sur des expériences collectives et individuelles, montrent comment le système pénal et carcéral fait défaut de réparer les torts vécus par les personnes victimisées et d’ébranler les racines structurelles des violences commises. Elles traduisent qu’il perpétue les logiques des systèmes mortifères sur lesquels il repose, et confine les personnes victimisées, ainsi que leurs besoins, à la marge.
C’est là tout le paradoxe et de l’État pénal : l’architecture juridique pénale et constitutionnelle confère nécessairement aux personnes victimisées un statut de considération secondaire.
Mariame Kaba, militante féministe et abolitionniste, écrit que les structures pénale et carcérale s’opposent à la responsabilisation (accountability) individuelle et collective. D’un côté, la structure de ce système décourage la reconnaissance de torts causés, puisque reconnaître sa culpabilité emporte son lot de discriminations pour les personnes accusées et leurs proches. De l’autre, l’individualisation qui prévaut contredit une compréhension systémique et une réponse commune, à portée transformatrice.
Pour finir, il va sans dire que ce numéro n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Ce dossier se veut une contribution humble, ouverte, et forcément imparfaite, aux luttes collectives pour la défense des droits des personnes incarcérées et enfermées, ainsi qu’aux luttes anticarcérales. Nous avons pensé l’ensemble de ces contributions comme une parenthèse ouverte, qui traduit une nécessité et un désir de poursuivre le travail de réflexion critique sur la carcéralité, pour mieux contribuer aux luttes collectives toujours plus nécessaires.
Bonne lecture !