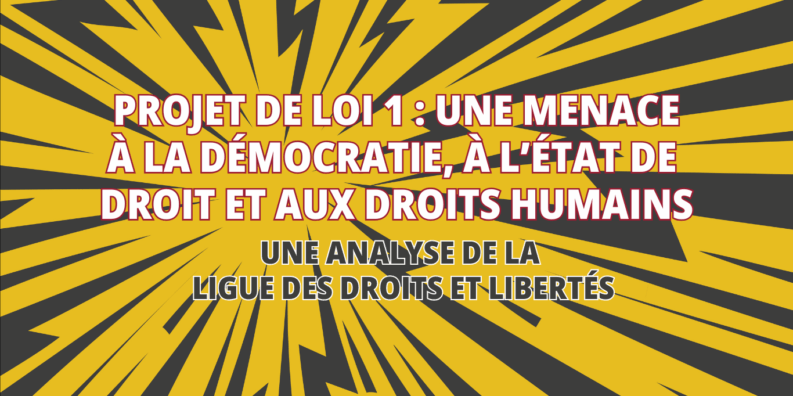Une analyse de la Ligue des droits et libertés
Projet de loi 1 : une menace à la démocratie, à l’État de droit et aux droits humains
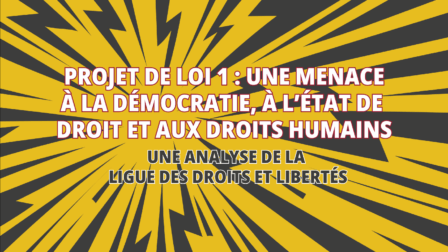
Une version imprimée et PDF de cette publication sera bientôt disponible.
Table des matières
1 Un processus illégitime et antidémocratique
2 Musellement des contre-pouvoirs : restrictions à l’autonomie d’action politique et judiciaire de la société civile
3 Les dangers de centraliser les pouvoirs dans les mains du Parlement
3.1 La clause de « souveraineté parlementaire » comme tentative de normaliser les dérogations aux chartes
3.2 La délégitimation des tribunaux et la création d’un Conseil constitutionnel tendancieux et partisan
3.3 Modifier et affaiblir la Charte québécoise et le rôle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
4 Les « droits collectifs », mais de qui au juste?
4.1 Droits des peuples autochtones
4.2 Droits de la communauté anglophone
5 Hiérarchiser les droits : opposer les droits collectifs et les « valeurs québécoises » aux droits des individus et des minorités
5.1 Une fausse opposition entre droits collectifs et droits individuels
5.2 Les dangers de constitutionnaliser les conceptions erronées et discriminatoires de la laïcité et de l’intégration à la nation québécoise
5.3 Hiérarchisation des droits humains, et fragilisation des droits à l’avortement et à l’égalité
6 Au-delà du PL1 : la convergence des luttes pour la démocratie, l’État de droit et les droits humains
0 Avant-propos
Le dépôt du projet de loi n° 1 – Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (PL1) n’est pas un acte législatif isolé. Il s’inscrit dans la continuité d’une série d’actions gouvernementales qui témoignent d’une dérive centralisatrice et autoritaire visant à renforcer les pouvoirs du gouvernement et à affaiblir les contre-pouvoirs, en particulier ceux des tribunaux et de la société civile.
Cette tendance se manifeste entre autres par une concentration croissante des pouvoirs entre les mains de l’exécutif, un mépris affiché pour les institutions et les processus démocratiques, ainsi que des atteintes répétées aux droits humains et aux chartes qui les protègent.
Dans ce contexte, notre opposition au projet de loi n° 1 fait partie d’un combat plus large pour la défense de la démocratie, de l’État de droit et du régime de protection des droits humains – trois piliers majeurs de la société québécoise.
1 Un processus illégitime et antidémocratique
Le projet de loi n° 1 a été élaboré derrière des portes closes et sans consultations publiques en amont. Or, les critères établis par le droit international prévoient que la rédaction d’une constitution doit se faire dans le cadre d’un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l’ensemble de la population. L’absence de consultations larges et inclusives pour la préparation de ce projet de loi fait en sorte que celui-ci n’a aucune légitimité politique et démocratique. C’est pourquoi il doit être rejeté en bloc.
***
La rédaction et l’adoption d’une constitution sont un acte juridique majeur dans la vie d’une collectivité, qui doit impliquer la participation pleine et entière de la société civile et de l’ensemble de la population.
Or, aucun des critères reconnus en droit international pour l’adoption d’une constitution légitime, notamment ceux établis par le Haut-Commissariat des droits de l’Homme des Nations unies, n’a été respecté par le gouvernement dans le contexte de l’élaboration et du dépôt du PL1. Ce projet de constitution a été rédigé derrière des portes closes sans consultations publiques préalables. Un projet de loi aussi décisif pour l’avenir social et politique du Québec ne devrait en aucun cas être élaboré de manière opaque ni émaner d’un simple acte unilatéral de l’exécutif.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme explique que « le lien entre les droits de l’homme et l’ordre constitutionnel démocratique se crée dès le processus conduisant à l’adoption d’une constitution ou à une réforme constitutionnelle. Un tel processus promet des résultats valables, s’il est fondé sur une large participation de tous les segments de la société. Les participants doivent pouvoir formuler leurs opinions librement et communiquer entre eux sans que le pouvoir en place les en empêche. Il est important que leurs opinions [soient] prises en considération dans le cadre de procédures clairement définies… » (Droits de l’homme et élaboration d’une Constitution, HCDH, 2018).
Ce sont ainsi, notamment, les défenseurs des droits, les associations de juristes, les médias et autres organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les femmes, les enfants, les minorités, les peuples autochtones, les réfugiés, les apatrides, les personnes déplacées, les travailleurs et les entrepreneurs, qui doivent se prononcer au moment d’élaborer une Constitution (Secrétaire général sur l’assistance des Nations Unies à l’élaboration de constitutions, 2009).
L’élaboration d’un tel projet de loi aurait dû être précédée de vastes consultations auprès d’expert·es de différents domaines, des membres de la société civile et du grand public.
De surcroit, un projet de loi de cette nature ne saurait être légitimement adopté uniquement par un vote à majorité simple de l’Assemblée nationale. Dans le contexte actuel, cela reviendrait à confier au parti majoritaire la destinée politique à long terme de l’État québécois. Rappelons qu’en raison du mode de scrutin au Québec, ce parti n’a été appuyé que par environ le quart des électeurs-trices lors des élections de 2022. L’électorat n’a d’ailleurs pas mandaté le gouvernement pour qu’il crée une Constitution du Québec, puisque ce projet ne figurait pas dans sa plateforme électorale.
Ne serait-ce qu’au regard de ce processus lacunaire et antidémocratique, voire partisan et électoraliste, le PL1 est un acte législatif illégitime. Pour ces raisons, ce projet de loi ne saurait être discuté article par article. Il doit être rejeté en bloc au nom de la sauvegarde des principes fondamentaux de la démocratie.
2 Musellement des contre-pouvoirs : restrictions à l’autonomie d’action politique et judiciaire de la société civile
Avec le PL1, l’Assemblée nationale aurait le pouvoir d’empêcher plus d’une centaine d’organismes – voire davantage – recevant des fonds publics de l’État d’utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de certaines lois ou de contribuer à de telles contestations. Il s’agit là d’une tentative de priver la société civile de son autonomie d’action et de priver la population de la protection des tribunaux contre les actions gouvernementales abusives, arbitraires, discriminatoires ou attentatoires aux droits et libertés.
***
Le PL1 permettrait à l’Assemblée nationale de désigner toute loi (ou l’une de ses dispositions) comme protégeant « la nation québécoise ainsi que l’autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec » (art. 5, Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec – ci-après Loi autonomie). L’impact de cette désignation est que plus d’une centaine d’organismes – voire davantage selon les critères établis par le gouvernement – recevant des fonds de l’État se verraient alors interdits d’utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de ces lois ou contribuer à une telle contestation (art. 4 et Annexe I, Loi autonomie).
La portée de cette disposition est très large. Selon les termes du PL1, la liste actuelle inclut des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, des sociétés d’État, des organismes du réseau public d’éducation et du domaine de la santé et des services sociaux, ainsi que des organismes municipaux et professionnels. Il s’agit là d’une atteinte grave, non seulement à l’autonomie de ces organismes, mais aux fondements mêmes de notre démocratie sociale.
Concrètement, cette disposition limiterait la capacité de participer à des contestations de la constitutionnalité de lois québécoises à des organismes tels que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Protecteur du citoyen, le directeur général des élections, l’Autorité des marchés financiers, le Conseil du statut de la femme, l’Office de la protection du consommateur, le Protecteur national de l’élève, Santé Québec, les collèges d’enseignement et universités, les municipalités et communautés métropolitaines, ainsi que les ordres professionnels.
Le projet de loi prévoit aussi que les membres ou administrateurs des organismes visés seraient personnellement imputables du respect de cette interdiction et tenus solidairement responsables du remboursement de tout financement étatique utilisé d’une façon prohibée.
Il est particulièrement important de souligner que cette disposition pourrait également s’appliquer à toutes les autres « catégories d’organismes que le gouvernement détermine », à son entière discrétion (art. 4, Loi autonomie). Cela ouvre toute grande la porte à ce que le gouvernement applique éventuellement ce verrou constitutionnel aux syndicats, aux groupes de défense collective des droits, aux organismes communautaires ou à tout autre groupe, association ou institution de la société civile.
Le PL1 élargirait également d’autres façons l’emprise du gouvernement sur les organismes étatiques, paragouvernementaux, institutionnels et de la société civile. Notamment, s’il est d’avis qu’une initiative fédérale a pour effet que l’État fédéral « s’immisce dans un domaine (…) préjudiciant au Québec, de quelque manière que ce soit », le gouvernement québécois pourrait ordonner aux organismes mentionnés ci-haut de refuser du financement fédéral, de résilier une entente avec une institution fédérale, ou d’adopter « toute autre conduite [que le gouvernement québécois] juge appropriée ». (art.17, Loi autonomie)
Le gouvernement québécois imposerait en outre aux organismes visés, dans leurs négociations de quelque entente que ce soit avec un autre gouvernement au Canada, de veiller à protéger et promouvoir la conception qu’a le gouvernement québécois des « caractéristiques fondamentales du Québec », des « droits collectifs de la nation québécoise » et des « revendications historiques du Québec » (art. 14, Loi autonomie).
En définitive, la volonté du gouvernement de bâillonner la société civile et de se soustraire au regard des tribunaux est profondément préoccupante, car elle menace de priver le Québec des remparts qui le protègent contre les dérives autoritaires. En affaiblissant la capacité des instances judiciaires d’agir comme gardiennes des droits et libertés, le gouvernement québécois s’attaque aux fondements mêmes de notre démocratie. Or, cette démocratie repose justement sur la possibilité pour les organismes de la société civile d’avoir accès aux tribunaux afin de contester des actions gouvernementales qui pourraient s’avérer arbitraires, abusives, discriminatoires ou attentatoires aux droits humains. Préserver cet accès n’est donc pas seulement souhaitable : c’est une condition essentielle au maintien de l’État de droit.
3 Les dangers de centraliser les pouvoirs dans les mains du Parlement
3.1 La clause de « souveraineté parlementaire » comme tentative de normaliser les dérogations aux chartes
Le PL1 cherche à confirmer et à légitimer la suprématie du Parlement du Québec sur les chartes des droits canadienne et québécoise, ainsi que sur les droits et libertés de la population qu’il est censé servir. Cela constituerait un accroc majeur à la règle de droit et au régime québécois de protection des droits humains, conquis au prix de plusieurs décennies de luttes sociales et politiques.
***
Le PL1 intègrerait la clause dérogatoire, déjà inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, au sein de la Constitution du Québec (art 9, Loi autonomie). Il s’agit là d’une tentative évidente de normaliser l’usage de cette clause dangereuse, qui permet au législateur de contourner les chartes des droits. Le PL1 prévoit d’ailleurs qu’une loi invoquant la clause dérogatoire serait automatiquement « réputée compatible » avec la Constitution québécoise (art. 16, Constitution du Québec – ci-après Constitution). C’est là tout le contraire de ce que devrait faire une constitution.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme souligne que « les constitutions contemporaines ne se contentent pas de définir et de réglementer les relations entre les institutions ni de déterminer les procédures applicables. Elles ont connu un processus d’humanisation et ont ainsi placé les individus et les groupes en leur centre, en faisant de la charte des droits et des libertés fondamentales des éléments essentiels » (Droits de l’homme et élaboration d’une Constitution, HCDH, 2018). Il est ainsi alarmant que le projet de loi 1 fragilise à ce point les Chartes des droits qui protègent l’ensemble des Québécois-es.
En fondant son projet de constitution sur le principe de la suprématie parlementaire pour déroger impunément aux chartes des droits, le gouvernement opère un recul majeur par rapport au mouvement pour l’avancement des droits humains qui a pris naissance après la Seconde Guerre mondiale au Québec. L’histoire contemporaine du Québec a en effet été marquée par plusieurs conquêtes dans ce domaine, notamment avec l’adoption en 1975 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, un texte considéré comme l’un de textes législatifs les plus progressistes en Amérique du Nord. Ainsi, le gouvernement tente de revenir au régime politique fondé sur la suprématie du parlement qui a prévalu au Québec jusqu’en 1975, et qui a été à l’origine de nombreuses violations de droits humains. Ce virage est d’autant plus alarmant que la clause dérogatoire est de plus en plus invoquée par le gouvernement pour bafouer ces droits, et en particulier ceux de certains groupes et communautés minoritaires.
3.2 La délégitimation des tribunaux et la création d’un Conseil constitutionnel tendancieux et partisan
Le PL1 prévoit la création d’un Conseil constitutionnel chargé de fournir des avis sur l’interprétation de la Constitution québécoise. Cette démarche est une tentative évidente de délégitimer les décisions rendues par des tribunaux indépendants et impartiaux en tentant d’y opposer les avis d’un Conseil constitutionnel nommé par l’Assemblée nationale sur la base de critères partiaux. Ce Conseil ne disposerait d’aucune garantie d’indépendance face à l’exécutif et au législateur, et n’aurait pas à faire preuve de transparence vis-à-vis du public.
***
Le PL1 prévoit la création d’un Conseil constitutionnel chargé de fournir des avis sur l’interprétation de la Constitution québécoise – une tâche actuellement réservée aux tribunaux.
Les membres de ce conseil seraient nommés au moyen d’un vote des deux tiers de la députation à l’Assemblée nationale. Ainsi, un parti qui disposerait d’une super-majorité parlementaire à l’Assemblée nationale, comme c’est le cas actuellement, pourrait nommer unilatéralement les personnes chargées de fournir des avis constitutionnels sur ses propres lois. Le pouvoir de saisir le Conseil serait par ailleurs réservé uniquement au gouvernement ou à la majorité parlementaire. Autrement dit, les partis d’opposition ou les minorités politiques au parlement ne pourraient saisir ce Conseil, même s’ils sont d’avis qu’une loi porte atteinte directement aux chartes et aux droits et libertés qu’elles énoncent. Il s’agit là d’une concentration dangereuse des pouvoirs aux mains de l’Assemblée nationale.
Mais il y a plus. Les membres du Conseil seraient forcément biaisés dans leur approche relative aux droits et libertés de la personne, puisque le PL1 prévoit qu’ils seraient sélectionnés « en fonction de leur sensibilité et de leur intérêt marqués pour la protection des droits collectifs de la nation québécoise ainsi que de l’autonomie constitutionnelle et des caractéristiques fondamentales du Québec » (art. 6, Loi sur le Conseil constitutionnel).
Le Conseil serait également tenu de rendre des avis sans dissidence. Ainsi, il serait impossible pour un ou plusieurs membres de s’opposer à l’avis rendu. La possibilité que certains membres s’inscrivent en dissidence est pourtant cruciale, puisqu’elle permettrait au public de savoir que des dissensions existent au sujet de l’avis rendu ultimement sur une question.
Les délibérations des membres du Conseil seraient par ailleurs tenues secrètes pour 25 ans : signe d’une absence complète de transparence.
Ce projet de loi prévoit également que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas se saisir par lui-même d’une loi pour en étudier la constitutionnalité. Celui-ci ne pourrait par ailleurs que rendre des « avis » n’ayant absolument aucune valeur contraignante.
Le PL1 prévoit donc la création d’un nouvel organe, le Conseil constitutionnel, qui n’ajoute aucun rempart pour la protection de la démocratie et des droits et libertés de l’ensemble de la population québécoise. Au contraire, ce Conseil risque d’être instrumentalisé par les gouvernements en place pour justifier certaines politiques et délégitimer les décisions de tribunaux indépendants et impartiaux, dont le mandat est de protéger les droits et libertés de la population contre les abus de pouvoir.
3.3 Modifier et affaiblir la Charte québécoise et le rôle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Le projet de loi n° 1 vise à affaiblir la portée supralégislative de la Charte québécoise des droits et libertés. En plus de constitutionnaliser la procédure de dérogation et de modifier la Charte pour y inscrire la prépondérance des « droits collectifs » de la nation québécoise, il porte atteinte à l’indépendance et à l’autonomie de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
***
Le projet de loi n° 1 prévoit introduire une disposition dans la Charte québécoise indiquant que celle-ci doit être interprétée « en harmonie » avec le Code civil du Québec. À première vue, cet ajout peut sembler anodin.
Or, il vise lui aussi à affaiblir la portée supralégislative (prépondérance) de la Charte québécoise sur les autres lois ordinaires. Il existe en effet actuellement une disposition liminaire dans le Code civil du Québec qui prévoit que c’est le Code civil qui doit être interprété en harmonie avec la Charte québécoise. Par cet ajout, le gouvernement cherche en fait à mettre sur un même pied le Code civil et la Charte québécoise, et ainsi limiter la prépondérance des droits et libertés que celle-ci protège sur le droit privé, qui encadre par exemple les contrats, les successions, le droit de la famille, etc.
De même, le projet de loi modifiera la Charte québécoise en ajoutant dans sa disposition limitative (art. 9.1, Charte) que les droits et libertés énoncés dans cette charte s’exercent dans le respect « des droits collectifs de la nation québécoise ». Il entend également ajouter, dans les dispositions interprétatives de la Charte (art. 50, Charte), que celle-ci doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre un « droit collectif de la nation québécoise prévu par la Constitution du Québec ». Ces ajouts ont un objectif clair : inféoder la Charte et les droits et libertés qu’elle énonce aux soi-disant droits collectifs de la nation québécoise. Cela constitue une entorse majeure au principe même de l’État de droit, qui doit garantir – notamment à travers les chartes – les droits et libertés de toutes et tous face aux potentielles dérives du pouvoir de la majorité.
Il faut également souligner que le projet de loi transformerait profondément la mission de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Actuellement, celle-ci a pour mandat de « veiller au respect des principes de la Charte » et de se prononcer sur la compatibilité des lois avec les droits et libertés qui y sont énoncés. Or, si le PL1 est adopté, la Commission devrait en plus « veiller à l’équilibre entre les droits et libertés de la personne et les droits collectifs de la nation québécoise ». Une telle modification viendrait diluer l’importance des droits et libertés au profit d’une notion vague de « droits collectifs », déterminés au gré du gouvernement au pouvoir. Cette modification porterait gravement atteinte à l’autonomie, à la capacité critique et à la mission de la Commission, qui est chargée de veiller au respect des droits au bénéfice de toutes les personnes au Québec.
4 Les « droits collectifs », mais de qui au juste?
En plus de proposer une vision uniformisante et assimilationniste de la nation québécoise, le PL1 perpétue une approche colonialiste en niant les droits territoriaux et à l’autodétermination des peuples autochtones présents sur le territoire du Québec. Ce projet de loi se démarque également par l’absence complète de mention et de reconnaissance des apports et des droits historiques des personnes et des communautés anglophones du Québec, de même que par son objectif de subordonner les droits des communautés qui cohabitent sur le territoire québécois aux soi-disant valeurs et intérêts de la majorité.
***
4.1 Droits des peuples autochtones
Le PL1 se démarque par son absence marquée de reconnaissance des droits des peuples autochtones présents sur le territoire du Québec. Il se borne en effet à reconnaître – dans la section sur les considérants – leurs droits ancestraux et issus de traités, qui sont déjà protégés par la Constitution canadienne, ainsi que « le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d’origine ». Cette formulation restrictive et les nombreuses omissions de ce projet de loi soulèvent des enjeux majeurs en regard des droits humains des peuples autochtones.
Tout d’abord, l’expression « langue et culture d’origine », au singulier, suggère implicitement que les 11 nations présentes sur le territoire du Québec ne partageraient qu’une seule langue et une seule culture. L’expression « d’origine » insinue quant à elle que « la » langue et « la » culture des peuples autochtones seraient en quelque sorte figées depuis des temps immémoriaux; cette vision colonialiste efface les réalités hybrides, dynamiques et évolutives des langues, des identités et des cultures des peuples autochtones.
Par ailleurs, le PL1 affirme : « [l]e peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » (art. 13, Constitution). Cependant, il ne reconnaît à aucun endroit ce droit pour les peuples autochtones présents sur le territoire du Québec. L’absence de mention de leur droit à l’autodétermination est loin d’être accidentelle : plusieurs déclarations passées des membres du gouvernement témoignent de leur refus de reconnaître ce droit, qui est pourtant inscrit en toutes lettres dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
La disposition selon laquelle « le territoire du Québec est indivisible » (art. 23, Constitution) constitue également un acte implicite (voire explicite) de non-reconnaissance de la souveraineté des nations autochtones sur leurs territoires ancestraux. Elle pourrait en effet être invoquée pour remettre en cause le droit des communautés autochtones d’être consultées et de participer pleinement aux décisions et aux développements qui touchent leurs territoires traditionnels et leurs communautés, dans une perspective de dialogue de nation à nations.
4.2 Droits de la communauté anglophone
Le PL1 ne reconnaît les droits de la communauté anglophone que dans la mesure où ceux-ci demeurent compatibles avec l’objectif prioritaire de protéger les « droits collectifs » de la nation québécoise. Une telle formulation place d’emblée les droits des anglophones dans une position de subordination.
De même, le gouvernement se limite à simplement évoquer, dans les considérants de son projet de loi, le « respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise ». En plus de porter uniquement sur les institutions, cette disposition omet de mentionner les droits historiques et constitutionnels des communautés anglophones, ainsi que leurs apports à la construction, à l’évolution et au devenir de la nation québécoise. Ces omissions trahissent le fait que le projet de loi vise, dans les faits, à promouvoir une conception homogène de la nation, qui passe sous silence l’apport des personnes anglophones de diverses origines à la construction des identités plurielles du Québec.
Soulignons également que les articles du PL1 qui empêchent les « organismes » d’utiliser des fonds publics pour contester la validité constitutionnelle des lois pourront s’appliquer à plusieurs organisations anglophones, dont les commissions scolaires, les collèges et universités, sans compter les autres organismes qui pourraient être désignés de manière arbitraire par le gouvernement. Cette attaque semble d’autant plus délibérée que, dans le passé, des organisations comme l’Université McGill, Concordia et le English Montreal School Board ont contesté la validité constitutionnelle de certaines lois.
5 Hiérarchiser les droits : opposer les droits collectifs et les « valeurs québécoises » aux droits des individus et des minorités
5.1 Une fausse opposition entre droits collectifs et droits individuels
Le projet de loi n° 1 repose sur une fausse opposition entre les droits et libertés des personnes et des minorités, d’une part, et la protection des « droits collectifs de la nation » et des prétendues « valeurs québécoises », d’autre part. Cette opposition traduit une compréhension erronée du cadre de référence des droits humains qui s’appuie sur la notion d’interdépendance des droits. Elle est d’autant plus dangereuse qu’elle peut servir à justifier des violations des droits et libertés, au nom de notions vagues, comme les « valeurs sociales distinctives du Québec », le « bien commun » ou la « protection de la nation québécoise ». En faisant primer des droits dits collectifs sur les droits individuels, le gouvernement renverse la logique même des chartes et des droits humains, qui visent précisément à protéger les personnes et les minorités contre les excès du pouvoir étatique qui agirait au nom des intérêts de la « majorité ». Le PL1 remet plus largement en cause les principes d’indivisibilité, d’interdépendance et d’universalité des droits humains.
***
Le PL1 souligne que « la nation québécoise est titulaire de droits collectifs intrinsèques et inaliénables » (art.7, Constitution). Parmi les droits dits collectifs que le gouvernement identifie, notons notamment le droit de la nation de protéger et de promouvoir son existence, sa culture, sa langue et ses valeurs sociales distinctes; le droit de disposer d’institutions et de services publics laïques; ainsi que le droit du peuple québécois de disposer de lui-même et de choisir librement son régime politique et le statut juridique du Québec (art. 7-14, Constitution).
Bien que le gouvernement souligne la nécessité d’assurer un « équilibre » entre droits individuels et droits collectifs, son projet de loi affirme que ces derniers doivent être interprétés « de manière extensive » (art. 7). Le PL1 va d’ailleurs jusqu’à modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour exiger que celle-ci soit interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance de ces droits collectifs. Ainsi, cela permettrait au législateur de justifier des violations des droits des individus et des minorités au nom des prétendues « valeurs sociales distinctives du Québec », du « bien commun », de la « protection de la nation québécoise » de ses « revendications historiques » ou de ses « caractéristiques fondamentales ».
Il va sans dire que les droits humains ne sont pas absolus. C’est la raison pour laquelle la Charte québécoise prévoit déjà un processus de réconciliation et de mise en balance de ces droits lorsqu’ils entrent en conflit avec d’autres droits et intérêts sociétaux (art. 9.1, Charte). Toutefois, l’approche du gouvernement actuel est d’un tout autre registre. La volonté du gouvernement de faire primer les droits dits « collectifs » sur les droits individuels constitue un travestissement complet de la logique même des chartes et des droits humains, qui doivent justement servir de rempart au pouvoir d’un État qui agirait au nom des « valeurs », des « intérêts » ou des « droits » de la majorité.
Cette opposition entre droits collectifs et individuels est d’ailleurs erronée, en ce qu’elle s’appuie sur une conception faussée du cadre de référence des droits humains, tel que défini par le droit international depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948 et des pactes, conventions et traités qui sont aux fondements du droit international des droits humains. Selon le droit international, les droits individuels et collectifs ne sont pas mutuellement exclusifs; au contraire, ils sont profondément interdépendants.
Par exemple, le droit des peuples à l’autodétermination est reconnu explicitement dans les deux grands pactes qui – avec la Déclaration universelle de 1948 – forment le socle de la Charte internationale des droits de l’homme. Il s’agit bien d’un droit collectif, mais son exercice ne doit en aucun cas impliquer un recul pour les droits des individus et des minorités. Ce droit consacre le droit de tout peuple à s’épanouir en toute liberté; il n’accorde pas à la majorité le droit de bafouer les droits des personnes appartenant à des minorités, comme le propose actuellement le gouvernement avec son projet de loi n° 1 et d’autres mesures législatives, notamment celles relatives à la laïcité, à la langue et à la politique d’intégration à la nation québécoise.
Ainsi, les droits collectifs ne doivent en aucun cas servir de prétexte pour bafouer les droits ou contourner les chartes, qui ont justement pour vocation de protéger les droits des individus et des minorités contre les potentielles dérives de la majorité. Ils ne doivent jamais être invoqués par un gouvernement pour se dérober à ses obligations légales en vertu du droit international des droits humains.
Il convient par ailleurs de souligner que l’intérêt collectif, les valeurs sociales distinctives ou les caractéristiques fondamentales d’une nation sont des notions floues et arbitraires, qui évoluent selon les époques. Reflétant les intérêts de la majorité et des groupes détenant le pouvoir formel et informel, les valeurs et les intérêts de la majorité peuvent constituer une menace aux droits des individus, en plus d’exclure et de marginaliser certaines communautés minoritaires. D’où la nécessité d’assurer un socle de droits fondamentaux, dont la reconnaissance ne doit pas être soumise aux aléas des soi-disant valeurs ou intérêts de la majorité.
Le PL1 remet plus largement en cause le principe d’universalité des droits en soulignant – en notes explicatives – qu’il existerait « une interprétation des droits et libertés propre au Québec ». Or, les normes établies par le droit international sont conçues pour s’appliquer à tous les États de manière uniforme, et non en fonction d’une quelconque forme d’« interprétation » relevant des gouvernements en place. L’État québécois demeure lié par ses engagements internationaux, notamment les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a ratifiés en 1976. Chercher à imposer une interprétation spécifiquement québécoise des droits humains est radicalement contraire au principe même de l’universalité de ces droits.
5.2 Les dangers de constitutionnaliser les conceptions erronées et discriminatoires de la laïcité et de l’intégration à la nation québécoise
Le PL1 vise à intégrer dans la Constitution québécoise la conception erronée de la laïcité du gouvernement, ainsi que son modèle assimilationniste d’intégration à la nation québécoise. Ces notions, détaillées dans des lois déjà existantes, reposent sur des visions de la laïcité et de l’intégration qui sont xénophobes, discriminatoires et attentatoires aux droits humains.
***
Loi sur la laïcité de l’État et ses suites
La véritable laïcité de l’État signifie de séparer le politique et le religieux, et d’assurer la neutralité de l’État face aux croyances et non-croyances de la population. Il s’agit d’une laïcité ouverte, inclusive et respectueuse des droits et libertés.
La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée sous bâillon en 2019, pervertit la notion de laïcité en interdisant à certains employés de l’État – tels les enseignants, policiers et juges – de porter des signes religieux au travail. En les forçant à choisir entre leur foi et leur profession, cette loi a causé et cause toujours à nombre de Québécois·es de graves préjudices, lesquels sont désormais largement documentés par la littérature scientifique.
Plusieurs études ont démontré que la Loi sur la laïcité de l’État a entraîné plusieurs violations des droits humains, qui ont affecté tout particulièrement les femmes enseignantes de confession musulmane. Ses impacts sur la vie de ces personnes sont majeurs : discrimination à l’embauche, blocage de la mobilité professionnelle, perte d’emploi, atteintes à la liberté de conscience, d’expression et de religion, aggravation du sentiment d’insécurité et d’exclusion, sans parler des effets délétères sur le climat social et la montée de l’intolérance, du racisme et de l’islamophobie.
Le projet de loi 94, adopté le 30 octobre dernier et prétendument destiné à « renforcer » l’application de la Loi sur la laïcité dans le réseau public d’éducation, n’a fait qu’accentuer les effets dévastateurs de celle-ci. En effet, cette nouvelle loi élargit la discrimination directe à l’emploi aux employé·es des services de garde et à l’ensemble du personnel (et même des apprenants) œuvrant au sein du réseau public d’éducation.
Cette loi liberticide, qui vise à contrôler les conduites, les propos, les attitudes et les comportements des élèves et du personnel enseignant pour qu’ils se conforment aux prétendues « valeurs québécoises », incarne de façon claire la dérive autoritaire et assimilationniste du gouvernement québécois.
Cette loi institue par ailleurs une fausse démarcation entre un « nous » (la majorité) et un « eux » (qui menaceraient les soi-disant droits et valeurs de cette majorité). En restreignant l’expression des diversités religieuses, culturelles et linguistiques dans nos écoles, elle porte atteinte au droit des élèves à évoluer dans un système scolaire tolérant, pluraliste, et respectueux des identités et des droits de toutes et tous.
Cette tendance croissante du gouvernement à s’attaquer à certaines minorités et à vouloir imposer les « valeurs » de la majorité est révélatrice d’une dérive à la fois xénophobe et discriminatoire, que l’on retrouve également au fondement du PL1. Tout cela est d’autant plus alarmant que le gouvernement annonce son intention d’élargir à nouveau la portée de la Loi sur la laïcité de l’État en interdisant les prières en public et le port des signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE).
Loi sur l’intégration à la nation québécoise
Le PL1 enchâsserait également dans la Constitution québécoise le modèle d’intégration nationale tel que défini par la Loi sur l’intégration à la nation québécoise, adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2025 (projet de loi 84).
Rappelons que cette loi assimilationniste vise essentiellement – entre autres choses – à imposer aux « minorités culturelles » et aux personnes im·migrantes une adhésion unilatérale aux prétendues « valeurs québécoises » et à la culture de la majorité. Elle conditionne par ailleurs le financement par projets des organismes communautaires et de défense collective des droits à leur adéquation au modèle d’intégration nationale tel que défini par le gouvernement; une exigence en complète contradiction avec le principe d’autonomie de ces groupes et, plus largement, avec les principes de la démocratie sociale.
Cette loi a également modifié la Charte québécoise afin que cette dernière soit interprétée à l’aune de la politique d’intégration nationale du gouvernement actuel, alors que c’est plutôt cette dernière – est-il utile de le rappeler – qui devrait se conformer aux dispositions de la Charte.
Il est important aussi de souligner que la Loi sur l’intégration à la nation québécoise a donné carte blanche au gouvernement pour élaborer et mettre en place, par voie réglementaire, une politique « d’intégration » dont les détails demeurent encore inconnus à ce jour. Comme c’est le cas pour son projet de loi constitutionnelle, cette politique est élaborée par l’exécutif derrière des portes closes, sans consultations publiques, en dehors de tout processus participatif et démocratique.
Ainsi, par le biais du PL1, le gouvernement souhaite constitutionnaliser sa conception erronée de la laïcité et de l’intégration nationale. Plutôt que de constituer un outil d’intégration et de respect des droits de toutes et tous, ce projet de loi fait de la laïcité et de la politique d’intégration nationale des instruments d’assimilation, de stigmatisation et d’exclusion sociale.
5.3 Hiérarchisation des droits humains, et fragilisation des droits à l’avortement et à l’égalité
Sous le couvert d’un vernis progressiste, le PL1 fragilise le droit à l’avortement et le droit à l’égalité, y compris celui des personnes 2SLBTQ+. Par ailleurs, en faisant primer « l’égalité entre les femmes et les hommes » sur la liberté religieuse, le gouvernement procède à une hiérarchisation des droits qui est contraire au principe d’interdépendance des droits. Ce faisant, il instrumentalise la notion d’égalité hommes-femmes pour s’attaquer aux droits de certaines femmes issues de communautés minoritaires ou marginalisées, et notamment nos concitoyennes québécoises de confession musulmane.
***
Droit à l’avortement
Le PL1 prévoit que « l’État protège la liberté des femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » (art. 28, Constitution). À première vue, cela peut sembler renforcer la protection du droit à l’avortement. Or, cette mesure législative comporte des risques majeurs qui ont déjà été soulignés à maintes reprises au gouvernement par les groupes concernés.
D’emblée, précisons que le droit à l’avortement est déjà protégé au Québec ainsi que partout au Canada grâce à la jurisprudence canadienne en la matière (voir notamment : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30. Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.). Or, légiférer à ce sujet comporte un danger : comme la Constitution du Québec pourrait être modifiée par une simple majorité parlementaire, un futur gouvernement pourrait facilement apporter des restrictions à l’article prévoyant le droit à l’avortement. Soulignons au passage que la « constitutionnalisation » par le PL1 des dispositions de dérogation donnerait une légitimité politique supplémentaire aux gouvernements qui voudraient se soustraire aux chartes et à la jurisprudence qui s’en inspire pour s’attaquer à ce droit conquis au prix de plusieurs décennies de luttes sociales, politiques et juridiques.
En outre, l’un des aspects extrêmement préoccupants du projet de loi réside dans le choix du libellé « liberté d’interruption volontaire de grossesse ». En parlant de « liberté » plutôt que de « droit à l’avortement », le gouvernement met l’accent sur la volonté individuelle plutôt que sur la responsabilité de l’État d’assurer le respect et l’exercice effectif de ce droit. De plus, le terme « interruption volontaire » pourrait éventuellement servir à distinguer seulement certaines formes d’interruptions qui seraient réellement protégées, en fonction du cadre que l’État choisira d’établir.
Ainsi, cette disposition, qui semble à première vue progressiste, risque d’affaiblir les protections juridiques existantes et d’avoir des effets délétères sur le respect et la mise en œuvre des droits reproductifs. Cet enjeu est particulièrement préoccupant pour les femmes autochtones et racisées, historiquement visées par diverses formes de violences obstétricales, de contrôle de leurs corps et d’injustices reproductives.
En décidant de légiférer sur l’avortement malgré les avertissements et les mises en garde répétées depuis plusieurs années de la part des personnes et des organismes concernés, le gouvernement affaiblit objectivement la protection de ce droit.
Il est par ailleurs inquiétant de noter qu’aucune protection équivalente n’est prévue pour les personnes 2SLGBTQ+ également concernées par le droit à l’avortement. Cela trahit le refus du gouvernement de reconnaître juridiquement les identités de genre; un refus qui s’est exprimé plus ou moins explicitement, notamment au moment de la mise sur pied du « Comité de sages sur l’identité de genre » (dont aucun membre n’appartenait à la diversité de genres), des débats sur les « toilettes mixtes » dans les écoles et de l’annonce de l’interdiction de l’usage du pronom « iel » et d’autres expressions non binaires dans les communications de l’État.
Hiérarchisation entre le droit à l’égalité et la liberté de religion
Le PL1 stipule « qu’en cas de conflit entre l’exercice du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et l’exercice de la liberté de religion, le premier l’emporte » (art. 21, Partie V). Cette disposition conduirait à une hiérarchisation dangereuse des droits humains, qui est en complète contradiction avec le principe selon lequel ceux-ci sont universels, inaliénables, indivisibles et interdépendants. En effet, il découle du principe d’interdépendance que les droits humains ne s’exercent jamais de manière isolée : leur violation ou leur protection entraînent systématiquement des conséquences sur l’ensemble des autres droits. Leur hiérarchisation limite aussi l’interprétation que peuvent faire les tribunaux dans le cas de plusieurs droits en cause, en les obligeant à privilégier certains droits par rapport à d’autres, sans tenir compte du contexte.
Un tel ajout à la Constitution québécoise légitimerait l’adoption par le législateur de lois, politiques et règlement qui – sous couvert de protéger les droits des femmes – s’attaqueraient aux libertés de conscience, de religion, d’expression et de réunion de certaines femmes, et notamment celles appartenant à certaines communautés de foi minoritaires.
Hiérarchiser les droits humains en faisant primer l’égalité homme-femme sur les libertés religieuses peut, paradoxalement, renforcer la marginalisation de certaines femmes plutôt que de les protéger. Lorsque l’égalité est invoquée de manière sélective pour justifier des politiques qui stigmatisent ou ciblent des pratiques religieuses particulières, cela peut priver les femmes concernées de leur autonomie, de leur capacité d’agir et de leur droit à l’autodétermination. Cette approche, souvent qualifiée de féminisme de façade, instrumentalise le discours féministe sans s’attaquer aux causes structurelles des inégalités, et finit par opposer des droits fondamentaux plutôt que de les concilier.
6 Au-delà du PL1 : la convergence des luttes pour la démocratie, l’État de droit et les droits humains
Le projet de loi n° 1 peut être considéré comme la pièce maîtresse d’un projet politique plus large visant à concentrer les pouvoirs dans les mains du parlement, à affaiblir les contre-pouvoirs, à saper notre régime de protection des droits humains, à affirmer la primauté juridique des droits dits « collectifs », à assujettir les droits aux valeurs et à limiter le pouvoir des tribunaux et de la société civile de contester les lois adoptées par le Parlement.
Un aperçu des récentes actions du gouvernement montre clairement de quelle manière ce projet politique constitue une menace pour la démocratie, l’État de droit et le régime de protection des droits humains au Québec.
Entre autres, depuis des années :
- Le gouvernement cherche à justifier certaines de ses propositions législatives en les liant à des recommandations provenant de prétendus comités d’expert·es. Souvent, ces soi-disant expert·es sont en réalité des personnes proches du gouvernement ayant été choisies pour leurs opinions et leur appui aux politiques que le gouvernement souhaite mettre en place (pensons au Comité de sages, aux comités d’enquête mis en place à la suite de l’affaire de l’école Bedford, au Comité Pelchat-Rousseau sur la laïcité ou au Comité Proulx-Rousseau sur les enjeux constitutionnels).
- Le gouvernement bafoue le droit à l’autodétermination des peuples autochtones en refusant de les consulter dans plusieurs projets ayant un impact sur leurs territoires, leurs ressources et leurs communautés.
- À la suite du dépôt de plusieurs projets de loi, le gouvernement organise des consultations parlementaires dans des délais trop courts pour permettre aux expert·es, aux personnes intéressées et aux organisations de la société civile de réagir adéquatement. La majorité des acteurs invités lors de ces audiences soutiennent les projets de loi gouvernementaux, tandis que les critiques sont reçues avec mépris, condescendance et paternalisme.
- Le gouvernement affiche une attitude de fermeture au dialogue démocratique censé avoir lieu entre le gouvernement et les oppositions, les groupes touchés, les expert·es, et divers autres acteurs de la société civile. Cette fermeture se manifeste notamment par l’utilisation répétée de la procédure du bâillon parlementaire. Ce procédé, censé être exceptionnel et pourtant régulièrement utilisé par le gouvernement, permet de couper court aux débats parlementaires portant sur un projet de loi.
- Le gouvernement refuse souvent de prendre en considération les recherches ou de réaliser des études d’impacts sur les conséquences de ses lois, y compris lorsqu’elles bafouent les droits humains et ont des impacts discriminatoires sur certaines catégories de populations.
- Le gouvernement limite le dialogue démocratique par une centralisation croissante du pouvoir décisionnel au sein du pouvoir exécutif. Plusieurs lois adoptées dans les dernières années ont conféré un pouvoir réglementaire très large dans les mains de ministres, sans les obligations de débat démocratique auxquelles le pouvoir législatif est soumis.
- Le gouvernement s’attaque de différentes manières au pouvoir judiciaire – dernier rempart de la population contre l’exercice abusif du pouvoir par le gouvernement – en réduisant les possibilités de contestations judiciaires de lois inconstitutionnelles. Depuis 2019, le gouvernement utilise de plus en plus souvent les clauses dérogatoires afin de contourner les protections des chartes québécoise et canadienne des droits et libertés, et d’ainsi empêcher les tribunaux d’invalider des lois portant gravement atteinte aux droits humains. Parallèlement, il n’a pas hésité à utiliser des fonds publics pour défendre, devant les tribunaux, des lois manifestement discriminatoires ou pour contester la possibilité pour les citoyens et les organisations de défendre leurs droits, entre autres dans les dossiers de la Loi sur la laïcité de l’État, de l’accès aux garderies des personnes demandeuses d’asile et de la création de systèmes autochtones de protection de l’enfance.
Cette attaque en règle contre plusieurs piliers d’une société se voulant libre et démocratique s’est intensifiée au cours des derniers mois. Le gouvernement québécois a en effet proposé plusieurs mesures législatives – notamment les projets de loi 83, 2, 3 et 7 – visant à priver les syndicats et les organismes de la société civile de leur capacité à agir comme contrepoids face à l’État.
S’ajoute à cela la tendance nationaliste identitaire du gouvernement, laquelle prend des allures de plus en plus xénophobes. Le gouvernement a adopté plusieurs projets de lois profondément discriminatoires – notamment les PL21 et 94 sur la laïcité, en usant des clauses dérogatoires, et le PL84 sur l’intégration nationale, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces lois stigmatisent particulièrement les personnes im·migrantes et les membres de certaines communautés minoritaires, en les présentant comme des menaces aux soi-disant « valeurs québécoises » ou « droits collectifs » de la nation. Cette rhétorique assimilationniste et discriminatoire s’accompagne d’un discours sécuritariste qui présente l’immigration comme étant la cause de plusieurs maux sociaux qui sont en réalité causés par le désengagement de l’État dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et des services sociaux.
L’ensemble de ces politiques et discours traduit une volonté délibérée de concentrer les pouvoirs dans les mains du gouvernement, de museler les contre-pouvoirs, d’affaiblir la participation citoyenne, de réduire les espaces de contestation, de contourner les chartes et de fragiliser les droits et libertés qu’elles protègent. Le projet de loi n° 1 ne constitue donc pas simplement un texte à portée constitutionnelle, il est une étape supplémentaire dans une offensive autoritaire et centralisatrice qui menace l’État de droit et les droits humains de tous·tes.
Notre démocratie est en jeu!