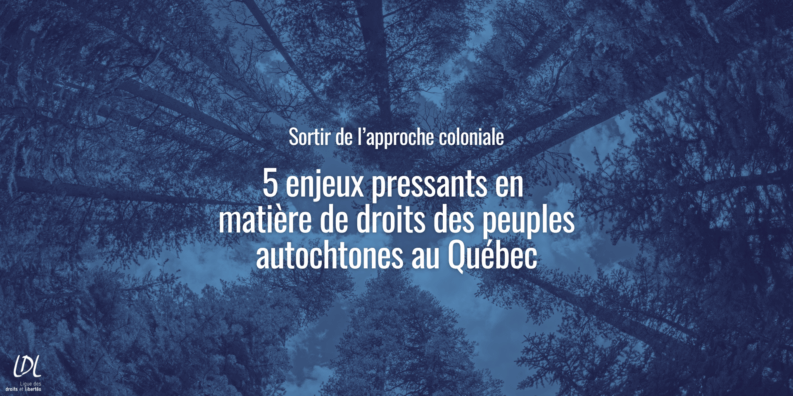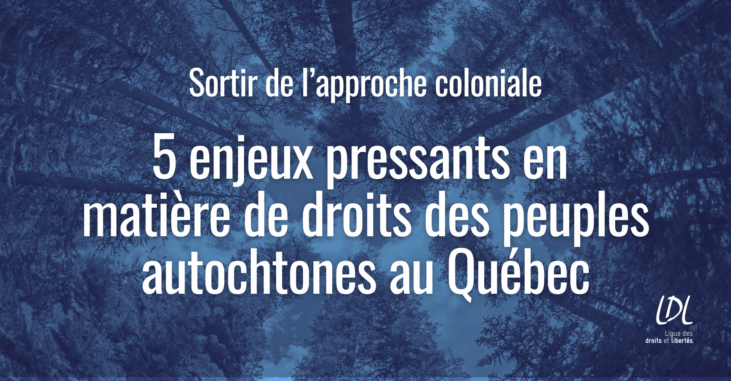Sortir de l’approche coloniale
5 enjeux pressants en matière de droits des peuples autochtones au Québec
Une version imprimée et PDF de cette publication sera disponible vers la fin octobre 2025.
Table des matières
Une négation obstinée du racisme systémique
Sécurisation culturelle et Principe de Joyce
Des réponses gouvernementales maladroites et malavisées
Des recommandations nombreuses qui ne laissent place à aucun doute
Contestation de la Loi fédérale C-92
Femmes et enfants autochtones disparu.es et assassiné.es
Enfants disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement
Droit à l’autodétermination des peuples autochtones
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)
Dialogue de nation à nations et réforme du régime forestier
Pourquoi ce bilan?
La Ligue des droits et libertés (LDL) est une organisation non partisane et indépendante vouée à la promotion et la défense des droits humains depuis 1963. Ses interventions pour exiger le respect des droits des peuples autochtones remontent aux années 1970 et se poursuivent aujourd’hui, en rappelant aux gouvernements leurs obligations en matière de respect des droits humains, dans une perspective fondée sur l’interdépendance des droits.
À titre d’organisation allochtone et de défense des droits et libertés, la LDL adresse ce document principalement aux personnes et organisations allochtones. Ce dernier offre un survol de quelques enjeux importants qui touchent les droits des peuples autochtones au Québec et propose un bilan des (in)actions du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans ce domaine, depuis son accession au pouvoir en 2018. Il poursuit deux principaux objectifs, soit de sensibiliser la population québécoise sur ces enjeux et de réclamer que l’État québécois, quel que soit le parti au pouvoir, respecte ses obligations en vertu du droit national et international relatif aux droits humains.
Après sept ans de gouvernement majoritaire de la CAQ, la LDL croit effectivement qu’il est temps de dresser un bilan critique de la contre-performance de celui-ci et de rappeler au gouvernement et aux partis d’opposition les solutions existantes pour assurer la reconnaissance, la protection et la mise en œuvre des droits des peuples autochtones.
Toutefois, il convient d’insister sur le fait que les obstacles et les reculs dans ce domaine sont loin d’être le fait exclusif du gouvernement provincial actuel. Ils s‘inscrivent en effet dans le prolongement des politiques racistes et assimilationnistes qui ont façonné l’histoire du Québec et du Canada. Les pistes de solution à emprunter sont pourtant claires et devraient interpeller tous les acteurs politiques, tant sur le plan municipal, provincial que fédéral, à qui incombe la responsabilité d’assurer le respect des droits humains.
Quelques avancées ont eu cours dans les dernières années grâce aux efforts de mobilisation des communautés autochtones et une sensibilisation accrue – quoiqu’encore insuffisante – du grand public face aux violences coloniales et à leurs impacts sur les droits humains. Mais force est d’admettre que le portrait global au Québec demeure sombre, se caractérisant soit par un statu quo, soit par des reculs.
Cet outil ne prétend pas à l’exhaustivité. Il propose un tour d’horizon partiel des luttes et des enjeux actuels concernant la défense des droits des peuples autochtones au Québec. Pour l’élaborer, les membres du comité de travail de la LDL sur les droits des peuples autochtones ont consulté de multiples sources documentaires, notamment des communiqués et mémoires d’organisations autochtones, mais sans que ces dernières ne soient directement impliquées dans l’analyse et la rédaction de ce document. Les membres du comité se sont également appuyé.es sur le cadre de référence des droits humains, notamment sur les droits et principes inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), afin d’analyser l’état de la situation au Québec et proposer des recommandations qui permettent la mise en œuvre effective de ces droits.
Une négation obstinée du racisme systémique
| « L’Assemblée générale,
– Extraits de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2007. |
À travers le monde, les violences coloniales et le racisme systémique auxquels sont confrontés les peuples autochtones sont de plus en plus nommés, compris et reconnus, grâce aux luttes incessantes des Autochtones pour défendre leurs droits culturels, ancestraux, territoriaux et à l’autodétermination. Au Québec, plusieurs rapports et recommandations émanant de commissions d’enquête ont mis en lumière l’héritage et les persistances du colonialisme et du racisme systémique ainsi que leurs impacts sur les droits des peuples autochtones.
Le gouvernement Legault, en place depuis 2018, s’est entêté à nier l’existence, au Québec, d’un racisme de nature systémique à l’égard des peuples autochtones. Cette négation a été particulièrement explicite dans les réactions et commentaires du gouvernement lors des occasions suivantes :
- dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) en septembre 2019;
- création du Principe de Joyce par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw en novembre 2020;
- publication du rapport de la coroner Géhane Kamel sur la mort de Joyce Echaquan en octobre 2021;
- l’étude en commission parlementaire en septembre 2023 du projet de loi no 32, Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux;
- le refus, au début du mois de septembre 2025, d’un financement fédéral visant l’équité dans le système judiciaire à travers, notamment, les évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle[1].
Par exemple, en 2021, en réaction au dépôt du rapport de la coroner Kamel, à la suite du décès de Mme Joyce Echaquan, le premier ministre François Legault a affirmé à plusieurs reprises que le racisme systémique a déjà existé au Québec, notamment à l’époque des pensionnats, mais que ce n’est toutefois plus le cas aujourd’hui.
Pour justifier son refus de le reconnaître, le premier ministre s’est servi de cette définition du terme « systémique » donnée par le Petit Robert : « Relatif à un système dans son ensemble ». Il a alors ajouté :
Pour moi, un système, c’est quelque chose qui part d’en haut. Prenons, par exemple, le réseau de la santé. Est-ce qu’il y a quelque chose qui part d’en haut puis qui est communiqué partout dans le réseau de la santé en disant : Soyez discriminatoires dans votre traitement auprès des autochtones? Moi, c’est évident que, pour moi, la réponse, c’est non.[2]
Il est sans doute utile ici de rappeler que les relations entre l’État et les Autochtones au Québec s’inscrivent dans un long historique d’oppression coloniale, marqué notamment par le colonialisme d’occupation et de peuplement, l’usurpation des territoires autochtones et de leurs ressources, le système des pensionnats et les politiques de génocide culturel, la sédentarisation et les déplacements forcés de population, le déni des droits culturels et ancestraux, les politiques d’assimilation et les nombreuses autres formes de violences coloniales, physiques ou symboliques, qui se perpétuent encore aujourd’hui.
Or, pour le premier ministre, la discrimination et le racisme au Québec ne se résumeraient qu’à de rares comportements individuels et isolés : « C’est possible qu’à certains endroits il y a [sic] des employés, des groupes d’employés, peut-être certains cadres qui aient [sic] des approches discriminatoires »[3]. De la même manière, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, estime que « le racisme, c’est souvent le résultat de l’ignorance, du manque de connaissances »[4]. Les deux laissent par ailleurs entendre que parler de racisme systémique est divisif et ne permettrait pas de s’attaquer aux comportements inacceptables.
En réalité, leurs propos témoignent d’un manque de connaissance du système raciste, de ses structures et des mécanismes qui les perpétuent. Réduire le racisme à une série de comportements haineux, intentionnels et individuels, c’est refuser de prendre acte des dimensions systémique, structurelle et institutionnelle du racisme, qui sont abondamment documentées par la science.
Le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, est catégorique à propos de ce déni :
Tant que le gouvernement refusera de reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination à l’égard des Autochtones, les mesures qu’il mettra en œuvre pour soutenir les communautés ne représenteront qu’un pansement sur des problèmes plus profonds[5].
Les enjeux abordés en ces pages illustrent quelques-unes des manifestations du colonialisme et du racisme systémique au Québec, et leurs impacts sur les droits humains des peuples autochtones. Nous aborderons la contre-performance du gouvernement de François Legault quant à plusieurs aspects de la réalité des peuples autochtones. Parmi ceux-ci, nous discuterons d’abord des droits linguistiques, puis nous poursuivrons avec la sécurisation culturelle et le Principe de Joyce. Nous traiterons par la suite de la protection de la jeunesse ainsi que des femmes et enfants autochtones disparus ou assassinés. Nous terminerons par une analyse du rapport problématique qu’entretient le gouvernement de la CAQ avec le droit à l’autodétermination des peuples autochtones.
Droits linguistiques
Depuis leurs premiers contacts avec les populations eurodescendantes, les Inuit, les Abénakis, les Anishinabe, les Atikamekw, les Eeyou, les Hurons-Wendats, les Innus, les Mi’gmaq, les Mohawks, les Naskapis, et les Wolastoqiyik (Malécites)[6] luttent pour assurer la survie et l’épanouissement de leurs langues et leurs cultures face aux politiques racistes, colonialistes et assimilatrices de l’État colonial. Aujourd’hui, plusieurs langues autochtones sont parlées couramment; certaines sont dans un état critique, tandis que d’autres sont en processus de revitalisation.[7]
Non seulement les peuples autochtones ont la lourde tâche de soutenir la résurgence de leurs langues et de leurs cultures, mais ils cherchent aussi à garantir aux nouvelles générations l’accès à une éducation culturellement adaptée. Ils dénoncent par ailleurs l’exclusion et la discrimination vécues dans leurs interactions avec plusieurs institutions et services publics, notamment en raison de la barrière de la langue.
En 2019, le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens) a mis en lumière la discrimination systémique vécue par les Autochtones dans les domaines de la justice, de la santé, des services sociaux, des services correctionnels, de la protection de la jeunesse et des services policiers au Québec. Ce rapport a démontré les difficultés rencontrées par les personnes autochtones, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir des services essentiels dans leur langue d’usage ou leur langue seconde. La Commission concluait que des efforts devaient être faits afin de fournir les services gouvernementaux aux Autochtones de manière sécuritaire et non discriminatoire sur tout le territoire du Québec, ce qui peut signifier que cela soit fait en anglais ou dans leur langue maternelle. Plusieurs appels à l’action ont d’ailleurs été formulés à cet effet[8].
Le 13 mai 2021, Simon Jolin-Barette, alors ministre de la Langue française, a déposé le projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (PL 96). Cette réforme de la Charte de la langue française représentait une occasion unique d’ouvrir un dialogue de nation à nations pour aborder les iniquités documentées par le rapport Viens et dénoncées par les organisations et communautés autochtones elles-mêmes.
Or, ce projet de loi a été élaboré en l’absence d’un tel dialogue. Des représentant-e-s autochtones ont donc interpellé l’Assemblée nationale dans le but de remédier aux discriminations systémiques existantes, notamment les barrières à l’accès équitable pour tous-tes aux services essentiels et aux institutions québécoises, et les obstacles à la réussite scolaire et éducative des élèves autochtones. Comme l’ont souligné l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et les Commissions et organismes régionaux (COR) :
Le gouvernement du Québec ne peut pas se dérober derrière l’ignorance de nos droits ancestraux et constitutionnels et les effets dévastateurs que la politique d’assimilation linguistique au sein de la Charte a sur nos enfants, nos langues, notre culture et nos communautés. Les exemptions qui sont prévues aux articles 95 et 97 actuellement en vigueur ne sont pas suffisamment larges pour assurer le plein exercice des droits constitutionnels linguistiques et la réussite éducative et scolaire des Premières Nations.[9]
Des leaders et pédagogues autochtones dénoncent, d’une part, que les exigences actuelles en matière de maîtrise de la langue française compromettent la réussite scolaire et les perspectives d’avenir des jeunes de leurs communautés; et d’autre part, que la protection et le renforcement des langues ancestrales autochtones et leur usage dans l’enseignement dispensé aux Autochtones sont loin d’être généralisés. Malheureusement, l’Assemblée nationale a plutôt fait le choix d’adopter en mai 2022 le PL 96, qui ne tenait compte ni des droits ancestraux et constitutionnels des Peuples autochtones, ni des recommandations du Rapport Viens, ni des solutions proposées par des communautés et représentant-e-s autochtones au Québec.
Un geste qui, selon l’APNQL, marque un « recul historique dans les relations entre le gouvernement et les Autochtones » et « remet à un avenir incertain la réconciliation avec les Premières Nations »[10]. En réponse, l’APNQL et le CEPN ont déposé, en avril 2023, une contestation de la loi 96 et une demande de contrôle judiciaire visant 14 articles à la Cour supérieure du Québec : en plus de mettre en péril la réussite scolaire et professionnelle des Autochtones, les dispositions de la loi constituent une violation de leurs droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale en matière d’éducation[11]. Il s’agit d’un droit inscrit en toutes lettres à l’article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982 et dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), à laquelle le Canada est lié depuis 2016. La contestation de la loi 96 s’est poursuivie à travers le dépôt, en octobre 2024, d’une pétition demandant au gouvernement d’en exempter les étudiant-e-s autochtones[12].
Malgré les demandes claires des organisations autochtones, le gouvernement n’a trouvé qu’à offrir des « mesures administratives » (dont un Plan d’action incluant un financement sur cinq ans) et proposé d’élaborer un projet de loi pour protéger les langues autochtones[13]. Cette idée a été décriée par des leaders autochtones qui dénoncent, encore une fois, l’approche d’un gouvernement qui choisit d’ignorer leurs demandes et qui impose des « solutions » paternalistes et déconnectées de leurs réalités, sans considération pour leur droit à l’autodétermination. Suite aux consultations et devant ces protestations, le gouvernement a choisi d’abandonner cette idée de projet de loi[14].
En plein cœur de la Décennie internationale des langues autochtones décrétée par l’UNESCO (2022-2032), les Premières Nations identifient des mesures concrètes afin de mettre un terme à la discrimination systémique dans les institutions québécoises et faire des droits des peuples autochtones, notamment leurs droits culturels, linguistiques et ancestraux, une réalité au Québec.
Les obligations de l’État québécois sont d’ailleurs claires à cet égard : il doit respecter et mettre en œuvre le droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, entre autres pour « décider des mesures requises pour offrir une éducation culturellement adaptée à leurs membres et ainsi assurer tant leur sécurité que la continuité de leur culture distinctive »[15]. De même, des ressources doivent être allouées pour protéger et renforcer les langues autochtones, et pour soutenir leur épanouissement. En outre, il faut prévoir une exemption claire et généralisée de l’application de la Charte de la langue française pour tous les peuples autochtones, de manière à reconnaître leur spécificité et à corriger les discriminations subies. Enfin, la prise de décision sur toute initiative affectant les droits autochtones, incluant les droits linguistiques et culturels, doit être réalisée sous le leadership des peuples autochtones et avec leur pleine participation active, en respect du principe du dialogue de nation à nations.i
Sécurisation culturelle et Principe de Joyce
En septembre 2020, Joyce Echaquan, une femme atikamekw de 37 ans de la communauté de Manawan est décédée à l’hôpital de Joliette sous une pluie d’insultes racistes et sans que son droit à consentir ou non aux soins soit respecté. Ce drame a causé un traumatisme et une blessure profonde chez les peuples autochtones. Ce nouveau cas de violence raciste a également exacerbé, à juste titre, la méfiance traditionnelle de ces communautés envers le système de santé québécois.
Cet événement tragique a conduit le Conseil des Atikamekw de Manawan à lancer, en octobre 2020, une consultation publique sur le système québécois de santé et de services sociaux[16]. Cette consultation a accueilli les témoignages des membres des Premières Nations et des communautés inuites, mais était également ouverte aux contributions de citoyen-nes allochtones[17]. Elles ont alimenté les travaux qui ont servi à tracer les grandes lignes de ce que l’on nomme le Principe de Joyce.
|
Il a depuis été adopté à l’unanimité par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL). En 2023, le Conseil des Atikamekw de Manawan a mis sur pied le Bureau du Principe de Joyce, chargé d’assurer la reconnaissance, la promotion et la mise en œuvre de ce principe[19].
Le cas de Mme Echaquan est loin d’être isolé. Comme le rappelle le Bureau du Principe de Joyce, « le cas de Mme Joyce Echaquan n’est malheureusement pas une exception et la situation n’est toujours pas « réglée ». Le Bureau du Principe de Joyce continue de recevoir des témoignages d’usagers qui vivent encore aujourd’hui des épisodes de soins empreints de racisme et de discrimination »[20].
Le rapport de la coroner chargée de ce dossier, Géhane Kamel, est sans équivoque : le décès de Joyce Echaquan aurait pu être évité, et cette dernière a été ostracisée, victime de préjugés raciaux et de racisme systémique[21]. Elle précise que :
Malgré son caractère parfois involontaire, cette forme de racisme a pour effet de perpétuer les inégalités vécues par les personnes d’origine autochtone. Mme Echaquan n’est malheureusement pas la seule à vivre cette situation. Des membres de la communauté, dont le frère de Mme Echaquan, ont exprimé des craintes de même nature en raison d’expériences passées qui étaient similaires.[22]
Elle conclut ainsi son rapport par ces mots : « Le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès »[23]. C’est pourquoi sa première recommandation adressée au gouvernement est que ce dernier « reconnaisse l’existence du racisme systémique au sein de nos institutions et prenne l’engagement de contribuer à son élimination »[24].
François Legault reconnaît que Mme Echaquan a subi du racisme, mais continue à nier l’existence du racisme systémique, y compris à l’hôpital de Joliette, et ce malgré les témoignages recueillis pendant l’enquête de la coroner Kamel.
Le jour même où le gouvernement québécois offrait ses condoléances à la famille de Joyce Echaquan, Sylvie D’Amours, alors ministre responsable des Affaires autochtones, publiait un communiqué pour marquer le premier anniversaire du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens), et se féliciter de l’avancée des travaux. La publication d’une telle autocongratulation dans un moment aussi sombre pour les Autochtones a provoqué des critiques virulentes qui ont entraîné la démission de la ministre.
Des réponses gouvernementales maladroites et malavisées
En raison du drame vécu par Mme Echaquan et des mobilisations autochtones qui ont suivi, la notion de sécurisation culturelle a pris une place plus importante dans le débat public au Québec. Le Principe de Joyce mis de l’avant par la Nation Atikamekw s’inscrit en complète cohérence avec cette notion. Bien qu’il ait été officiellement invité par les Premières Nations à l’adopter, le gouvernement du Québec persiste à s’y opposer.
En juin 2023, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a plutôt déposé le projet de loi no 32, Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux[25]. Ce projet de loi prétendait vouloir mettre de l’avant les réalités culturelles et historiques des Autochtones dans leurs interactions au sein du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu’être plus inclusif à leur égard.
Qu’est-ce que la sécurisation culturelle ?La sécurisation culturelle :
Les soins culturellement sécuritaires :
Conseil canadien de la santé. « Empathie, dignité et respect – Créer la sécurisation culturelle pour les Autochtones dans les systèmes de santé en milieu urbain », décembre 2012, p.5. https://publications.gc.ca/collections/collection_2013/ccs-hcc/H174-39-2012-fra.pdf |
Quelques semaines avant le dépôt du projet de loi, l’APNQL avait demandé à François Legault de renoncer à son dépôt, soulignant que le gouvernement provincial « ne possède pas la compétence pour légiférer sur des sujets qui n’appartiennent qu’aux Premières Nations »[26]. Déjà en 2019, la commission Viens[27] recommandait d’ailleurs, dans son rapport final, d’inscrire dans la loi la notion de sécurisation culturelle, en collaboration avec des représentant-e-s autochtones.
Ainsi, dès le dépôt du projet de loi, plusieurs voix s’élèvent pour le dénoncer. Ghislain Picard, alors chef de l’APNQL, souligne que « la démarche du gouvernement est contradictoire et ne peut mener à une réelle prise de conscience de la réalité et donc parvenir à la sécurisation culturelle »[28]. Les représentant-e-s de Femmes autochtones du Québec (FAQ), de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et du Bureau du Principe de Joyce abondent dans le même sens, en qualifiant ce projet de loi de décevant et insuffisant.
Pourquoi insuffisant? Parce que bien que le Principe de Joyce soit mentionné dans son préambule, celui-ci n’est pas formellement inscrit dans le projet de loi. Ce dernier ne reconnaît toujours pas non plus le racisme systémique que subissent les Autochtones, alors que cette reconnaissance constitue l’un des fondements du Principe de Joyce. De même, le projet de loi reste muet sur l’application du Principe de Jordan, dont le gouvernement doit également tenir compte dans les services de santé[29].
| Le Principe de Jordan a été établi à la suite de la mort du jeune Jordan River Anderson, un autochtone de la Nation Crie décédé à l’hôpital à l’âge de 5 ans et qui n’a pas pu retourner dans sa famille et son milieu avant son décès, parce que les gouvernements fédéral et manitobain n’arrivaient pas à s’entendre sur qui devait assumer les frais de ses soins à domicile. Nommé en la mémoire de cet enfant, le Principe de Jordan vise à s’assurer que « tous les enfants des Premières Nations, sans égard à leur lieu de résidence ou à leur condition, [aient] accès aux services dont ils ont besoin afin de favoriser leur développement et leur plein épanouissement »[30]. |
C’est pourquoi lors des consultations particulières sur le PL 32, en septembre 2023, bon nombre de représentant.es de communautés et d’organisations autochtones se sont opposé.es au projet de loi, réclamant au gouvernement de prendre le temps nécessaire pour collaborer autour d’une éventuelle loi sur la sécurisation culturelle. Les représentantes du Bureau du Principe de Joyce, quant à elles, ont fait un coup d’éclat en claquant la porte des consultations sur ces mots : « Le Bureau du Principe de Joyce ne cautionne pas les pratiques coloniales toujours présentes au sein du gouvernement du Québec et c’est pour cela que nous quittons cette consultation »[31]. En décembre 2024, le projet a néanmoins été adopté et la loi est entrée en vigueur[32].
Les débats entourant la sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé québécois, devenus plus que jamais urgents à la suite du décès tragique de Joyce Echaquan, ont été une véritable occasion manquée pour le gouvernement du Québec. Plutôt que de s’assurer que les Autochtones définissent eux-mêmes ce qui constituerait une réelle sécurisation culturelle, ce dernier a encore une fois choisi d’imposer sa propre vision empreinte de colonialisme.
Protection de la jeunesse
Les enfants autochtones sont largement surreprésenté.es dans le système de protection de la jeunesse. En 2021, au Canada, 53,8 % des enfants placés en famille d’accueil privée étaient autochtones, alors qu’ils ne représentaient que 7.7% de la population de moins de 15 ans[33]. Au Québec, le portrait était similaire : en 2021, on retrouvait 6,2 fois plus d’enfants autochtones parmi les enfants de moins de 14 ans en famille d’accueil[34], tandis que les Autochtones représentaient 2,5% de la population québécoise[35].
Le système québécois de protection de la jeunesse a vu le jour en 1979 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Elle s’est toujours appliquée aux enfants autochtones sans tenir compte adéquatement des réalités culturelles et socioéconomiques de leurs familles et de leurs communautés, ni de l’importance de préserver leur identité culturelle.
Dans un mémoire conjoint déposé en 2020 devant la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) soulignaient que la négligence ainsi que le risque de négligence sont les deux principaux motifs justifiant l’entrée des enfants autochtones dans le système de protection de la jeunesse. Ce risque de négligence tend à être identifié abondamment dans des contextes de précarité. Pourtant, le surpeuplement des maisons, la pauvreté, la violence et la dépendance font partie « des conditions socioéconomiques défavorables héritées du système colonial, qui sous-finance les infrastructures publiques et résidentielles ainsi que les services publics… »[36].
D’autres problèmes liés à la LPJ sont documentés et dénoncés depuis plusieurs années par les Autochtones. Par exemple, le refus de tenir compte de l’importance de la famille élargie au moment de déterminer quels autres adultes significatifs pourraient prendre en charge l’enfant, ou encore les critères concernant l’aménagement intérieur et extérieur exigé des familles d’accueil, des facteurs qui multiplient d’ailleurs le placement d’enfants autochtones dans des milieux non-autochtones[37].
Diverses instances onusiennes chargées de veiller au respect des droits humains ont également porté leur attention sur cet enjeu. Tant le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage se sont alarmés de la surreprésentation des enfants autochtones au sein d’institutions de protection de la jeunesse, tout en dénonçant les causes et les conséquences de ce phénomène[38]. Cette surreprésentation témoigne de l’héritage et des persistances de l’oppression des peuples autochtones par l’État colonial, et en particulier du système des pensionnats et de sa logique génocidaire[39].
Selon le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, la majorité de ces enfants autochtones sont placés dans des familles non-autochtones, ou dans des foyers collectifs non suffisamment encadrés, ce qui les rend particulièrement vulnérables à diverses formes contemporaines d’esclavage. Ces enfants sont également plus susceptibles d’être victimes de violence, de négligence et d’isolement. Enfin, lorsque les enfants en foyer atteignent l’âge limite pour rester dans le système, ils sont souvent contraints de devenir autonomes sans avoir les ressources sociales ou économiques nécessaires pour le faire. Cette situation les pousse à accepter des emplois où ils sont exploités, ou à entrer dans des relations qui les rendent vulnérables à l’exploitation. Les trafiquants d’êtres humains, conscients de cette vulnérabilité, ciblent spécifiquement ces jeunes lorsqu’is atteignent l’âge adulte[40].
Des recommandations nombreuses qui ne laissent place à aucun doute
Les effets dévastateurs du système québécois de protection de la jeunesse sur les enfants, les familles et les communautés autochtones ont été analysés, documentés et dénoncés sur plusieurs tribunes, et ce depuis de nombreuses années. Des pistes de solution concrètes ont d’ores et déjà été identifiées. Ainsi, le gouvernement du Québec doit lire ou relire les documents suivants :
- La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada en 1990, qui souligne que toute solution recherchée pour la protection de l’enfant doit « tenir compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique » (art 20). Cette Convention précise aussi que les enfants autochtones ne peuvent être privés du droit d’avoir leur propre vie culturelle (art 30).
- Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2012) dont les appels à l’action 1 à 5 portent sur la protection de la jeunesse, et qui recommande notamment : la prise en compte des répercussions du système des pensionnats ainsi que l’allocation suffisante de ressources afin de préserver les familles autochtones et de garder les enfants autochtones à l’intérieur de leurs communautés.
- Le rapport de la Commission Viens (Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics) (2019), dont 45% des appels à l’action concernent la protection de la jeunesse et les services de santé et services sociaux, et qui recommande notamment : la mise en place d’un régime particulier de protection de la jeunesse pour les Autochtones ainsi que la reconnaissance du droit des peuples autochtones à l’autodétermination comme orientation incontournable pour repenser les lois et pratiques institutionnelles en la matière.
- L’ENFFADA (enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées) (2019), qui lance 21 appels à la justice destinés au Québec et préconise le respect du droit à l’autodétermination des Autochtones dans le domaine de la protection de la jeunesse afin de garder les enfants autochtones auprès de leurs familles élargies et de leurs communautés.
- Le mémoire conjoint de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), intitulé Le système est « brisé » : des actions concrètes s’imposent pour mettre fin au racisme systémique (février 2020). Celui-ci met en lumière les effets discriminatoires de la LPJ sur les Autochtones ainsi que les modifications qui doivent y être apportées, en plus d’y intégrer les principes de la loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il exige également le respect de l’autorité des gouvernements des Premières Nations et l’application des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
- Le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) (2021) qui destine l’entièreté d’un chapitre aux enjeux vécus par les enfants autochtones et recommande au gouvernement québécois d’assurer la mise en œuvre du droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations et des Inuit en matière de protection de la jeunesse.
- La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) (2007), ratifiée par le Canada en 2016, qui consacre le droit des Autochtones à l’autodétermination. Elle reconnaît également le « droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants » et prohibe « tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les Autochtones […] de leurs valeurs culturelles ».
Contestation de la Loi fédérale C-92
Contribuant à la mise en œuvre de la DNUDPA, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (C-92) a été adoptée par le Canada en juin 2019 et est entrée en vigueur en janvier 2020, avec pour objectif de protéger les liens qu’entretiennent les enfants et les jeunes autochtones avec leur famille, leur communauté et leur culture.
Cette loi fédérale stipule que « les communautés et les groupes autochtones seront libres d’élaborer des politiques et des lois selon leurs propres histoires, cultures et situations »[41]. Comme le soulignent plusieurs organisations autochtones, elle « constitue une avancée sur le plan de la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples autochtones »[42]. Cette loi s’applique à tous les enfants et les jeunes autochtones au Canada, ce qui signifie qu’au Québec, la LPJ n’est plus la seule loi qui s’applique en matière de protection de la jeunesse. D’ailleurs, la loi fédérale interdit dorénavant qu’un enfant entre dans le système de protection de la jeunesse uniquement pour des motifs socioéconomiques.
À la suite de l’adoption de la Loi C-92, le gouvernement du Québec a annoncé en décembre 2019 son intention d’en contester la validité devant la Cour d’appel du Québec, alléguant que celle-ci constitue « une appropriation du champ de compétence exclusif des provinces en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse »[43].
En février 2022, la Cour d’appel provinciale a rendu son jugement et a réitéré la validité de la loi, soulignant que « les régimes provinciaux de services à l’enfance et à la famille n’ont [pas] préséance sur la réglementation autochtone adoptée en vertu du droit ancestral à l’autonomie gouvernementale »[44]. La Cour a cependant jugé que les articles 21 et 22(3) étaient, eux, inconstitutionnels[45]. En réaction à ce jugement, tant le procureur général du Québec que celui du Canada ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada. Or, seul l’appel du Canada a été accueilli par le tribunal. Le jugement de la Cour suprême a été rendu en février 2024 et ne laisse place à aucune ambiguïté : la validité de la Loi C-92 est à nouveau confirmée, et les articles 21 et 22(3) « ne modifient pas l’architecture de la Constitution »[46]. Le jugement reconnaît ainsi la compétence des collectivités autochtones en matière de services à l’enfance et les nouvelles dispositions en matière de protection de la jeunesse autochtone, par les autochtones, devront être respectées.
Cette affaire montre que les enjeux liés au partage des compétences fédérales-provinciales ont souvent des effets délétères sur le respect des droits humains, en particulier ceux des peuples autochtones. D’ailleurs, après sa visite au Canada en septembre et octobre 2023, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage soulignait que :
Les modalités actuelles de partage des compétences entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux conduisent systématiquement à un manque de coordination entre les autorités qui a pour effet de rendre certains groupes plus vulnérables aux formes contemporaines d’esclavage et d’entraver les efforts visant à protéger et aider les victimes, ce qui nuit particulièrement aux peuples autochtones, aux migrants, aux personnes sans abri et aux personnes handicapées.[47]
Le dossier de la protection de la jeunesse fournit un exemple supplémentaire où les droits humains se butent à ces enjeux de partage des compétences. Il est inadmissible que le gouvernement du Québec mette l’accent sur les conflits de juridiction entre le provincial et le fédéral alors que ce sont les droits des peuples autochtones à l’autodétermination et les droits des enfants qui sont directement en jeu. En réaction à la décision du plus haut tribunal du pays, Ghislain Picard, ancien chef de l’APNQL, rappelait : « Nous n’avons jamais cédé nos droits ou délégué à quelque gouvernement […] la prise en charge de nos enfants. Aujourd’hui, c’est ce que ce jugement reconnaît enfin »[48].
La revendication de ce droit à l’autodétermination dans le domaine de la protection de la jeunesse s’est d’ailleurs poursuivie avec le projet de loi no 37, Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants : celui-ci prévoyait la nomination d’un commissaire associé dédié aux enfants autochtones, ce à quoi les organisations autochtones se sont opposées lors des auditions publiques de février 2024[49]. Le projet a finalement été amendé de manière à retirer cette disposition et, désormais, l’implication du commissaire dans la protection de la jeunesse autochtone se limite à la possibilité de conclure une entente de collaboration ou de concertation avec les représentants des Premières Nations ou des Inuit[50].
Femmes et enfants autochtones disparu.es et assassiné.es
Considérant le contexte sociohistorique propre au Québec par rapport au reste du Canada, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a rédigé un rapport spécifique sur la situation dans cette province. En raison du peu d’études sur les réalités des femmes et des filles autochtones, particulièrement sur les formes de violence qu’elles ont connues ou qui persistent, le Québec est la seule province au Canada à avoir bénéficié d’un tel rapport distinct. Ce dernier démontre, entre autres, que le système de justice québécois échoue à protéger les femmes et filles autochtones, tout en déplorant un manque criant de statistiques en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées dans la province.
Bien que le gouvernement provincial ait pris certaines mesures pour répondre aux appels à la justice de l’ENFFADA, ses actions pour lutter contre les disparitions et les meurtres des femmes et filles autochtones sont jugées encore inadéquates et insuffisantes[51]. Depuis le dépôt du rapport de l’ENFFADA, en 2019, les organismes autochtones sont pourtant clairs : les disparitions et les meurtres au Québec ne diminuent pas[52].
Enfants disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement
Le gouvernement du Québec a adopté en juin 2021 le projet de loi no 79, Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement. Cette loi répondait à l’appel à la justice no 20 de l’ENFFADA, que l’on retrouve dans le rapport spécifique sur le Québec soit : « remettre aux familles autochtones toutes les informations dont dispose [le gouvernement] concernant les enfants qui leur ont été enlevés suite à une admission dans un hôpital ou tout autre centre de santé au Québec »[53]. La loi prévoit également, à son article 13, une disposition permettant la création d’une commission d‘enquête sur les circonstances de la disparition ou du décès de l‘enfant, lorsque des pistes de renseignements existent[54]. Cette initiative a été perçue comme une avancée par plusieurs organisations autochtones, qui la considèrent toutefois encore bien insuffisante.
C’est dans cette optique que l’organisation Femmes Autochtones du Québec (FAQ) a dénoncé les lacunes importantes et le mandat trop restreint de cette loi, considérant notamment que les disparitions d’enfants autochtones constituent une violation grave de droits humains, qui s’inscrivent dans le cadre plus large des politiques d’assimilation et d’effacement des peuples autochtones mises en place par l’État colonial. La FAQ considère que la loi devrait aller au-delà de la recherche des circonstances entourant les disparitions ou les décès d’enfants, et plutôt en chercher les causes et les raisons systémiques[55]. L’organisation déplore aussi le fait que cette loi confie le pouvoir d’enquête au ministre responsable des Affaires autochtones (ou à la personne qu’il désigne). Considérant le rôle joué par l’État dans le traitement réservé aux enfants autochtones, cela soulève des enjeux d’indépendance et semble pour le moins « inadéquat »[56]. La FAQ reproche à la loi de ne répondre qu’en partie aux appels du rapport de l’ENFFADA : la recommandation no 21, entre autres, demande plus largement au gouvernement du Québec de créer une commission d’enquête qui soit indépendante et majoritairement autochtone[57]. De plus, la FAQ souligne la charge importante qui est mise sur le dos des familles autochtones dans la démarche. Alors qu’elles doivent déjà composer avec la douleur de la perte de leur enfant, c’est à elles qu’incombe la charge de récolter et déchiffrer des documents et de monter les dossiers complexes[58], bien qu’elles puissent parfois bénéficier du support de l’organisme Awacak – Petits êtres de lumière[59].
Le Rapport final publié en 2024 par l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes au Canada, Kimberly R. Murray, supporte les critiques de la FAQ : il souligne clairement le manque d’autonomie accordée aux Autochtones dans ce domaine, en contradiction avec le texte et l’esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), « qui reconnaît les droits souverains et culturels collectifs des peuples autochtones d’accéder aux documents et à l’information institutionnels »[60].
De plus, une autre problématique réside dans le fait que la loi établit une date butoir sur l’année de disparition des enfants, soit 1992, année qui correspond officiellement à la fermeture des derniers « hôpitaux indiens ». Selon la directrice d’Awacak, « la date butoir de 1992 est un obstacle pour nous, car des familles ont perdu des enfants après ces années. Cette date butoir devrait être éliminée pour pouvoir donner le service aux familles qui ont perdu leurs enfants et qui en souffrent terriblement »[61].
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, en septembre 2021, et jusqu’en février 2025, 121 familles ont entamé des démarches pour tenter de retrouver, en tout, 209 enfants[62]. En considérant les disparitions et décès survenus après 1992, cela signifie que les établissements de santé et de services sociaux québécois ont laissé dans l’ignorance plus d’une centaine de familles sur le sort de leur enfant. Le gouvernement québécois doit être davantage proactif dans sa gestion de cette crise, afin d’aider le plus rapidement possible les familles à retrouver les traces de leur enfant et ainsi guérir des blessures ouvertes depuis des décennies.
Droit à l’autodétermination des peuples autochtones
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)
L’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité, le 8 octobre 2019, une motion d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Le 1er octobre 2020, une nouvelle motion a été adoptée à l’unanimité, demandant au premier ministre de s’entendre dans les meilleurs délais avec les autorités autochtones sur les définitions des dispositions et des principes de cette déclaration, afin d’élaborer et d’adopter les modifications législatives nécessaires.
Cependant, même s’il adhère aux principes de la DNUDPA, le gouvernement provincial ne l’a toujours pas intégrée au cadre législatif et exécutif québécois[63], ce qui montre sa réticence explicite à respecter, protéger et mettre en œuvre les droits qui y sont énoncés. La DNUDPA est pourtant formellement inscrite dans la loi canadienne depuis 2021[64]. Lors d’un point de presse en août 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, expliquait qu’il craignait que cette Déclaration ne permette d’accorder un « droit de veto » aux Autochtones sur plusieurs projets économiques[65]. Il faisait alors explicitement référence aux articles de la Déclaration « sur le consentement, donné librement et en connaissance de cause » par les communautés autochtones, et plus particulièrement à l’article 32 qui précise que celui-ci doit être obtenu « avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ».
Cette réponse du premier ministre témoigne d’une mauvaise compréhension du droit au consentement préalable libre et éclairé (CPLE). En effet, dans un article publié dans la revue Droits & libertés, le professeur Martin Papillon rappelle que « la portée du CPLE dépendrait de la nature et de la gravité de l’atteinte aux droits. Plus les conséquences des activités extractives sont importantes, plus l’obligation d’obtenir le consentement deviendrait importante »[66]. Selon cette interprétation, sans représenter un droit de veto sur tous les projets économiques, le consentement préalable libre et éclairé impliquerait un droit pour les communautés autochtones de refuser certains projets si les conséquences appréhendées sur leur avenir étaient majeures.
Le premier ministre invoquait aussi un risque pour l’intégrité du territoire et le droit à l’autodétermination du Québec[67], en se référant aux articles de la DNUDPA et, en particulier, à son article 3 qui affirme : « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Or, ce droit est exactement le même que celui reconnu à tous les peuples aux articles premiers du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un droit auquel plusieurs se sont historiquement référés pour réclamer le droit du Québec à l’autodétermination. Nier l’existence de ce droit pour les peuples autochtones va à l’encontre des obligations du gouvernement en vertu du droit international des droits humains, auquel le Québec, comme le Canada, sont liés. Comme l’affirme l’article premier de la DNUDPA, « les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme ».[68]
Dialogue de nation à nations et réforme du régime forestier
Le gouvernement de la CAQ dit vouloir favoriser des relations de nation à nations avec les peuples autochtones. Pourtant, dans le bilan de son premier mandat, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), M. Ghislain Picard, conclut : « Malheureusement, les relations entre ce gouvernement et nos représentants auront été teintées tantôt par l’arrogance, tantôt par le mépris, le paternalisme ou le manque flagrant de considération pour nos réalités »[69].
La relation du cabinet de la CAQ avec les Premières Nations et les Inuits ne s’est pas pour autant améliorée : le projet de loi no 97, Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, proposé en avril 2025, a suscité une montée de tension, les communautés autochtones dénonçant notamment les atteintes et les menaces qu’il porte à la fois à leurs droits et à l’environnement[70].Plusieurs propositions émises par le MRNF (ministère des Ressources naturelles et des Forêts) sont préoccupantes. Par exemple, la volonté du MRNF de redonner une grande partie de la responsabilité de la planification forestière à l’industrie représenterait un retour en arrière. Confier la responsabilité de la gestion et de la planification forestières aux opérateurs industriels qui en tirent un bénéfice immédiat constitue un conflit d’intérêts flagrant. L’industrie n’est pas tenue de prendre en compte les droits et les intérêts des Premières Nations, contrairement aux gouvernements.[71]
En juillet 2025, l’APNQL a quitté la table de concertation, déplorant l’attitude de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina[72]. La communication s’est néanmoins réouverte et des négociations continuent d’avoir lieu[73]. Il importe de souligner que la contestation politique du projet est sortie des canaux diplomatiques formels : une résistance s’est organisée sous l’égide de l’alliance Première Nation Mamo, créée au mois d’avril par les Gardien.nes du Nehirowisiw Aski, du Nitassinan et du Ndakina[74]. Dans un « exercice de souveraineté ancestrale »[75], ses membres empêchent l’accès des travailleurs.es forestiers aux terres non-cédées[76] et envoient des ordres d’expulsion et de cessation des coupes forestières aux entreprises[77].
Au moment d’écrire ces lignes, en date du 25 septembre 2025, le PL 97 a finalement été abandonné[78]. La mobilisation des communautés autochtones a également entraîné une importante vague de solidarité parmi la population allochtone, et notamment chez les groupes écologistes. Cette mobilisation doit continuer et se renforcer, alors que le gouvernement québécois annonce son intention d’accélérer les projets de développement en territoires ancestraux autochtones, au nom de la souveraineté et des intérêts économiques du Québec.
Conclusion
Après sept ans au pouvoir, on peut dégager certaines constantes dans les discours et agissements du gouvernement de la CAQ au sujet des droits des peuples autochtones – tout en rappelant que les autres gouvernements provinciaux, fédéraux et municipaux ont eux aussi leur part de responsabilité. Les voix et les perspectives autochtones au sujet des enjeux qui les concernent ne sont pas prises en compte, et le manque d’action sérieuse pour enrayer, ou ne serait-ce que reconnaître, le racisme systémique est un problème majeur et transversal. Bien des partis politiques et gouvernements, aux paliers provincial et fédéral, ont un sérieux chemin à parcourir pour assurer la mise en œuvre du droit à l’autodétermination des peuples autochtones. La population allochtone doit également travailler à mieux comprendre le colonialisme et le racisme systémique, leur histoire et leurs persistances aujourd’hui. Elle doit également se mobiliser pour mettre fin aux préjugés racistes, appuyer les luttes des peuples autochtones et rappeler aux gouvernements leurs obligations en matière de respect, de protection et de mise en œuvre des droits humains des peuples autochtones.
En tant qu’organisation vouée à la défense des droits humains, la Ligue des droits et libertés estime que les violations du droit à l’autodétermination doivent être tout particulièrement dénoncées parce qu’elles ont des impacts sur tout un ensemble d’autres droits humains, qui mettent en lumière le principe de l’interdépendance des droits. En effet, la violation du droit à l’autodétermination a des effets directs sur les droits des enfants, le droit à la vie et à la sécurité, à la dignité, à la santé, à l’égalité, ou encore les droits culturels des personnes et communautés autochtones. Pour agir sur tous ces enjeux, il est impératif de placer les communautés, familles, organisations et services sociaux autochtones au cœur des décisions qui les concernent.
La LDL espère que ce document pourra outiller les lecteur-trice-s et leur offrir une meilleure compréhension de certains enjeux liés aux droits des peuples autochtones et à la passivité de l’État québécois dans ce domaine. Rappelons également que cet outil de sensibilisation n’a pas la prétention d’aborder l’ensemble des violations des droits humains des peuples autochtones au Québec, et que plusieurs des enjeux qu’il soulève de façon synthétisée auraient mérité d’être considérablement approfondis.
Afin de se positionner en tant que personnes ou organisations alliées, il est par ailleurs essentiel d’en apprendre davantage sur la situation des peuples et des communautés autochtones au Québec et au Canada. Pour cela, nous proposons à celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin de consulter les différents rapports d’enquête publiés au cours des dernières années et évoqués dans ce document, dont ceux de la Commission Viens, de l’ENFFADA, de la Commission Laurent, de même que les mémoires et analyses produits par les leaders et organisations autochtones.
Outils documentaires
Le comité de travail sur les droits des peuples autochtones de la LDL a alimenté ses réflexions sur son rôle en tant qu’organisation allochtone de défense des droits, son travail et ses projets à partir de certains outils. Parmi ces documents, nous vous invitons à consulter:
Pierre Lepage, « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », Institut Tshakapesh et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2019. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Cali Tzay, « Visite au Canada », A/HRC/54/31/Add.2, 24 juillet 2023. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/139/13/pdf/g2313913.pdf.
APNQL et CSSSPNQL. « Le système est “brisé” : des actions concrètes s’imposent pour mettre fin au racisme systémique » . CSSSPNQL, 12 février 2020, p. 7. https://cssspnql.com/produit/memoire-le-systeme-est-brise-des-actions-concretes-simposent-pour-mettre-fin-au-racisme-systemique/.
Bureau du Principe de Joyce. https://principedejoyce.com/fr/index.
Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec, « Tableau de suivi des réponses aux appels à la justice du rapport Québec de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) », mai 2023. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/srpni/enffada/ENFFADA_rapport-etape_juin2023.pdf.
« Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès – Rapport final », Bibliothèque Assemblée Nationale du Québec – Collection Numérique, 2019. https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=97224.
« Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – version simplifiée », Mikana. https://mikana.ca/declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones/.
APNQL, « Plan d’action de l’APNQL sur le racisme et la discrimination », 29 septembre 2020. https://cssspnql.com/produit/plan-daction-de-lapnql-sur-le-racisme-et-la-discrimination/.
Voir la section « Quelques pistes pour s’informer davantage » de la section Droits des peuples autochtones du site web de la Ligue des droits et libertés : https://liguedesdroits.ca/droits-des-peuples-autochtones/.
Références
[1] Miriam Lafontaine, « Système judiciaire |Québec refuse des fonds fédéraux pour les évaluations de l’incidence de l’origine ethnique ». La Presse, 2 septembre 2025. www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2025-09-02/systeme-judiciaire/quebec-refuse-des-fonds-federaux-pour-les-evaluations-de-l-incidence-de-l-origine-ethnique.php.
[2] Assemblée nationale du Québec, (2021, 5 octobre), Conférence de presse de M. François Legault, premier ministre. https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-77251.html?appelant=MC
[3] Assemblée nationale du Québec, (2021, 5 octobre), Conférence de presse de M. François Legault, premier ministre. https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-77251.html?appelant=MC
[4] Assemblée nationale du Québec, (2021, 9 décembre), Conférence de presse de M. Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, et M. Christopher Skeete, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme – Assemblée nationale du Québec. https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-80311.html
[5] Frédéric Lacroix-Couture, « Des groupes autochtones demandent la reconnaissance du racisme systémique ». La Presse, 16 mars 2023. https://www.lapresse.ca/actualites/2023-03-16/des-groupes-autochtones-demandent-la-reconnaissance-du-racisme-systemique.php.
[6] Ces appellations sont celles adoptées par Femmes Autochtones du Québec (FAQ) et par le Centre de santé Inuulitsivik (pour le peuple inuit). Par souci d’uniformité, nous les utiliserons tout au long de ce document, mais nous reconnaissons toutefois qu’il existe plusieurs manières valides de désigner les nations autochtones.
[7] Suzie Basile, Nancy Wiscutie-Crépeau, et Richard Kistabish, « Réforme de la Loi 101… et les Langues Autochtones? », Radio-Canada, 9 juin 2021. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1800042/reforme-loi-101-absence-langues-autochtones-lettre-ouverte.
[8] Québec (Province), Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, « Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès – Rapport final », Bibliothèque Assemblée Nationale du Québec – Collection Numérique, 2019. http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=97224.
[9] Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador – APNQL et Commissions et organismes régionaux – COR, « Document portant sur le projet de loi 96 », 28 septembre 2021, p. 6. https://cepn-fnec.ca/wp-content/uploads/2022/02/Document-de-lAPNQL-et-les-CORs-sur-le-PL-96.pdf.
[10] « Adoption du projet de loi 96 : « un grand pas en arrière », selon les Premières Nations », Radio-Canada, 26 mai 2022. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886284/autochtone-langue-ghislain-picard-apnql-kahnawake-quebec-francais
[11] Jérôme Gill-Couture, « L’APNQL et le CEPN contestent la Loi sur la langue officielle et commune du Québec », Radio-Canada, 20 avril 2023. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1973039/loi-96-cour-superieure-langues-autochtones.
[12] Assemblée Nationale du Québec, « extrait de pétition », 29 octobre 2024. https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_204657&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
[13] Gouvernement de la Nation Crie, « Plan d’action et loi du Québec pour protéger la culture et la langue autochtones – Une opportunité de faire mieux », Communiqué de presse, 23 juin 2022. https://www.cngov.ca/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-23-gccei_cng_press-release-re-2022_2027-action-plan-and-possible-indigenous-language-protection-law_fr-1.pdf.
[14] La Presse canadienne, « Projet de loi sur les langues autochtones : Québec appuie sur le frein ». Radio-Canada, 28 septembre 2023. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2013699/langues-autochtones-quebec-recul-loi-101-lafreniere.
[15] Marie-Michèle Sioui, « La loi 96, un obstacle à la réussite des Autochtones? », Le Soleil, 21 avril 2023. https://www.ledevoir.com/politique/quebec/789445/la-loi-96-un-obstacle-a-la-reussite-des-autochtones?
[16] Valérie Boisclair, « « Principe de Joyce » : les Atikamekw lancent une consultation sur les services de santé », Radio-Canada, 15 octobre 2020. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1741287/principe-joyce-echaquan-consultation-publique-nation-atikamekw.
[17] Ibid.
[18] « Accueil », Bureau du Principe de Joyce. https://principedejoyce.com/fr/index.
[19] Myriam Boulianne, « Le Conseil des Atikamekw de Manawan lance le Bureau du Principe de Joyce », Radio-Canada, 28 juillet 2023. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1999784/bureau-principe-joyce-echaquan-joliette.
[20] Jennifer Petiquay-Dufresne et al., Le Principe de Joyce et l’importance du respect des droits fondamentaux des Autochtones dans la transformation des soins et services visant la sécurité culturelle au sein du réseau québécois de la santé et des services sociaux – Pour l’équité d’accès en santé pour les Autochtones, une approche coloniale est à éliminer, Assemblée nationale du Québec, 13 septembre 2023, p. 24. https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_191789&process=Default.
[21] Géhane Kamel, « Rapport d’enquête – Décès de Mme Joyce Echaquan », Bureau du Coroner, 8 septembre 2021, p. 20. https://www.coroner.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/Enqu%C3%AAtes_publiques/Joyce_Echaquan/2020-EP00275-9.pdf.
[22] Ibid, p. 12.
[23] Ibid, p. 20.
[24] Ibid.
[25] PL 32, Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, 1ère sess, 43e leg, Québec, 2023 (sanctionné le 5 décembre 2024), LQ 2024, c 42. https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-32-43-1.html.
[26] Fany Lévesque, « Langues et Sécurisation Culturelle | les Premières Nations demandent à la CAQ de renoncer à deux projets de loi », La Presse, 17 mars 2023. https://www.lapresse.ca/actualites/2023-03-17/langues-et-securisation-culturelle/les-premieres-nations-demandent-a-la-caq-de-renoncer-a-deux-projets-de-loi.php.
[27] Québec (Province), Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, « Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès – Rapport final », Bibliothèque Assemblée Nationale du Québec – Collection Numérique, 2019. https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=97224.
[28] Caroline Plante, « Le projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle reçoit un accueil tiède à l’APNQL », Le Devoir, 12 juin 2023. https://www.ledevoir.com/politique/quebec/792830/le-projet-de-loi-32-sur-la-securisation-culturelle-recoit-un-accueil-tiede-a-l-apnql.
[29] CSSSPNQL, « Principe de Jordan ». https://cssspnql.com/principe-de-jordan/.
[31] Radio-Canada Info, « Sécurisation culturelle en santé : Le Bureau du Principe de Joyce quitte les audiences », Radio-Canada, 13 septembre 2023. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2009994/principe-joyce-securisation-culturelle-audiences.
[32] PL 32, op. cit.
[33] Tara Hahmann, Hyunji Lee, et Sylvie Godin, « Enfants autochtones en famille d’accueil vivant dans des ménages privés : taux et caractéristiques sociodémographiques des enfants en famille d’accueil et des ménages », Statistique Canada, 18 avril 2024. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022024001-fra.htm
[34] Statistique Canada, « Disparité entre les taux d’enfants autochtones et non autochtones en famille d’accueil âgés de 14 ans et moins dans les ménages privés, selon la province ou le territoire, Canada, 2011, 2016 et 2021 ». https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022024001-fra.htm.
[35] Statistique Canada, Série « Perspective géographique » – Recensement de la population de 2021 – Québec, province. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/as-sa/fogs-spg/page.cfm?topic=8&lang=F&dguid=2021A000224.
[36] APNQL et CSSSPNQL, « Le système est “brisé” : des actions concrètes s’imposent pour mettre fin au racisme systémique », CSSSPNQL, 12 février 2020, p. 7. https://cssspnql.com/produit/memoire-le-systeme-est-brise-des-actions-concretes-simposent-pour-mettre-fin-au-racisme-systemique/.
[37] Ibid.
[38] Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Cali Tzay, « Visite au Canada », A/HRC/54/31/Add.2, 24 juillet 2023, para 31. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/139/13/pdf/g2313913.pdf. Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Tomoya Obokata, « Visite au Canada », A/HRC/57/46/Add.1, 22 juillet 2024, para 79. https://docs.un.org/fr/A/HRC/57/46/Add.1.
[39] Ibid, para 44 à 46.
[40] Ibid, voir aussi le rapport de l’ENFFADA aux p. 726-729.
[41] Services aux Autochtones Canada, « Projet de loi C-92 : La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis reçoit la sanction royale », juin 2019. https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2019/06/la-loi-concernant-les-enfants-les-jeunes-et-les-familles-des-premieres-nations-des-inuits-et-des-metis-recoit-la-sanction-royale.html.
[42] APNQL et CSSSPNQL, « Le système est « brisé »», op.cit.
[43] Laurence Niosi, « Enfants autochtones : le gouvernement Legault conteste l’autorité d’Ottawa », Radio-Canada, 19 décembre 2019. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1442013/enfants-autochtones-renvoi-cour-appel-quebec.
[44] Marie-Laure Josselin, « Protection de l’enfance : victoire en Cour incomplète pour les autochtones », Radio-Canada, 10 février 2022. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1861302/justice-enfant-autochtone-protection-enfance-quebec.
[45] Marie-Laure Josselin, « Protection de l’enfance : victoire totale pour les Autochtones en Cour suprême », Radio-Canada, 9 février 2024. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2048038/enfance-protection-loi-autochtones-c92-justice.
[46] Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2024 CSC 5, 9 février 2024. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/20264/index.do.
[47] Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Tomoya Obokata, « Visite au Canada », op. cit., para 79.
[48] Boris Proulx, « Québec perd sa bataille en Cour suprême sur les DPJ autochtones », Le Devoir, 9 février 2024. www.ledevoir.com/politique/canada/806933/decision-cour-supreme-protection-enfants-autochtones.
[49] Myriam Boulianne, « L’amendement du projet de loi 37 aura le « feu vert » des Autochtones, dit Carmant », La Presse, 19 avril 2024. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2066314/projet-loi-carmant-enfants-autochtones-quebec.
[50] Assemblée nationale du Québec, « Amendements adoptés – PL37 », Projet de loi n° 37, Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants, p. 25 à 28 (pdf). https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_196641&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
[51] Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec, « Tableau de suivi des réponses aux appels à la justice du rapport Québec de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) », mai 2023. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/srpni/enffada/ENFFADA_rapport-etape_juin2023.pdf. Voir aussi : Radio-Canada info. « Des rapports sur la discrimination envers les femmes autochtones du Québec déposés à l’ONU », Radio-Canada.ca, 23 octobre 2024. https://ici.radio-canada.ca/rci/fr/nouvelle/2114463/faq-onu-rapport-discrimination-femmes-autochtones.
[52] Henri Ouellette-Vézina, « Femmes autochtones disparues | “Ça fait trop longtemps que ça dure” », La Presse, 13 février 2021. www.lapresse.ca/actualites/2021-02-13/femmes-autochtones-disparues/ca-fait-trop-longtemps-que-ca-dure.php.
[53] « Tableau de suivi des réponses aux appels à la justice », op. cit., p. 20.
[54] PL 79, Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, 1ere sess, 42e leg, Québec, 2020 (sanctionné le 4 juin 2021), LQ 2021, c 16.
[55] Femmes Autochtones du Québec (FAQ), Projet de loi n° 79 : soutenir les familles d’enfants autochtones disparus ou décédés dans des circonstances douteuses, 1 avril 2021, p. 1. https://faq-qnw.org/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-Communiqu%C3%A9-FR-Projet-de-loi-no-79.pdf.
[56] FAQ, Commentaires de Femmes Autochtones du Québec : dans le cadre des Amendements proposés par le Ministre Lafrenière au Projet de Loi n°79, Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, 6 mai 2021, p. 4. https://faq-qnw.org/wp-content/uploads/2022/07/Amendements_PL79_06-05-21.pdf.
[57] FAQ, Mémoire de Femmes Autochtones du Québec : dans le cadre de la Consultation sur le projet de Loi n°79, Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, 31 mars 2021, p. 5. https://faq-qnw.org/wp-content/uploads/2022/04/PL79-M_1-converti.pdf.
[58] FAQ, Commentaires de Femmes Autochtones du Québec : dans le cadre des Amendements proposés, op. cit. p. 4.
[59] Awacak est une association de membres de familles autochtones ayant un enfant ou des enfants disparus ou décédés à la suite de l’admission dans un établissement de la santé et services sociaux, partenaire de la Direction de soutien aux familles (voir « Nos services », Awacak, https://www.awacak.ca/services.html)
[60] Kimberly R. Murray, « Résumé exécutif : Rapport final sur les enfants autochtones disparus et les sépultures anonymes au Canada », Bureau de l’interlocutrice Spéciale Indépendante, octobre 2024, p. 151. https://osi-bis.ca/wp-content/uploads/2024/11/3.BIS-Resume-Executif.pdf.
[61] Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, Rapport annuel 2023-2024 – Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, 2024, p. 7. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/srpni/administratives/rapports/2023-2024_loi-renseignements-familles-enfants-autochtones.pdf.
[62] Cabinet du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit, « Enfants autochtones disparus : un quatrième bilan présenté aux familles à la recherche de réponses », 25 avril 2025. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/enfants-autochtones-disparus-un-quatrieme-bilan-presente-aux-familles-a-la-recherche-de-reponses-62436.
[63] Judith Lachapelle, « Pourquoi les Autochtones ont-ils dénoncé le Québec aux Nations unies ? », La Presse, 12 mai 2025. https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2025-05-12/on-a-pose-la-question-pour-vous/pourquoi-les-autochtones-ont-ils-denonce-le-quebec-aux-nations-unies.php.
[64] Ibid.
[65] La Presse canadienne, « Déclaration de l’ONU : Legault dit non à un droit de veto aux Autochtones », La Presse, 14 août 2020. https://www.lapresse.ca/actualites/2020-08-14/declaration-de-l-onu-legault-dit-non-a-un-droit-de-veto-aux-autochtones.php.
[66] Martin Papillon, « Le consentement préalable, libre et éclairé », Droits et libertés, vol. 34, no 2, automne 2015, p. 24.
[67] Martin Papillon, « Le Québec a-t-il manqué le virage de la réconciliation ? », La Presse, 20 juin 2025. https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2025-06-20/journee-nationale-des-peuples-autochtones/le-quebec-a-t-il-manque-le-virage-de-la-reconciliation.php.
[68] La portée du droit à l’autodétermination reconnu dans la Déclaration est l’objet de différentes interprétations, les États l’ayant négociée ayant obligé l’intégration de l’article 46 affirmant qu’aucune de ses dispositions ne doit avoir « pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain ou indépendant ». Malgré cette clause, pour la LDL, il ne saurait y avoir un droit à l’autodétermination de moindre portée pour les peuples autochtones que pour l’ensemble des autres peuples.
[69] Ghislain Picard, « CAQ et Autochtones : un bilan historiquement décevant », La Presse, 9 juin 2022. https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-06-09/caq-et-autochtones/un-bilan-historiquement-decevant.php.
[70] Philippe Granger, « Projet de loi 97 : l’APNQL demande à Québec de mettre fin à l’« impasse » », Radio-Canada, 18 août 2025. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2186367/apnql-appel-dialogue-pl-97-regime-forestier.
[71] APNQL, Réforme du régime forestier : l’approche et les propositions de la ministre des ressources naturelles et des forêts sont inacceptables, 10 décembre 2024. https://apnql.com/wp-content/uploads/2025/04/2024-12-03_Communiquepresse_regimeforestier_VF_FR-3.pdf.
[72] Ibid.
[73] Amélie Mouton, « Projet de loi 97 : devant la tension et la pression, Québec relance des discussions », Radio-Canada, 21 août 2025. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2186910/projet-de-loi-97-gouvernement-conflit-forestier-atikamekw.
[74] Première Nation MAMO, L’alliance Mamo – contre le projet de loi-97 et la destruction du territoire, 14 mai 2025. www.facebook.com/photo/?fbid=122098652726875072&set=pb.61576252172060.-2207520000.
[75] Dave Petiquay, cité dans Myriam Gauthier et Pascal Girard, « Première Nation Mamo : intensification à venir des actions et des blocages forestiers », Radio-Canada, 7 juin 2025. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2170484/blocus-premiere-nation-chemins.
[76] Émile Lapointe et Alexis Desnoyer-Muckle, « Des manifestants autochtones continuent de perturber les travaux forestiers », Radio-Canada, 26 mai 2025. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2167599/blocage-autochtone-regime-forestier-caq.
[77] Photo publiée sur Facebook le 17 mai par Première Nation MAMO. https://www.facebook.com/photo/?fbid=122101435304875072&set=pb.61576252172060.-2207520000.
[78] Pierre-Alexandre Bolduc et Jérôme Labbé, « Régime forestier : Québec abandonne sa réforme controversée », Radio-Canada, 25 septembre 2025. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2195050/regime-forestier-quebec-abandon-reforme-projet-loi-97.