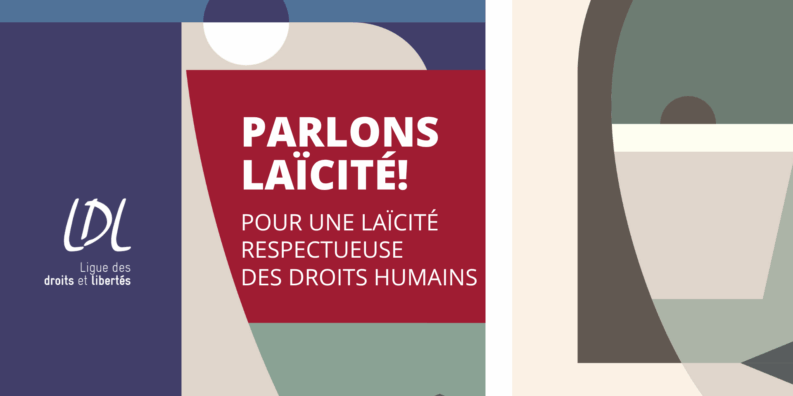Nouvelle publication!
Nouvelle publication!
Parlons laïcité!
Pour une laïcité respectueuse des droits humains
La question de la laïcité de l’État occupe une place centrale dans les débats publics au Québec, et ce n’est pas nouveau.
Alors qu’elle devrait susciter une réflexion posée sur la manière d’aménager le pluralisme religieux dans le respect des droits de tous-tes, elle est devenue source de clivages et de profondes divisions sociales.
Avec cette brochure, la Ligue des droits et libertés souhaite offrir des repères pour mieux comprendre ce qu’est réellement la laïcité de l’État, et montrer en quoi les politiques du gouvernement québécois en la matière s’en écartent de manière radicale.
Parlons laïcité! déconstruit certains mythes et discours erronés qui cherchent à opposer la laïcité aux Chartes et aux droits humains. Elle rappelle également que la laïcité n’est ni une « valeur québécoise » ni un instrument d’exclusion, mais un cadre destiné à favoriser le respect des droits et libertés au sein d’une société pluraliste.
Cet outil a été réalisé par le Comité racisme systémique, exclusion sociale et laïcité de l’État de la Ligue des droits et libertés.
Visuels à utiliser



Table des matières
1. Les principes de base de la laïcité
2. Laïcisation du Québec et droits humains
3. La laïcité n’est pas une « valeur québécoise »
4. Laïcité et droits des femmes
5. Prosélytisme et port de signes religieux
6. Laïcité, racisme et xénophobie
Pour une laïcité respectueuse des droits!
Introduction
La question de la laïcité de l’État occupe une place centrale dans les débats publics au Québec, et ce n’est pas nouveau. Alors qu’elle devrait susciter une réflexion posée sur la manière d’aménager le pluralisme religieux dans le respect des droits de tous-tes, elle est devenue source de clivages et de profondes divisions sociales.
Avec cette brochure, la LDL souhaite offrir des repères pour mieux comprendre ce qu’est réellement la laïcité de l’État, et montrer en quoi les politiques du gouvernement québécois en la matière s’en écartent de manière radicale. Elle déconstruit certains mythes et discours erronés qui cherchent à opposer la laïcité aux Chartes et aux droits humains. Elle rappelle également que la laïcité n’est ni une « valeur québécoise » ni un instrument d’exclusion, mais un cadre destiné à favoriser le respect des droits et libertés au sein d’une société pluraliste.
1. Les principes de base de la laïcité
La laïcité repose sur deux grands principes :
- La séparation de l’Église et de l’État
- La neutralité religieuse de l’État
Le principe de séparation de l’Église et de l’État vise à faire primer le lien civique (l’appartenance à une société donnée) sur le lien religieux. Autrement dit, ce qui nous unit comme société est l’ordre politique commun auquel nous participons et non la religion. Ce principe implique que l’État n’intervient pas dans la vie et le fonctionnement des institutions religieuses, tandis que ces dernières s’abstiennent d’interférer dans les activités, les orientations et le fonctionnement de l’État.
C’est pourquoi on parle généralement d’autonomie et d’indépendance réciproque de l’Église et de l’État.
Le principe de neutralité suppose quant à lui que l’État ne favorise – ni ne défavorise – aucune religion et qu’il traite les citoyen-nes en toute égalité, sans égard à leurs (in)croyances religieuses et spirituelles, ou à l’expression de celles-ci. Ce principe vise à garantir le droit à l’égalité et le respect des libertés de conscience, d’expression, de culte, de religion et de réunion pacifique, qui sont protégés par les Chartes canadienne et québécoise.
Ainsi, un gouvernement qui accorde des exemptions fiscales à des institutions religieuses ou qui les finance directement, comme c’est le cas actuellement au Québec pour les écoles privées confessionnelles, contrevient au principe de séparation de l’Église et de l’État, et en même temps au principe de neutralité puisqu’il favorise certaines religions par le biais de ces financements.
Lorsqu’un gouvernement adopte des lois qui empêchent certaines personnes d’exercer une fonction ou une profession en raison de l’expression de leurs croyances religieuses, il institue une discrimination directe qui est en contradiction avec le principe de neutralité religieuse de l’État, et donc, avec la laïcité elle-même!
À partir de ces deux principes, on comprend que la véritable laïcité de l’État a pour principale finalité de garantir le plein exercice des droits et libertés de tous-tes.
Ces deux principes visent à favoriser la cohésion sociale dans une société marquée par la diversité des (in)croyances religieuses et spirituelles. Il s’agit ainsi de s’assurer que les personnes puissent évoluer en société en toute égalité, sans crainte d’être discriminées ou persécutées en raison de leurs appartenances religieuses ou de l’expression de ces dernières.
Il convient par ailleurs d’insister sur le fait que la laïcité n’implique pas l’absence d’expression du religieux dans l’espace public. Cette idée fausse relève d’un mode de gestion de la diversité religieuse que l’on appelle le laïcisme, et qui est liberticide et contraire aux droits humains!
En effet, la laïcité implique de permettre aux personnes d’exercer, individuellement et collectivement, leurs libertés de culte, de religion, d’expression et de réunion pacifique, y compris dans l’espace public. Un gouvernement qui souhaite bannir les prières ou les rassemblements de nature religieuse ou spirituelle dans l’espace public s’attaque ainsi de plein fouet, non seulement à ces libertés fondamentales, mais au principe de neutralité religieuse de l’État.
| Laïcisme
Alors que la laïcité suppose la neutralité de l’État et garantit la liberté de conscience de tous-tes, le laïcisme cherche à éliminer les expressions religieuses de l’espace public, au-delà des institutions de l’État, et à restreindre les manifestations personnelles (vêtements, symboles, pratiques) des appartenances, convictions et croyances religieuses. |
Le respect des droits humains doit donc être au cœur de toute loi ou politique visant à assurer la laïcité de l’État. Un gouvernement qui oppose la laïcité aux droits humains et déroge aux Chartes des droits fait fausse route puisqu’il s’attaque simultanément à notre système de protection des droits humains et aux fondements mêmes de la laïcité!
2. Laïcisation du Québec et droits humains
La laïcité de l’État n’implique pas de déroger aux Chartes des droits, de contourner le pouvoir des tribunaux, ni de bafouer les droits humains.
Depuis les années 1960, l’approfondissement de la laïcité de l’État québécois est allé de pair avec le mouvement pour la défense des droits humains. Par exemple, dès sa fondation en 1963, la LDL a combattu la censure exercée par l’Église catholique et lutté contre les forces religieuses conservatrices opposées notamment à la liberté de parole, à l’immigration, au pluralisme religieux et à la reconnaissance des droits des femmes et des personnes LGBTQ2+. Elle a également milité contre la mainmise religieuse sur l’éducation en revendiquant un système d’éducation non confessionnel et respectueux des droits et libertés.
L’adoption en 1975 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec constitue à cet égard un jalon majeur du processus de laïcisation de l’État. En effet, cette loi fondamentale garantit la liberté de conscience, d’expression, de culte et de religion (art. 3), le droit l’égalité de tous-tes sans discrimination (art. 10), de même qu’un vaste ensemble de droits civils, politiques, économiques et sociaux inspirés des normes du droit international des droits humains.
Ainsi, lorsqu’un gouvernement porte atteinte aux droits et libertés au nom de la laïcité, il s’écarte du chemin vers la laïcité et pour la défense des droits humains qui a marqué le Québec contemporain. La Loi sur la laïcité de l’État et les autres lois adoptées ou proposées par le gouvernement québécois pour la « renforcer » constituent de ce point de vue un recul historique majeur.
Rappelons que le Québec a signé et ratifié une série de déclarations, conventions et pactes internationaux auxquels il est lié, dont :
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948)
- la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales (1965)
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
- le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux (1966)
- la Convention relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1979).
Tous ces textes garantissent plusieurs droits et libertés que la laïcité peut et doit protéger, dont le droit à l’égalité et à la non-discrimination, les libertés de conscience, de religion, de culte, d’expression et d’association, ainsi que plusieurs droits économiques, sociaux et culturels. Rappelons par ailleurs qu’une atteinte à un droit a automatiquement des conséquences sur l’ensemble des autres droits humains, puisque – comme le rappelle la Déclaration et le Programme d’action de Vienne (1993), tous les droits sont indissociables, interdépendants et intimement liés.
Par ailleurs, la laïcité de l’État doit garantir, dans la pratique, l’égalité entre les personnes. C’est pourquoi il peut parfois s’avérer nécessaire de prendre des mesures correctrices ou d’accommodement pour éliminer certaines formes de discriminations, qu’elles soient directes, indirectes, institutionnelles ou systémiques.
Ainsi, les institutions doivent parfois mettre en place diverses formes d’accommodements lorsque cela ne leur impose pas de contraintes excessives et permet de tendre vers une protection accrue du droit à l’égalité.
Par exemple, dans un calendrier où des jours fériés d’ancrage chrétien sont déjà reconnus, les personnes d’autres confessions peuvent obtenir un accommodement raisonnable (jour flottant, déplacement de congé, échange de quart) pour leur permettre de participer à certaines célébrations religieuses importantes. Si cela ne pose pas de contrainte excessive, les institutions peuvent accorder ce type d’accommodements, ce qui corrige une inégalité de fait.
En ce sens, les accommodements raisonnables pour motifs religieux ne sont pas contraires à la laïcité ; dans la majorité des cas, ils permettent d’en approfondir l’un des objectifs, qui est de réduire les inégalités.
3. La laïcité n’est pas une « valeur québécoise »
Depuis plusieurs années, on voit se multiplier au Québec les amalgames trompeurs entre la protection de la nation québécoise et la défense de la laïcité, cette dernière étant présentée comme une « valeur québécoise ».
Il convient d’abord de rappeler que la laïcité n’est pas une valeur, et encore moins québécoise. En réalité, il s’agit d’un mode d’aménagement du pluralisme religieux et du séculier adopté par de nombreux États dont l’objectif premier est le respect des droits et libertés de tous-tes.
Un gouvernement qui s’arroge le pouvoir d’imposer les soi-disant « valeurs de la majorité » ne se contente pas seulement de bafouer les droits humains : il va à l’encontre de l’objectif fondamental de la laïcité, qui est de garantir la liberté de conscience et l’autonomie morale des individus.
Un gouvernement qui cherche à imposer les valeurs de la majorité, en ciblant les membres de certaines minorités, glisse vers une forme d’autoritarisme qu’il est impératif de dénoncer. Il participe aussi à alimenter un néoracisme culturel, en présentant les membres de certaines communautés comme des « menaces » à la culture ou aux « valeurs de la majorité ».
| Néo-racisme
« Historiquement, le racisme reposait sur la théorie biologisante des races. Toutefois, plus récemment, des chercheurs ont constaté que le processus de racisation peut aussi reposer sur une identité culturelle stéréotypée et supposée inhérente à un groupe présenté comme homogène. Cette culture est considérée comme inférieur et irréconciliable avec la culture dominante, et souvent comme une menace à la préservation des identités nationales. Dans ce cas, on parle de néo-racisme ou de racisme culturel. L’islamophobie est un des plus flagrants exemples aujourd’hui de ce ‘’racisme sans race’’. » Ligue des droits et libertés, Le racisme systémique… Parlons-en!, 2022, p. 4. |
Lorsqu’un gouvernement invoque les « valeurs nationales » pour restreindre l’exercice du droit à l’égalité et des libertés civiles, il s’attaque directement aux droits humains que la laïcité a pourtant pour objectif de protéger.
4. Laïcité et droits des femmes
Les éléments conservateurs de plusieurs religions véhiculent souvent des discours et des idées misogynes, qui leur valent de vives critiques, y compris au sein de leurs propres communautés de foi.
Au Québec, par exemple, les mouvements féministes ont dû se battre contre la mainmise des autorités religieuses – surtout catholiques – sur l’État, qui prétendaient régir leur vie conjugale, sexuelle et reproductive. L’union de fait, le mariage civil, la liberté en matière de contraception et d’avortement, et les programmes d’accès à l’égalité en emploi figurent parmi les conquêtes majeures issues de ces luttes. Ainsi, le processus de laïcisation de l’État québécois a pu jouer un rôle favorable aux droits des femmes au Québec.
Le mouvement pour la défense des droits humains s’est également révélé être un allié précieux du féminisme. En interdisant la discrimination fondée sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle, et en garantissant la liberté de conscience et de religion, les instruments de protection de ces droits constituent des leviers puissants pour appuyer les luttes féministes.
Or, on observe une tendance inquiétante depuis plusieurs années, soit celle d’invoquer la laïcité pour restreindre les droits de certaines femmes, en particulier les femmes musulmanes qui portent le voile. La neutralité religieuse de l’État ne saurait justifier l’exclusion de certaines femmes de professions, formations ou stages en milieux publics ou privés, comme le fait la Loi sur la laïcité de l’État. Depuis longtemps, les mouvements féministes soulignent que l’accès à un emploi rémunéré permet aux femmes de gagner en autonomie, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan des décisions concernant leurs choix de vie.
Dans le cadre des débats actuels sur la laïcité au Québec, on observe toutefois un ressac important. En effet, on voit émerger une forme particulièrement pernicieuse de colonialisme et de paternalisme d’État, lorsque le gouvernement prétend vouloir « libérer » les femmes musulmanes portant le voile. Prendre pour acquis que le voile est imposé aux femmes, et qu’elles le portent par coercition, est non seulement erroné, mais constitue l’héritage d’une vision colonialiste du monde occidental sur le monde musulman. Le fait de s’arroger le droit de définir la condition des femmes musulmanes nie leur agentivité et reproduit une vision hiérarchisée des cultures, dans laquelle l’Occident se pose en modèle universel d’émancipation.
Cette volonté d’assimilation occulte la pluralité des significations que peut revêtir le voile – une expression identitaire, une pratique spirituelle, un choix individuel ou encore une forme de résistance symbolique – et contribue à renforcer des préjugés islamophobes.
Toute lutte pour la liberté de choix des femmes doit s’assurer de ne pas soutenir ici des violences étatiques telles que la Loi sur la laïcité de l’État, qui dit aux femmes quoi porter ou non et les exclut de milieux de travail pour lesquels elles sont pleinement qualifiées.
Si le gouvernement souhaite réellement favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, il ne doit pas s’attaquer aux droits et libertés des membres de certaines communautés, mais adopter des mesures pour lutter contre les diverses formes de discriminations, de violences et d’oppressions qui menacent les femmes de toutes les origines et confessions.
5. Prosélytisme et port de signes religieux
Le prosélytisme signifie le « zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idées » dont peuvent faire preuve certaines personnes, selon le Larousse. Le prosélytisme religieux réfère donc aux efforts proactifs visant à convaincre ou convertir des personnes à une religion ou une autre.
Plusieurs affirment que le port de signes religieux constituerait un accroc aux deux grands principes de la laïcité, c’est-à-dire la séparation de l’Église et de l’État et la neutralité religieuse de l’État.
Or, c’est tout le contraire : ces principes sont bafoués lorsque l’État institue une discrimination fondée sur la religion en interdisant à certaines personnes d’exercer leur liberté de religion et d’expression au sein des institutions publiques.
On voit également se multiplier au Québec des discours qui font des amalgames trompeurs entre le port de signes religieux et le prosélytisme.
La neutralité religieuse de l’État ne se mesure pas par l’apparence des personnes qui œuvrent en son sein. Inversement, l’absence du port de signes religieux n’est aucunement garante de la neutralité des personnes. Élargir encore davantage l’interdiction vestimentaire, et resserrer le contrôle de l’État sur ce que portent ou non les individus, c’est glisser vers une forme dangereuse d’autoritarisme et faire fausse route pour assurer une véritable laïcité de l’État au Québec. D’autant plus que, au Québec, l’impartialité, le devoir de réserve et l’interdiction du prosélytisme pour les membres du personnel de l’État sont déjà inscrits dans la loi.
Soulignons enfin que cette préoccupation nouvelle pour le port des signes religieux prend essentiellement pour cible les membres des communautés non-catholiques, et en particulier les Québécois-es de confession musulmane. Elle s’accompagne aussi de discours sur la « menace » que feraient porter ces communautés, et l’expression de leurs cultures et de leurs convictions religieuses, aux « valeurs québécoises ». Ces discours contribuent à alimenter le racisme et la xénophobie, qui sont des terreaux fertiles aux violations des droits humains.
| « La résistance intellectuelle et politique au multiculturalisme constitue l’une des sources profondes de la résurgence de la violence raciste et xénophobe. Dans le contexte de la mondialisation, cette résistance est révélatrice du rôle central des constructions identitaires dans la recrudescence du racisme et de la xénophobie. […]
Les enfermements identitaires qui traduisent ce conflit sont nourris par le refus de la diversité qui se manifeste sur deux terrains sensibles de la construction des identités nationales : le système des valeurs, d’une part, et les expressions et signes culturels, d’autre part. […] L’instrumentalisation juridique du refus de la diversité se manifeste, entre autres, par une lecture hiérarchique et politique des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les plates-formes racistes et xénophobes s’articulent ainsi de manière révélatrice autour de la rhétorique de la « défense de l’identité nationale et des valeurs nationales ». Cette crispation identitaire est déterminante dans la conception dominante, dans la plupart des régions du monde, d’une intégration-assimilation, qui est négatrice de l’existence même de valeurs et de mémoires spécifiques des minorités nationales et des immigrés […] » Assemblée générale des Nations Unies, Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Doudou Diène, Application de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006, intitulée « Conseil des droits de l’homme », A/HRC/4/19, 12 janvier 2007. |
6. Laïcité, racisme et xénophobie
La question de la laïcité a refait surface au début des années 2000 au Québec, dans un contexte marqué par la montée en force de l’islamophobie en Occident. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 et de la guerre des puissances impériales contre le « terrorisme », cette période a vu éclore des théories fallacieuses sur le « grand remplacement » (selon laquelle les populations migrantes remplaceraient bientôt les populations occidentales « de souche ») et la soidisant menace de l’islam politique et de l’islamisme radical.
Ce contexte délétère a contribué à alimenter le racisme, la peur de l’Autre et l’islamophobie, qui ont ensuite servi de justification pour multiplier les violations de droits de nos concitoyen-nes musulman-es ici, au Québec.
La laïcité, dans un tel contexte, a été utilisée comme un instrument de domination, en plus de renforcer une fausse opposition entre un « nous québécois », qui serait émancipé du religieux, et un « eux musulmans » qui serait encore sous son emprise. Cette division dangereuse entre le « eux » et le « nous » revêt tous les traits du (néo)racisme.
Rappelons que la laïcité a pour objectif de protéger les droits humains et d’assurer l’égalité de tous-tes. Toute politique qui restreint l’exercice de ces droits va à l’encontre de la laïcité elle-même.
Historiquement, la laïcité a servi à protéger les droits des minorités religieuses contre les potentielles attaques de la majorité. En invoquant les droits collectifs et les « valeurs québécoises » pour nier les droits de certaines communautés non-catholiques, le gouvernement actuel s’attaque directement aux fondements de la laïcité qu’il prétend pourtant défendre.
Pour une laïcité respectueuse des droits!
La Ligue des droits et libertés (LDL) a préparé cet outil afin de remettre en cause certains mythes et discours erronés véhiculés depuis plusieurs années dans l’espace public québécois au sujet de la laïcité.
Au début des années 2000, les enjeux liés à la laïcité ont refait surface dans l’actualité québécoise dans le contexte des débats liés aux « accommodements raisonnables ». Les débats entourant la laïcité de l’État se sont intensifiés pendant la Commission Bouchard-Taylor de 2007 et 2008, qui a pourtant démontré qu’il n’y avait pas de réelle « crise » des accommodements au Québec, mais plutôt une crise de perception alimentée – comme c’est encore le cas aujourd’hui – par certains discours médiatiques et politiques.
Le projet de « charte des valeurs » présenté en 2013 par le Parti québécois a accentué les clivages sociaux en présentant certains groupes de notre société comme des menaces pour la sauvegarde de la culture et des « valeurs » de la nation québécoise. Depuis, le débat public s’est enlisé, marqué par une montée en force du racisme, de l’intolérance et de l’islamophobie.
Le gouvernement de la CAQ a adopté en 2019 la Loi sur la laïcité de l’État, une loi discriminatoire qui visait notamment à empêcher de nouvelles enseignantes légalement qualifiées, mais portant le voile d’œuvrer au sein du réseau public d’éducation. Cette loi a été adoptée sous bâillon et en invoquant les clauses de dérogations des Chartes des droits canadienne et québécoise. Le recours à ces clauses a permis au gouvernement québécois de bafouer les droits humains en toute impunité, en contournant le pouvoir des tribunaux et en privant de tous recours les personnes victimes de discrimination.
Depuis, d’autres lois ou projets de loi attentatoire aux droits humains – dont la Loi sur l’intégration à la nation québécoise et le projet de loi 94 sur la laïcité à l’école – ont été élaborés afin de donner au gouvernement le pouvoir d’imposer les « valeurs québécoises » aux personnes issues de l’immigration ou aux membres de certaines communautés ethniques ou racisées.
Les politiques du gouvernement québécois actuel en matière de laïcité sont attentatoires aux droits humains et incompatibles avec les principes fondamentaux de la laïcité.
La LDL appelle toutes les personnes et organisations qui défendent la laïcité à s’opposer fermement aux politiques discriminatoires du gouvernement actuel et de tout gouvernement. Elle met également en garde la population contre les discours et les législations qui font la promotion d’une forme de laïcisme – et non de laïcité – en prônant l’éradication de l’expression du religieux dans l’espace public.
Les politiques gouvernementales en matière de laïcité sont empreintes de fondements racistes, sexistes et colonialistes. Les discours qui les accompagnent attisent le racisme, la xénophobie, les divisions sociales et stigmatisent certains groupes de la société, en particulier les personnes de confession musulmane.
La LDL constate avec effroi la tendance croissante à invoquer la laïcité, présentée comme une « valeur québécoise », pour s’attaquer aux droits des membres de certaines minorités religieuses non-catholiques, en particulier des personnes de confession musulmane. Résister devant l’instrumentalisation de la laïcité est d’autant plus urgent que nous assistons actuellement à une montée alarmante de la droite, du conservatisme, de l’autoritarisme et du nationalisme identitaire, au Québec comme à l’échelle mondiale.
Ce document vise enfin à jeter les bases d’une laïcité inclusive et respectueuse des droits, adaptée au Québec pluriel d’aujourd’hui. Car loin d’être une « valeur québécoise » ou un « droit collectif », la laïcité est un mode d’aménagement du pluralisme religieux dont l’objectif principal est de protéger les droits et libertés de tous-tes.
Face aux discours qui cherchent à opposer la laïcité aux Chartes, aux droits humains ou aux droits de certaines communautés, la vigilance s’impose!