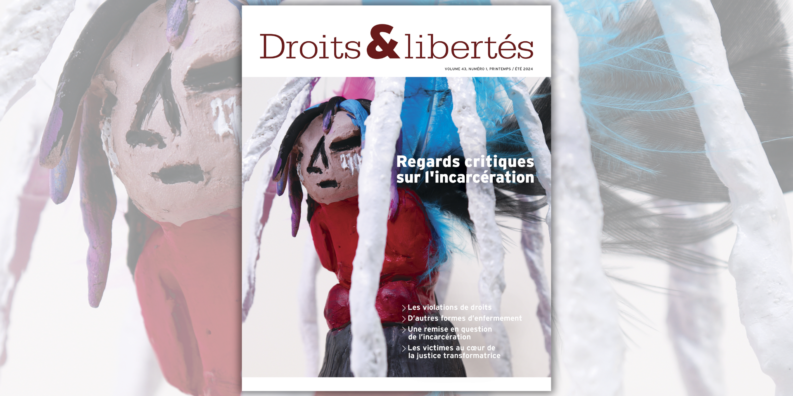Retour à la table des matières
Droits et libertés, printemps / été 2024
Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille
Alexandre Petitclerc, doctorant en philosophie et président du CA de la Ligue des droits et libertés
Les derniers mois ont été marqués par des luttes importantes concernant les services publics québécois. La grève des enseignant-e-s et les luttes des travailleuses de la santé nous ont rappelé que la réalisation d’un projet de société respectueux des droits humains est intrinsèquement liée à des services publics accessibles et financés adéquatement. En ratifiant différents traités et accords en matière de droits humains au cours des 75 dernières années, le Canada et le Québec se sont engagés à mettre en œuvre ces droits. Un financement adéquat et pérenne des services publics permet de mettre en œuvre le droit à la santé, à l’éducation ou au logement, par exemple.
Sans financement adéquat, les droits humains ne demeurent que des principes énoncés comme des vœux pieux. Alors, les services publics sont constamment menacés par la privatisation et par les désinvestissements, ces phénomènes mettent à mal la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services sociaux, par exemple. Le langage des droits humains rappelle qu’investir en éducation, en santé et dans le logement n’est pas uniquement un choix politique, mais contribue aussi à ce que les États respectent les obligations auxquelles ils se sont engagés. Le financement des services publics est une affaire collective et participe au plein exercice des droits garantis à toutes et tous et à réduire les inégalités socioéconomiques. Privatiser les services publics participe d’un désaveu envers ces droits et envers, qui plus est, celles et ceux qui fournissent les soins et services au quotidien.
En ce sens, il est particulier de constater la manière dont le gouvernement provincial a instrumentalisé les luttes syndicales de l’automne dernier pour expliquer le déficit du budget 2024-2025. Le parti au pouvoir n’a pas hésité à mettre la faute sur les hausses salariales des employé-e-s de l’État pour justifier que le gouvernement se retrouve à adopter un budget peu enviable face à son électorat. Or, financer les services publics convenablement, en offrant notamment des salaires décents et des conditions de travail raisonnables, peut se faire sans opposer le personnel de l’État aux contribuables. Au contraire, les travailleuses et les travailleurs et les contribuables sont tous détentrices et détenteurs de droits dont le droit à une vie décente, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit d’association, etc. De plus, si les services publics constituent un des moyens de réaliser les droits humains, l’État devrait trouver des manières de financer ces services.
Une des critiques les plus fortes concernant la pleine réalisation des droits humains — notamment les droits économiques, sociaux et culturels — se base précisément sur l’argument voulant que la réalisation des droits soit dépendante des ressources disponibles au sein des États. Cet argument, celui de la rareté des ressources, stipule qu’il est difficile de mobiliser le langage des droits humains pour justifier des dépenses dans certains services publics. S’il existe une limite matérielle à la réalisation des droits, diront ces critiques, alors il est inutile d’utiliser ce langage. Or, l’argument de la rareté ne doit pas être utilisé pour justifier l’abandon du cadre de référence des droits humains pour défendre les services publics. Au contraire, les engagements de l’État en matière de droits économiques, sociaux et culturels stipulent que la réalisation de ces droits doit se faire progressivement. L’État ne peut pas reculer par rapport à ces droits : il doit toujours travailler à améliorer leur réalisation.
De plus, l’argument de la rareté demeure relatif. Bien qu’il soit difficile de contester que l’État dispose de ressources finies pour parvenir à remplir ses obligations en matière de droits humains, il demeure néanmoins qu’il dispose d’une multitude de moyens pour financer les services publics de sorte à favoriser la pleine réalisation des droits humains. Son outil le plus efficace, surtout dans un contexte d’accroissement significatif de la concentration des capitaux, demeure un ensemble de mesures pour limiter et éventuellement éliminer les inégalités socioéconomiques. Or, même en laissant de côté le motif électoraliste d’une telle position, il est difficile pour le gouvernement d’augmenter les revenus provenant des impôts des classes inférieures et moyennes, en raison de l’effet matériel important sur ces classes. Néanmoins, l’enrichissement des groupes les plus possédants a été presque exponentiel depuis les dernières décennies et encore plus depuis la COVID-19. Une période de ralentissement et de difficultés économiques ne justifie aucunement que l’État délaisse ses engagements en matière de droits humains. Il doit en faire plus pour s’assurer que nous puissions éventuellement vivre comme égaux au Québec. Nous le répétons, la réalisation des droits humains doit se faire de manière progressive et l’État ne peut accepter des reculs en la matière.
Les grandes mobilisations syndicales, fin 2023 et début 2024, nous rappellent que le cadre de référence des droits humains doit rester au cœur des revendications pour redire à l’État de remplir ses obligations : envers tous les titulaires de droits.