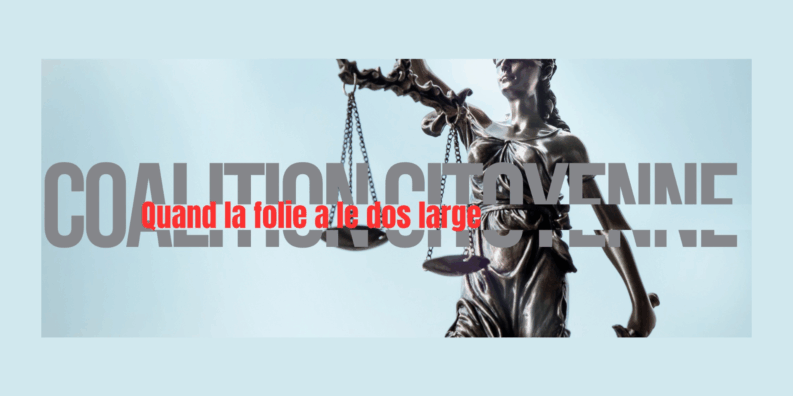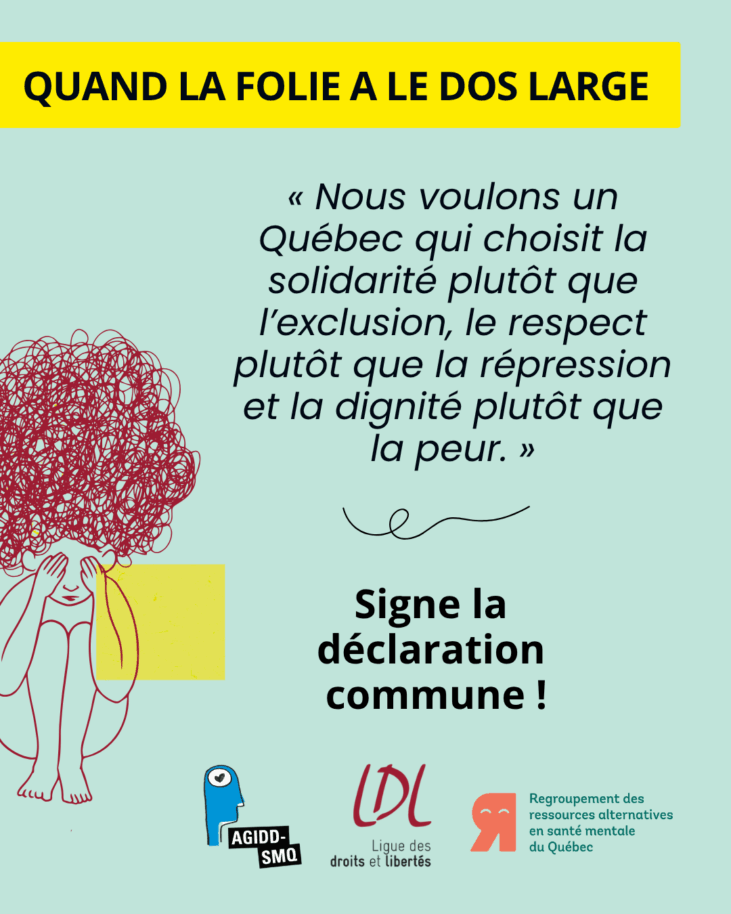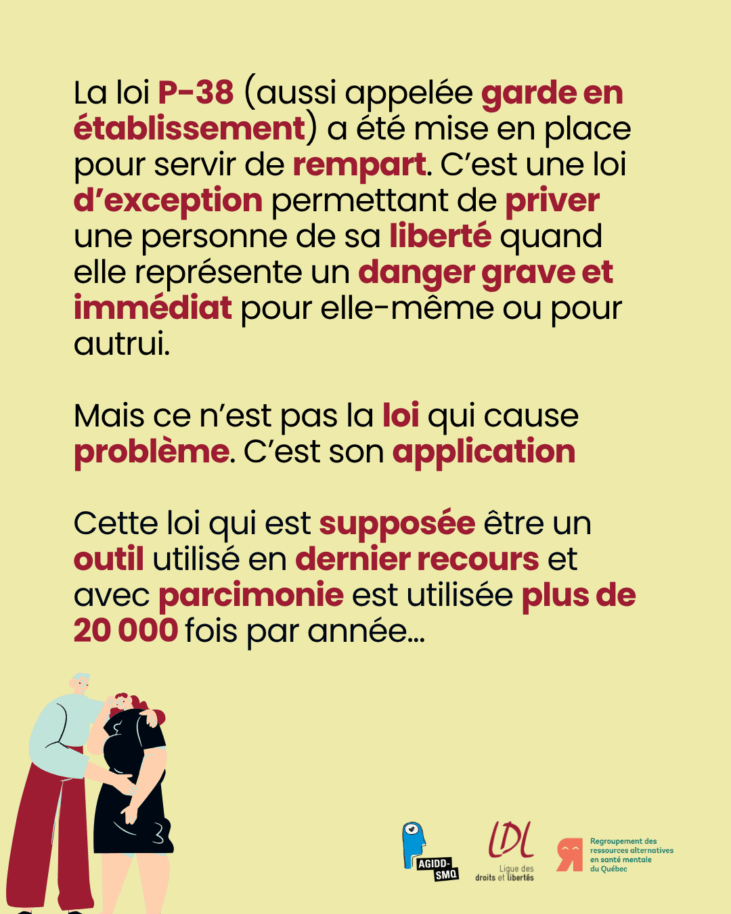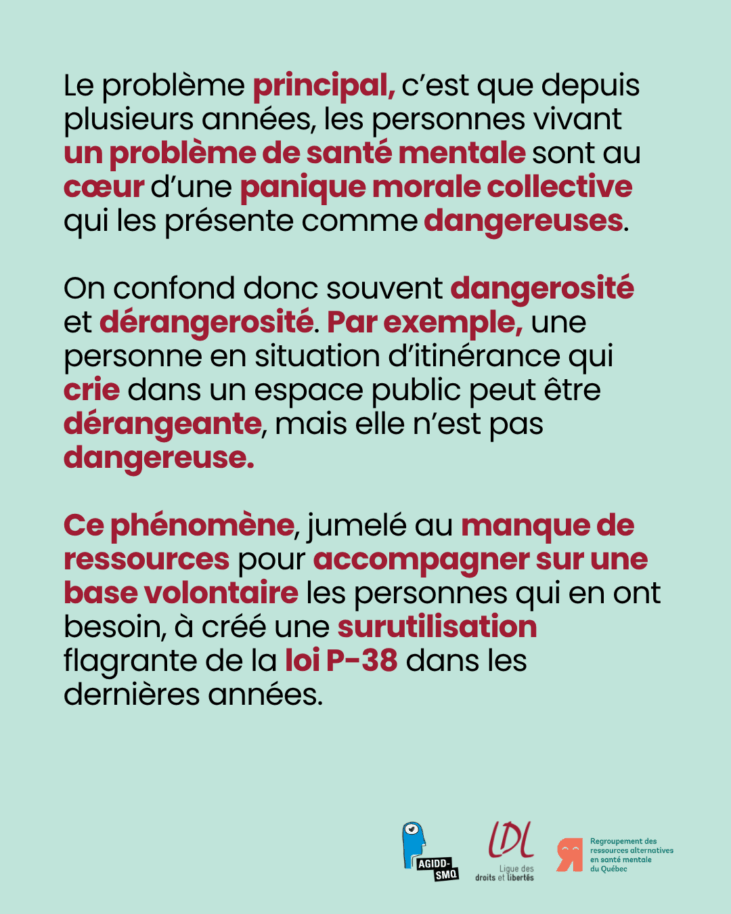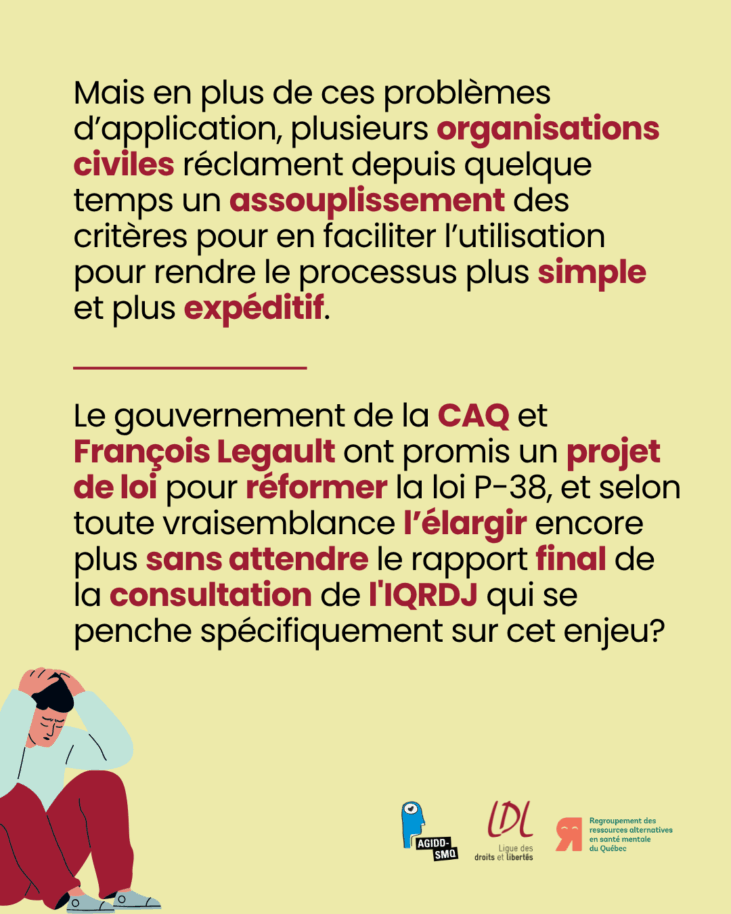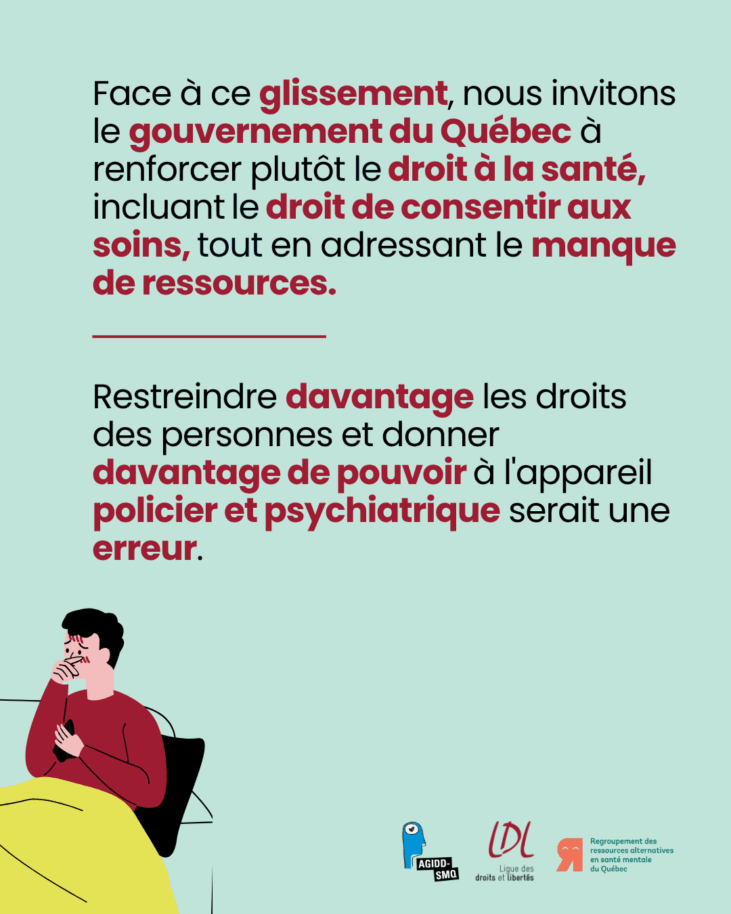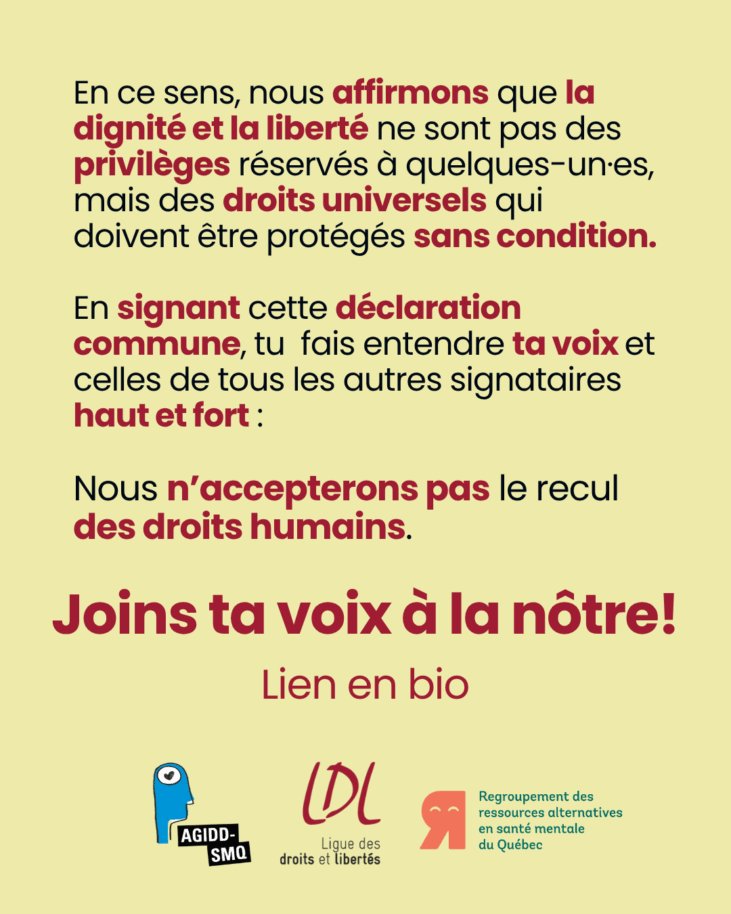Quand la folie a le dos large
Déclaration commune contre un nouveau recul des droits humains au Québec
Signez la déclaration ici !
Depuis plusieurs années, les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sont au cœur d’une panique morale qui les présente comme dangereuses, imprévisibles ou menaçantes pour la sécurité publique. Cette perception est alimentée par certaines situations dramatiques largement relayées dans les médias, qui transforment des situations isolées en généralisation abusive, et finit par envoyer le message que toute personne en crise est une menace.
Dans ce climat de peur, nous nous inquiétons du fait que des organisations réclament un changement de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38), pour faciliter le recours à des hospitalisations contraintes.
Des droits qu’on croyait acquis
En effet, la Loi P-38 (aussi appelée garde en établissement) a été mise en place au Québec pour servir de rempart. C’est une loi d’exception permettant, dans des cas très précis, de priver une personne de sa liberté lorsqu’elle présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Dans son essence, cette loi n’est donc pas un soin: c’est un outil juridique permettant de suspendre temporairement les droits fondamentaux de la personne dont l’état mental représenterait un risque.
Cependant, sur le plan de son application, il faut reconnaître que l’utilisation de la Loi P-38 n’a plus rien d’exceptionnel. Selon les données compilées dans le cadre d’une large consultation commandée par le ministre Lionel Carmant et menée par l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), la P-38 est un mécanisme utilisé plus de 20 000 fois/année[1]! De même, quand on consulte les mémoires déposés notamment par Représent’Action et plusieurs groupes en défense de droits, qui ont compilé des centaines de témoignages de personnes qui ont fait l’objet d’une P-38, il est difficile de nier qu’il y a des abus. En effet, comme le souligne l’IQRDJ, le “fléau grandissant associé à la confusion entre la dangerosité et la dérangerosité” fait que l’évaluation de la dangerosité repose parfois sur « le mode de vie » ( les relations avec les proches ou les voisins, le logement, l’emploi ou les études, la consommation de drogue ou d’alcool, ainsi que l’alimentation, les dettes et la sexualité), avec comme conséquence possible de transformer « la demande de garde en établissement en un instrument de contrôle social[2]».
Le Protecteur du citoyen publiait d’ailleurs une alerte en 2018 sur des dérives dans l’application de la loi de la garde en établissement. Autrement dit, en l’état actuel, nous acceptons collectivement que chaque jour, au Québec, des personnes voient leurs droits fondamentaux suspendus en fonction d’une « notion de dangerosité [qui] demeure imprécise à bien des égards, ce qui rend parfois son opérationnalisation aléatoire et subjective[3]».
Un mouvement de fond inquiétant
On est donc en droit de s’inquiéter quand des organisations civiles appellent aujourd’hui le gouvernement du Québec, non pas à corriger ces abus dans l’application de la loi, mais à assouplir son cadre. Doit-on craindre un élargissement du recours aux mesures coercitives et des situations de vulnérabilité dans le cadre desquelles elles sont appliquées (violence conjugale, déficience intellectuelle, itinérance, neuroatypie, toxicomanie, etc…)?
Dans le cadre de la démarche de l’IQRDJ, un consensus ressort de la majorité des mémoires soumis: ce n’est pas la loi en tant que telle qui pose problème, mais le manque de ressources pour accompagner volontairement les personnes qui se retrouvent en situation de détresse ou de difficulté. Non seulement les ressources manquent, mais elles se font aussi de plus en plus rares, comme en témoigne la fermeture récente de la clinique 388 à Québec, tout comme la fin du financement d’un projet pilote en Montérégie, porté par un groupe communautaire de parents et proches, qui avait pourtant «permis de faire baisser de 95 % les hospitalisations forcées[4]».
Un tel recul des droits en santé mentale s’inscrit dans une tendance plus large d’attaque envers les droits humains et la démocratie. On le voit dans le traitement des crises de l’itinérance et des surdoses, auxquelles on répond avec des mesures insuffisantes et une logique du “pas dans ma cour” (projet de loi 103, démantèlement des campements à répétition, interdiction de dormir dans les parcs, etc.), qui contribuent à exclure et criminaliser la pauvreté, au lieu d’en attaquer les causes profondes.
Face à ce glissement, nous invitons le gouvernement du Québec à renforcer plutôt le droit à la santé pour toutes et tous en adressant le manque de ressource et en réinvestissant en prévention et en accompagnement. Restreindre davantage les droits des personnes et donner davantage de pouvoir à l’appareil policier et psychiatrique serait une erreur. L’approche fondée sur les droits humains (incluant le droit à la santé) préconise d’abandonner tout recours aux pratiques coercitives en psychiatrie et cela est réitéré dans des travaux récents de l’Organisation mondiale de la santé et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
Une société de dignité et de solidarité
Au Québec comme ailleurs, nous vivons une époque où les droits que nous pensions acquis sont de plus en plus fragilisés. Les droits fondamentaux qui garantissent nos libertés individuelles et collectives sont mis à mal par des décisions politiques qui, tout en augmentant les inégalités sociales, prétendent ensuite régler les problèmes sociaux qui en découlent par “la loi et l’ordre”. On crée ainsi des précédents inquiétants, qui renforcent les injustices et fragilisent le tissu social dans un cercle vicieux: chaque fois que nous acceptons de tronquer les droits humains, nous ouvrons la porte à l’érosion graduelle de notre société démocratique.
Nous voulons un Québec qui choisit la solidarité plutôt que l’exclusion, le respect plutôt que la répression, la dignité plutôt que la peur.
En ce sens, nous, citoyen·nes, organismes communautaires, OBNL et mouvements citoyens, affirmons que la dignité et la liberté ne sont pas des privilèges réservés à quelques-un·es, mais des droits universels qui doivent être protégés sans condition. En signant cette déclaration commune, nous faisons entendre une voix claire : nous n’accepterons pas le recul des droits humains.
Signez la déclaration ici !
[1] Si on additionne les données pour la garde préventive et la garde provisoire à partir des chiffres fournis dans le Portrait général et revue de littérature de l’IQRDJ, 2024, pp.31 et 34.
[2] Citations tirées du Portrait général et revue de littérature produite par l’IQRDJ, 2024, pp.58-59.
[3] Citation tirée du Portrait général et revue de littérature produite par l’IQRDJ, 2024, pp.63.
[4] Stéphanie Vallet et Améli Pineda (23 avril 2023), Une solution sans fonds pour les familles en santé mentale, Le Devoir.